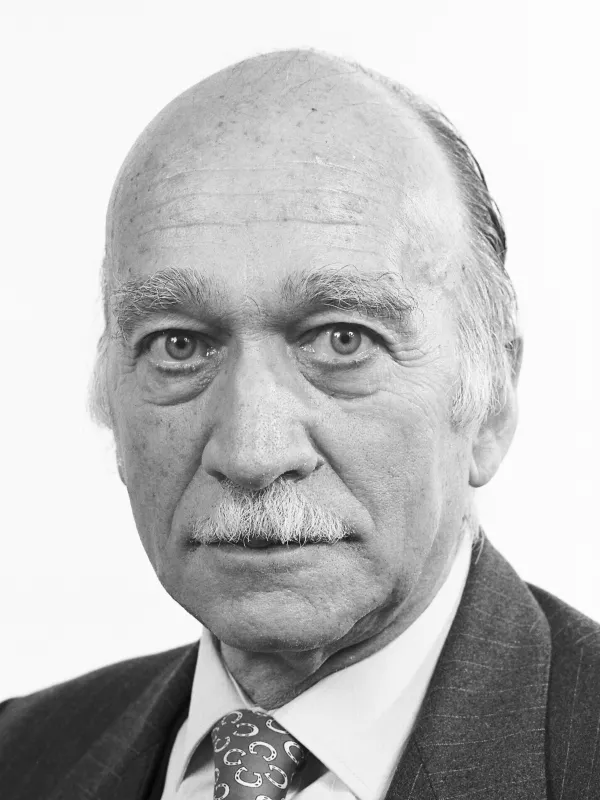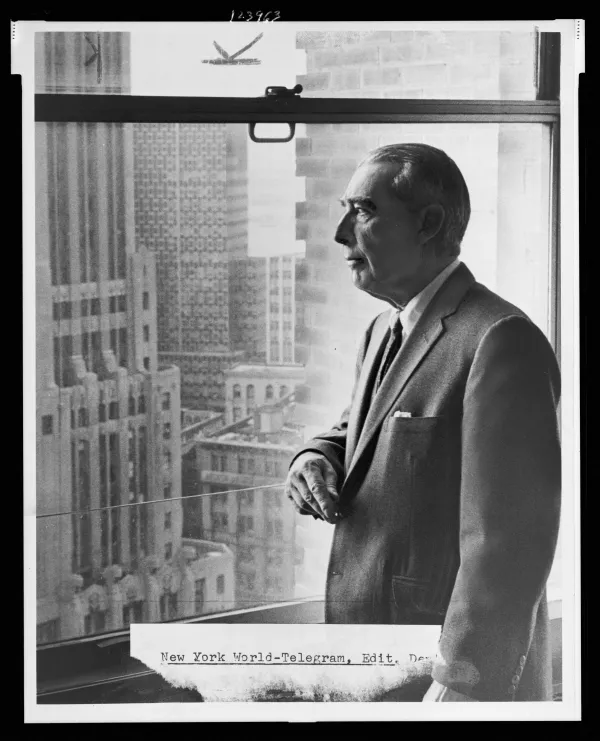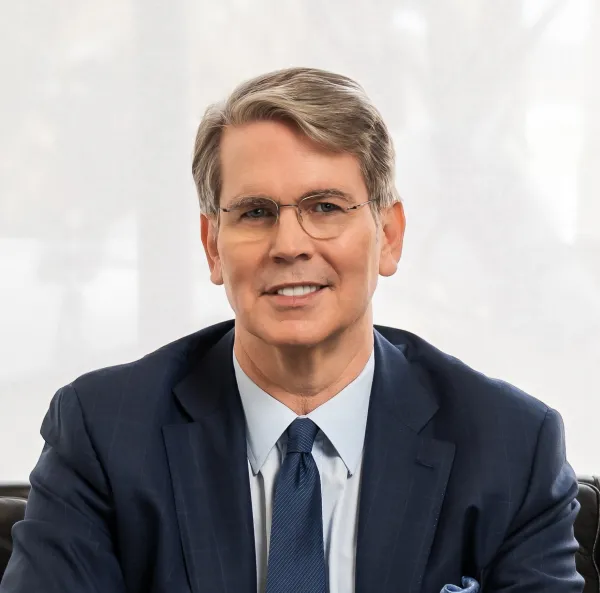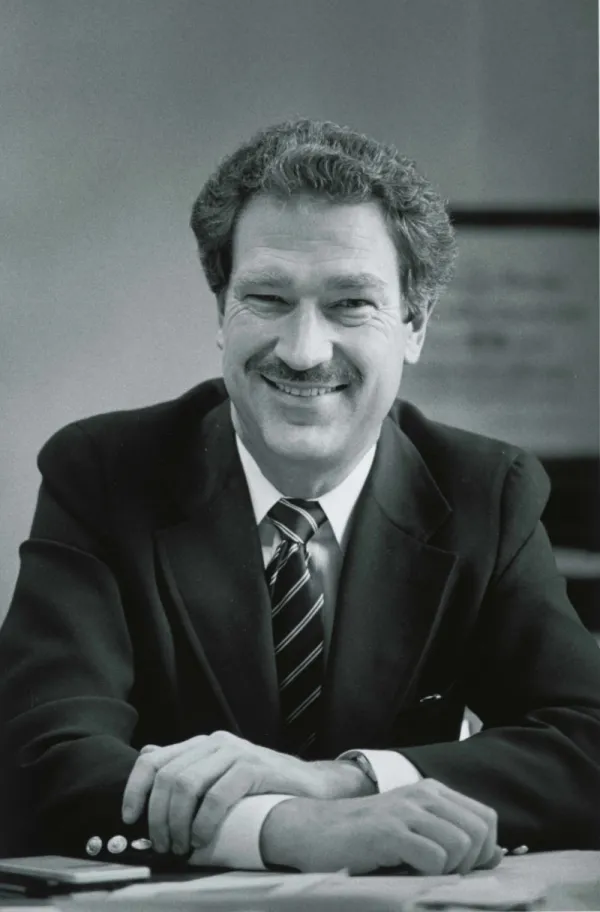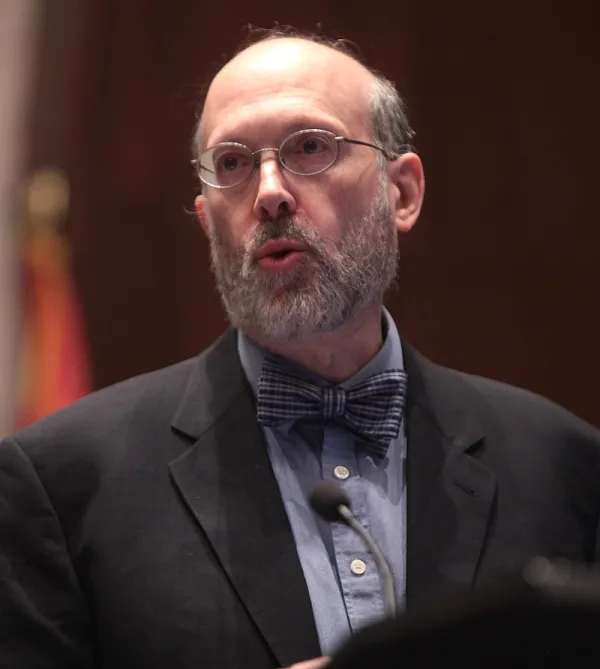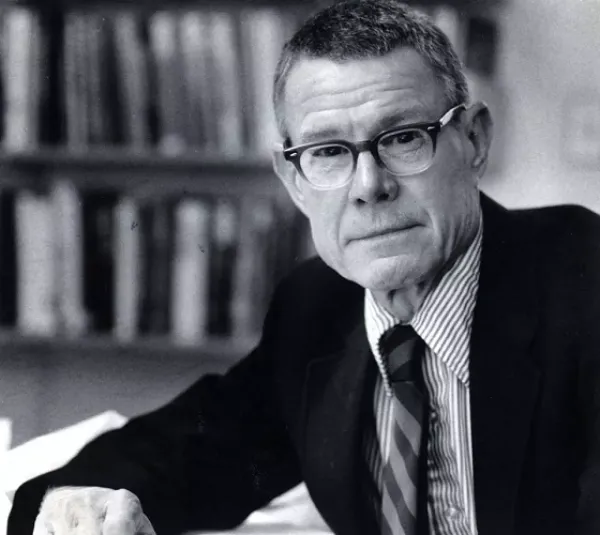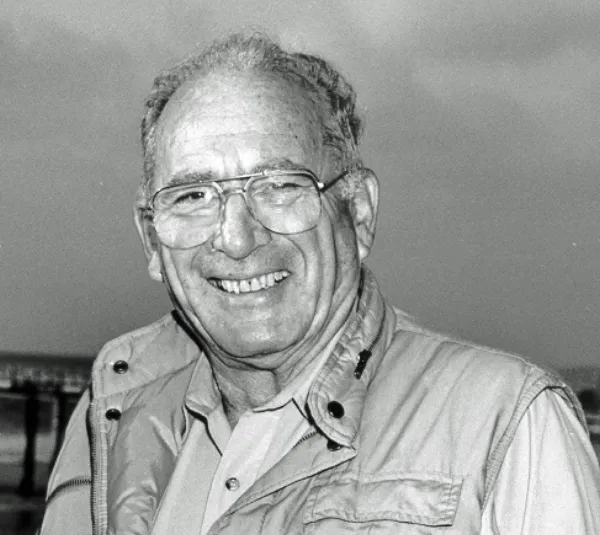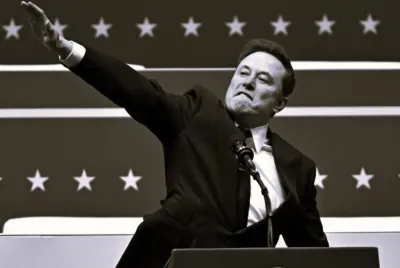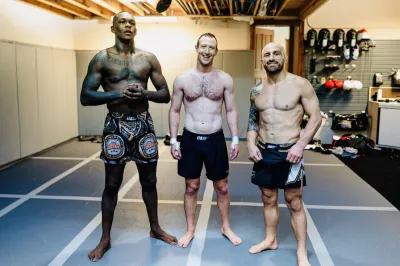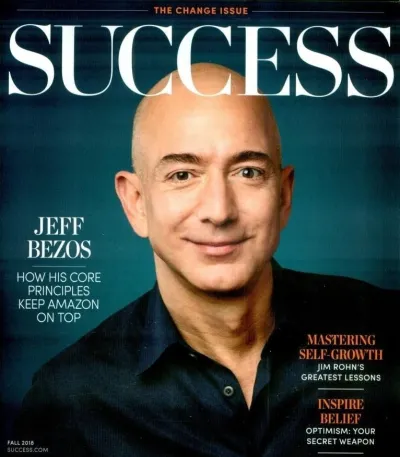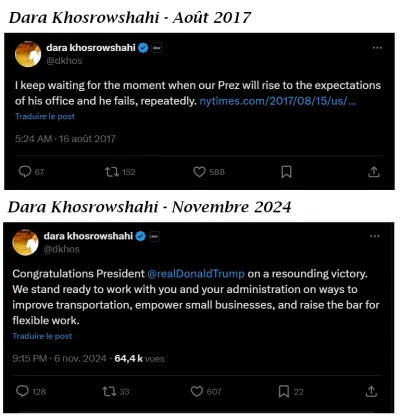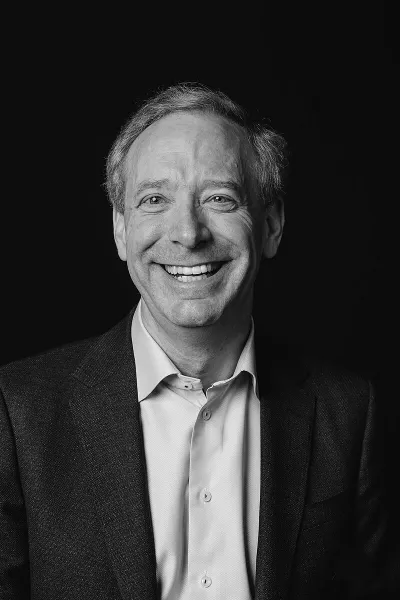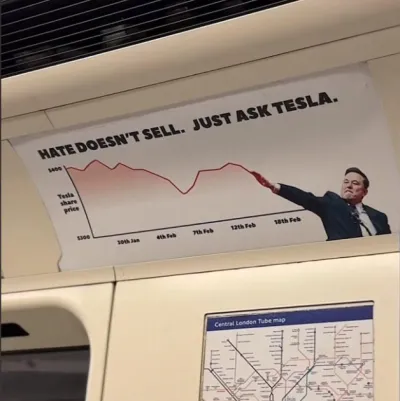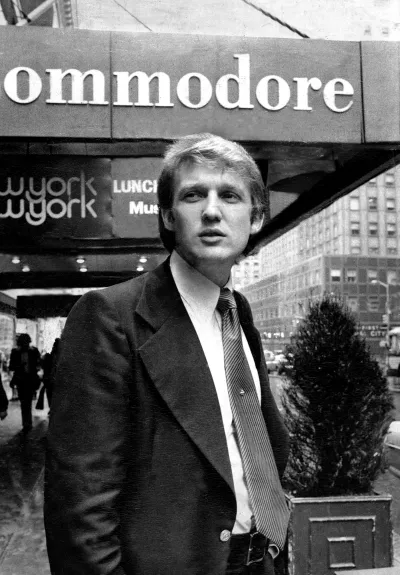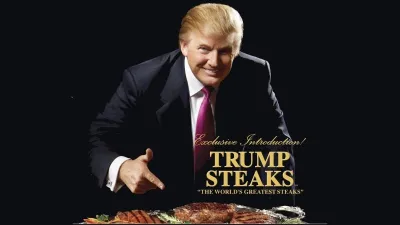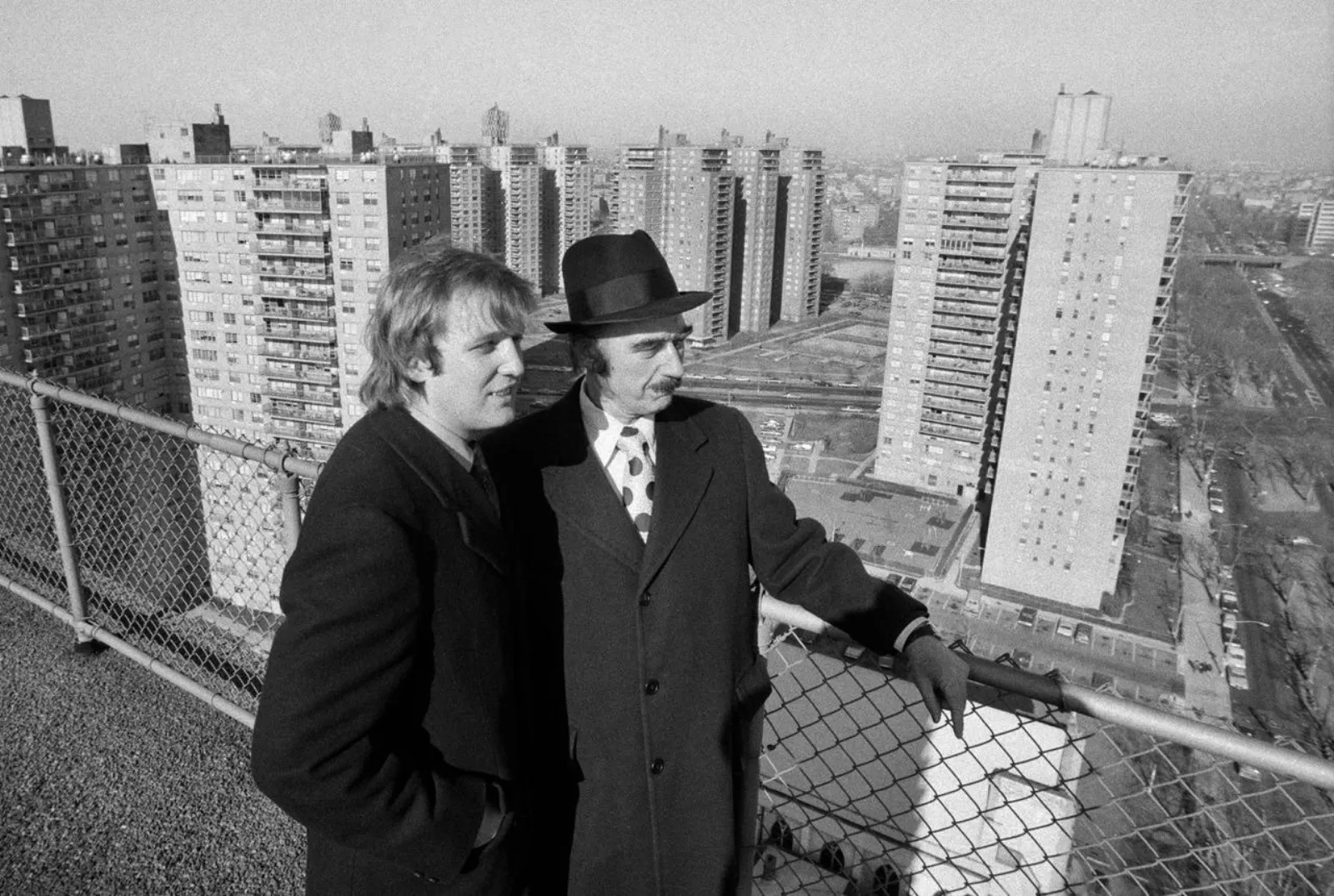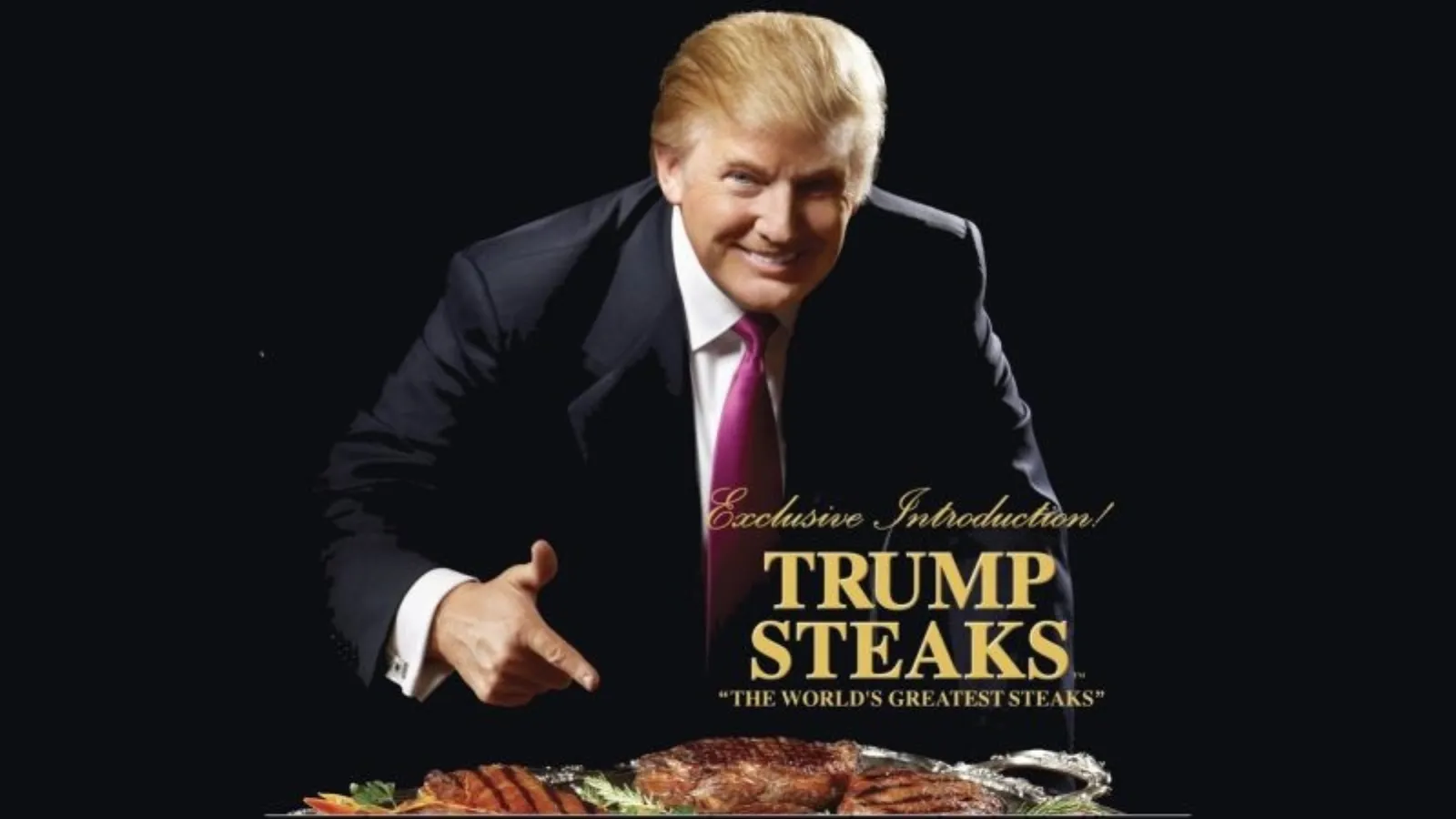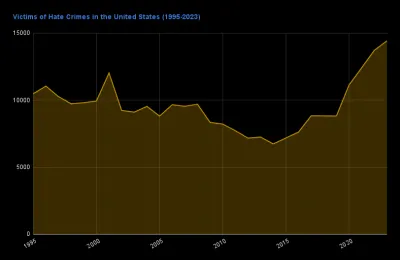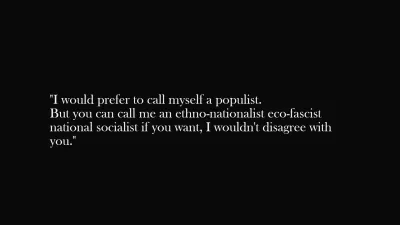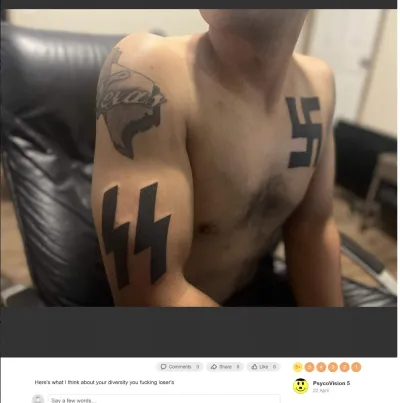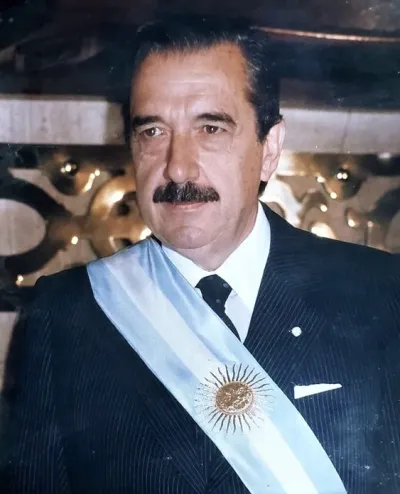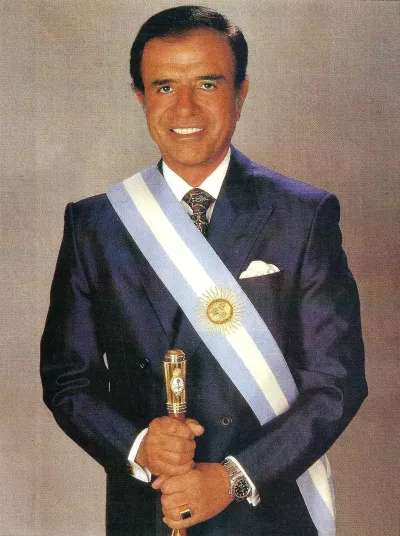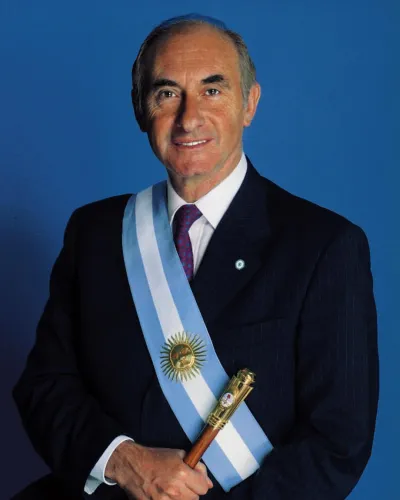Variété des extrêmes droites
L’essor global des extrêmes droites s’accompagne de la structuration d’une véritable internationale brune, avec ses lieux de rencontre réguliers et ses intellectuels organiques. Il convient toutefois de ne pas négliger les différences entre plusieurs grandes familles : car ils ont beau croiser leurs expériences, s’emprunter des morceaux de programmes ou parfois se ranger derrière un même candidat, les promoteurs d’un état social financé par des tarifs douaniers et purgé de ses bénéficiaires allogènes ne se confondent pas avec les « tronçonneurs » libertariens des administrations publiques. Pareillement, les nostalgiques des hiérarchies traditionnelles ne partagent pas forcément les priorités des défenseurs d’un peuple supposément méprisé par des élites arrogantes.
Sans doute la promesse d’une régénérescence de la nation fondée sur le tri et l’épuration rassemble-t-elle la plupart des formations émargeant à la droite de la droite. Pour autant, force est de reconnaître que les critères de sélection peuvent eux aussi varier, d’un pays et d’une sensibilité à l’autre. Il arrive en effet que les minorités d’origine étrangère ne soient pas toutes logées à la même enseigne – comme l’atteste par exemple la préférence de l’extrême droite espagnole pour l’immigration issue de l’ancien empire colonial – ou que la xénophobie entre en conflit avec le racisme – comme l’a illustré le différend entre l’aile nativiste de MAGA et les oligarques de la tech ralliés à Donald Trump, à propos des visas à accorder aux ingénieurs venus d’Asie.
En outre, il est nécessaire de différencier les imaginaires d’extrême droite en fonction de l’importance qu’y revêt la justification religieuse de leurs programmes, et du rôle qu’ils accordent à l’agitation de phobies relatives au genre et à la sexualité. Ainsi constate-t-on qu’en France, le Rassemblement national peut chercher à légitimer son islamophobie en arborant son allégeance à la laïcité et en fustigeant le traitement que la religion musulmane réserve aux femmes et à l’homosexualité. Mais il en va autrement de l’autre côté des Alpes, où le trouble dans les rapports de genre et les dommages censément infligés à la masculinité par le féminisme et le militantisme LGBTQI+ figurent en bonne place dans les paniques morales attisées par les postfascistes.
Enfin, la conquête du pouvoir d’État par l’extrême droite ne s’opère pas partout selon les mêmes modalités : là où le bipartisme est la norme, comme aux États-Unis ou au Royaume Uni, elle procède avant tout de la capture de vieux partis conservateurs par des courants autoritaires, nativistes ou/et libertariens. En revanche, dans les pays où le champ politique est plus fragmenté, ce qui est généralement le cas au sein de l’Union européenne, l’entrée des membres de l’internationale réactionnaire dans les gouvernements passe le plus souvent par la formation de coalitions entre formations néolibérales et illibérales.
En dépit de leur conscience aiguë d’appartenir à une grande famille et de leur disposition à mutualiser leurs ressources, les partis d’extrême droite ne sont donc pas tous taillés sur le même patron. Il importe par conséquent d’analyser leur variété, sur le plan doctrinal comme en termes de stratégie électorale. L’enjeu d’un tel examen est d’observer comment ils s’adaptent à la spécificité des champs politiques nationaux où ils s’implantent, mais aussi de comprendre comment la manière dont ils gèrent leurs divergences participe de leur mode de croissance.
L’Italie, orpheline de l’antifascisme
Propos recueillis le 13 Octobre 2025
“Les mouvements auxquels on a affaire aujourd'hui en Italie, le berceau du fascisme, n’ont jamais disparu. Ça ne sert à rien de parler de retour du fascisme, il a toujours été là.”
La Fabrique du déni
Propos recueillis le 24 Septembre 2025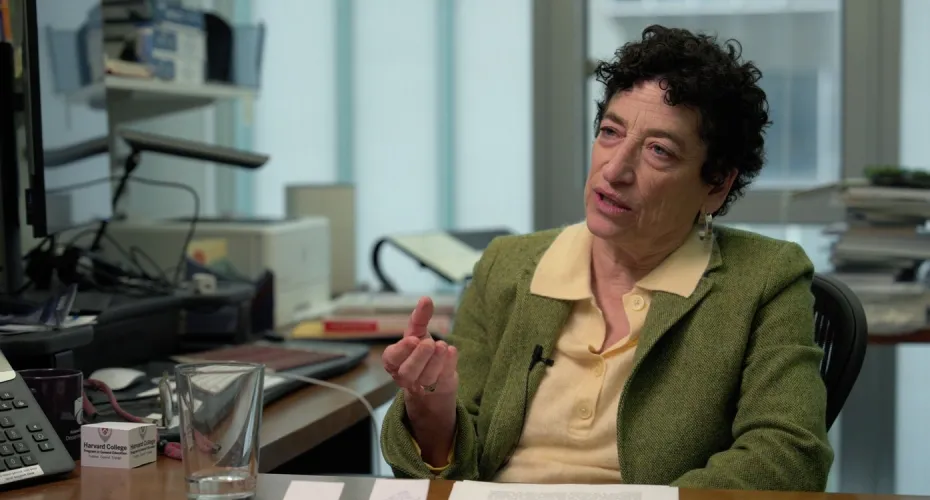
“Si vous supprimez les agences qui jouent un rôle crucial dans la mesure du changement climatique, vous n’avez même plus besoin de nier la science. Vous la détruisez, tout simplement. Il y a quelque chose de particulièrement agressif et tragique dans ce glissement vers un territoire orwellien.”
LE LABORATOIRE ARGENTIN
Propos recueillis le 01 Avril 2025
"Javier Milei s'est présenté comme le résultat final de la crise de représentation du système."
Conservatisme Révolutionnaire
Propos recueillis le 14 Mars 2025
« Il y a toujours eu une forme d’anti-capitalisme d’extrême-droite, c’est vrai de toutes les extrêmes-droites. Ce qui est propre à la version américaine, c’est qu’il y a en son sein un courant profondément libertarien, fondamentalement attaché à l’idée des libres marchés. Cela produit un type particulier d’anti-capitalisme, ou de pseudo anti-capitalisme, parce qu’ils ne s'attaquent qu'à une faction spécifique du capitalisme au profit d’une autre : la leur. »
De la Post-Démocratie en Amérique
Propos recueillis le 23 Février 2025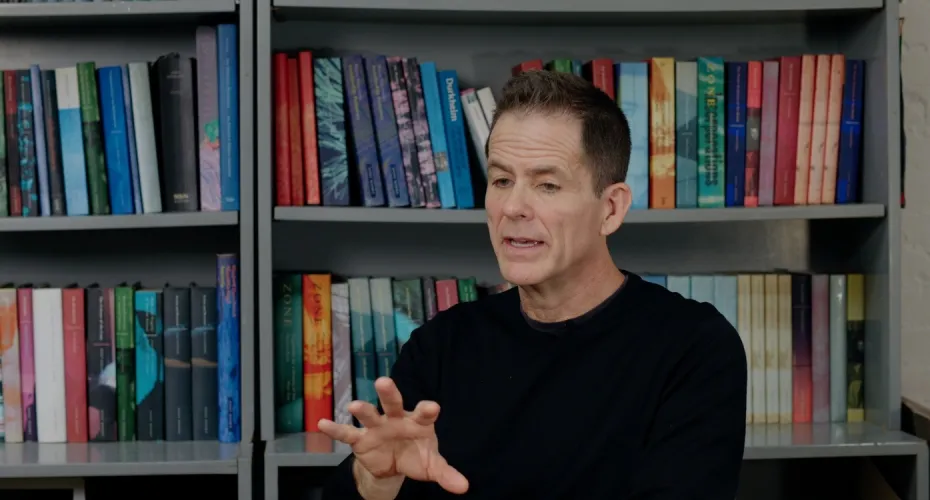
“La race a toujours été utilisée, dans la politique américaine, comme un bélier contre tout bien public, contre tout élan redistributif, contre toute idée de liberté collective ou sociale. Si vous attaquez avec la race, et que vous dites que ce que vous faites, c'est protéger les Blancs des Noirs, alors vous finissez par protéger les capitalistes des prélèvements sociaux.”
NÉOLIBÉRALISME TARDIF
Propos recueillis le 01 Février 2025
“Si on considère le néolibéralisme comme un projet continu pour protéger le capitalisme de la démocratie, alors les ennemis qui menacent le capitalisme se transforment d’une décennie à l’autre.”
Portraits
Giorgio Almirante
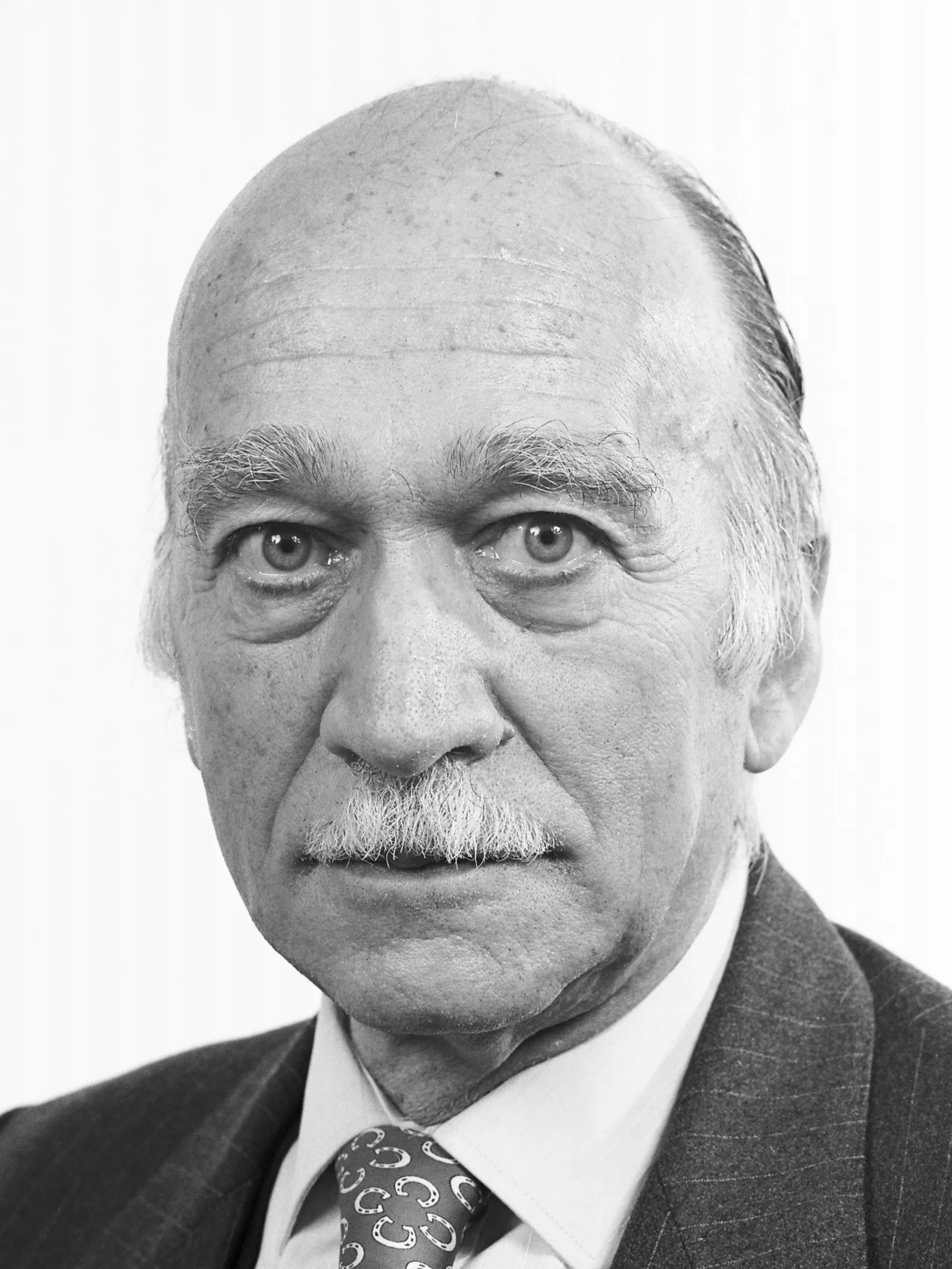
En 1946, lorsque des partisans et proches de Benito Mussolini fondèrent le parti néofasciste "Movimento Sociale Italiano" (MSI), une flamme tricolore fut choisie comme emblème. Alors que les symboles les plus manifestes du fascisme étaient plutôt le faisceau de licteurs ou l’aigle impérial, Giorgio Almirante, l’un des co-fondateurs qui deviendra président de longue date du MSI, aurait vu en la flamme une image forte : l’esprit de Mussolini s’échappant de son cercueil. Il réussit à l’imposer pour galvaniser ses troupes et graver dans leurs esprits l’idée que le fascisme devait rester "le but ultime" (‘il traguardo’) du mouvement qu’il avait contribué à lancer.
Celui qui avait été durant la guerre un théoricien du racisme et un propagandiste des "lois raciales" antisémites, affirma ainsi éhontément durant toute sa carrière de député parlementaire et jusqu’à sa mort en 1988 que son Movimento Sociale Italiano avait été pensé comme un parti de "fascistes dans une démocratie". Son ambition n’était en somme que d’adapter une ancienne cause à la réalité des temps nouveaux. Répondant en 1982 à une exhortation du fondateur du parti radical italien Marco Pannella de préciser le rapport de son parti à l’héritage fasciste, Almirante précisa ainsi : "[le MSI] représente le fascisme comme liberté, et non comme régime — c’est à dire comme mouvement, comme tradition sociale, comme synthèse de valeurs".
Sous la conduite d’Almirante, le MSI fut farouchement anticommuniste et travailla d’arrache-pied à une alliance avec la droite monarchiste rétive à tout compromis avec l’"Arc constitutionnel". Le parti continua à être impliqué dans divers complots de coups d’État et à fomenter des actes terroristes jusque dans les années 1980. Au cours des années 70 et 80, Giorgio Almirante activa également ses réseaux néofascistes à l’international. Il fut notamment à l’initiative de la création du Front National en France en 1972, prodiguant ses conseils aux membres du mouvement d’extrême droite Ordre Nouveau en vue de l’établissement d’un parti de "fascisme souriant".
D’abord critique et doubleur de cinéma, Almirante s’impliqua ensuite dans le journalisme politique. Il devint bientôt éditeur du journal Difesa della Razza (‘Défense de la race’) et signa en 1938 le Manifesto della razza (‘Manifeste sur la race’) qui énonçait les mesures racistes appliquées par Mussolini. Le scribe prit ensuite du galon en Sardaigne et en Libye, où il participa à la Campagne d’Afrique du Nord. Lors de l’établissement de la Repubblica Sociale Italiana en 1943, cet État fantoche, vassal du troisième Reich, Almirante suivit le Duce à Salò, ce qui lui valut le poste de chef de cabinet du "ministère de la Culture populaire" présidé par Fernando Mezzasoma durant les deux dernières années de la guerre. C’est alors qu’il exigea des siens qu’ils se préparent à un "affrontement physique" avec les partisans et qu’il s’engagea lui-même activement dans cette contre-résistance, du côté les Alpes lépontines et en Toscane.
Lors de la création du MSI en 1946, Almirante installa le siège du parti à la Via della Scrofa 39, qui deviendra plus tard une adresse mythique de la droite italienne, au même titre que la rue des Botteghe Oscure pour les communistes, Piazza del Gesù pour les démocrates-chrétiens, et Via del Corso pour les socialistes. Outre le bureau de la direction, s’y trouvait également la rédaction du journal "Il Secolo", sorte d'organe central des néofascistes. Silvio Berlusconi avec Forza Italia puis Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia y prirent plus tard leurs quartiers. Figure de proue de l’extrême-droite italienne durant la Première République, Almirante bénéficie depuis le tournant du siècle d’une nouvelle vie posthume comme idole des néofascistes transalpins. Sous la houlette de Berlusconi, lorsque s’amorce la restauration de l’héritage et des monuments fascistes en Italie, certaines communes iront même jusqu’à rebaptiser des rues en l’honneur de Giorgio Almirante et d’autres figures éminentes du fascisme historique. Plus récemment, Almirante fut aussi célébré par Meloni, laquelle revendiqua dans son autobiographie Io sono Giorgia (‘Giorgia Meloni - Mon itinéraire’ en français), publiée en 2021, avoir "pris le relai de Giorgio Almirante", son idole politique de longue date.
Marc Andreessen

Né en 1971, Marc Andreessen est un ingénieur logiciel et un investisseur de la Silicon Valley. En 1993, il développe, avec Eric Brina, NCSA Mosaic, le premier navigateur à intégrer des images, et fait exploser la popularité du World Wide Web. En 2009, après avoir œuvré au développement d’un certain nombre de logiciels à succès, Andreesen cofonde avec Ben Horowitz le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz, communément appelé a16z dans la Silicon Valley. Grâce à un investissement de 4,5 milliards de dollars réalisé en 2022, a16z est actuellement le plus grand bailleur de fonds de la crypto-industrie.
Andreessen se décrit lui-même comme un libertarien et un « techno-optimiste ». En octobre 2023, il publie le « Manifeste techno-optimiste » sur le site web d'a16z, dans lequel il présente sa vision d’un avenir rendu possible grâce à la technologie. Malgré des déclarations inclusives - « Nous pensons que la technologie est universaliste. La technologie ne se soucie pas de votre appartenance ethnique, race, religion, origine nationale, sexe, sexualité, opinions politiques, taille, poids, cheveux ou absence de cheveux » - son manifeste célèbre surtout l'avènement d'un monde dans lequel la technologie et les marchés non réglementés offriront des opportunités à tous.
Grand promoteur des enclaves protégées de toute forme de démocratie dont parle Quinn Slobodian dans Le Capitalisme de l’apocalypse, Andreessen réalise son rêve libertarien en contribuant à fonder Próspera avec Peter Thiel et Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Située au Honduras, Próspera est une ville privée où les entreprises échappent aux réglementations et peuvent prospérer librement.
Aux côtés d’Horowitz, Andreessen a joué un rôle clé dans le changement progressif d'allégeance politique de la Silicon Valley en faveur du Parti républicain. S'il n'occupe pas de poste au sein de l'administration Trump, Andreessen a tout de même été déterminant dans l'élaboration de Trump 2.0. Il a notamment été très impliqué dans la sélection des candidats assignés à la mission de réduction des programmes et de licenciement du personnel du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE). Avant l'élection présidentielle de 2024, Andreessen était l'un des principaux donateurs de la campagne de Trump au Super PAC Right for America, contribuant personnellement à hauteur de 4,5 millions de dollars et de 7 millions de dollars par l'intermédiaire d'a16z.
Howard Lutnick
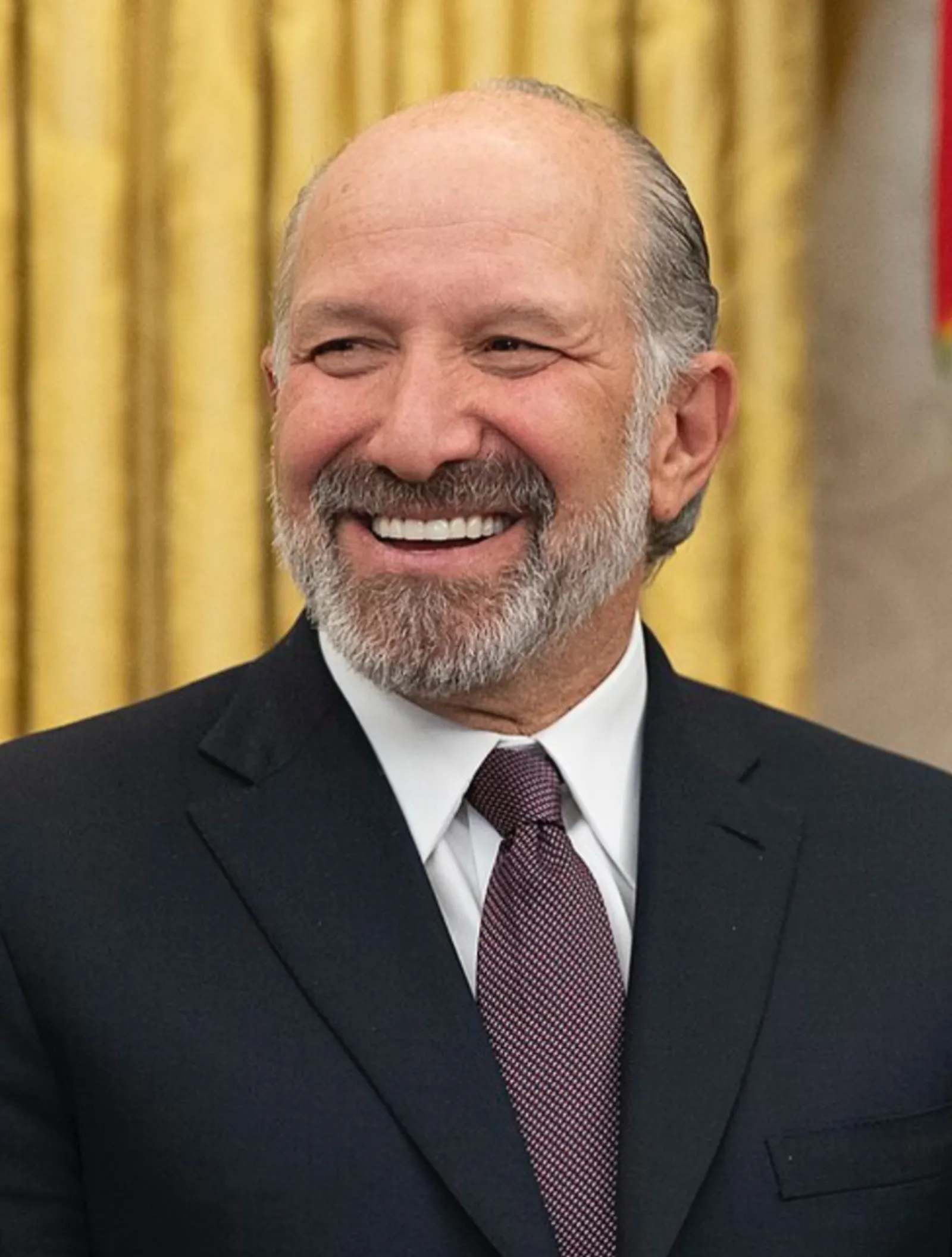
Howard Lutnick est le secrétaire au Commerce de Trump. Suite à sa confirmation, il a quitté son poste de PDG de la banque d’investissement Cantor Fitzgerald et de l’entreprise de service financier BGC Group. Lutnick est un fervent défenseur des cryptomonnaies et Cantor Fitzgerald est la banque de Tether, le plus important stablecoin au monde.
Contributeur majeur à la campagne de Trump, le secrétaire au Commerce connaît le président américain depuis de nombreuses années, ayant même participé à une saison de The Celebrity Apprentice en 2008. Lutnick qualifie sa relation de longue date avec Donald Trump de “superpouvoir”. Connu pour sa loyauté sans faille envers son patron, on lui prête également d’avoir inspiré certaines des idées les plus extravagantes de Trump, dont la prise de contrôle du canal de Panama et la création d'un visa “Gold Card” qui accorderait aux étrangers - même s'ils ne sont pas Afrikaners - le statut de résident légal aux Etats-Unis pour la somme de 5 millions de dollars.
En tant que secrétaire au Commerce, Howard Lutnick - qui en veut à Scott Bessent d'avoir obtenu le poste qu'il convoitait - a été, aux côtés de Peter Navarro, le plus ardent défenseur des tarifs douaniers célébrés par Donald Trump comme l’instrument de la “libération”. La manière dont il a soutenu le combat de son patron pour un “commerce équitable” rappelle néanmoins ”l'histoire du chaudron emprunté” de Sigmund Freud : un homme accusé par son voisin de lui avoir rendu son chaudron endommagé prétend d'abord qu'il n'était pas endommagé lorsqu'il l'a rendu, ensuite qu'il était déjà endommagé lorsqu'il l'a emprunté, et enfin qu'il ne l'a jamais emprunté. De même, Lutnick a successivement (1) nié que les droits de douane augmenteraient les prix pour les consommateurs américains, (2) affirmé qu'une période d'inflation, voire une récession, étaient des sacrifices inévitables, et (3) que la plupart, si ce n’est tous les partenaires des États-Unis, concluraient bientôt un accord avec l'administration Trump, ce qui rendrait les droits de douane inutiles.
Adolf Berle
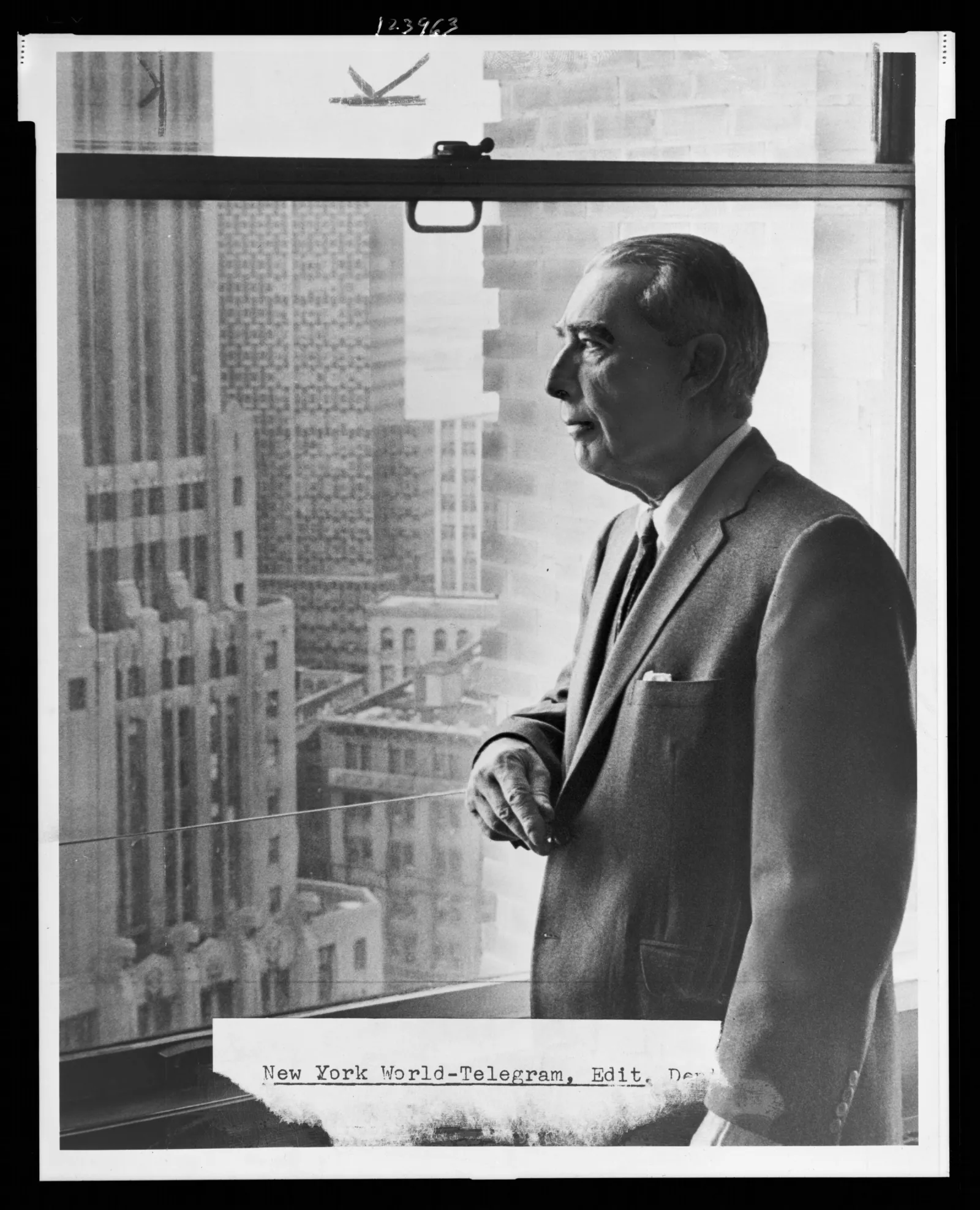
En 1943, un portrait que The New Yorker consacrait à Adolf Berle s’achevait par ces mots : “Tracer l’avenir du monde est une lourde tâche, mais Berle donne à nombre d’observateurs l’impression d’en être capable1.”
Né à Boston en 1895, celui qui allait devenir l’une des figures centrales du premier Brain Trust de Franklin Roosevelt se distingue très tôt par ses dons précoces. Entré à Harvard à 14 ans, il y obtient son diplôme de droit à 21 ans. Après la Première Guerre mondiale, il rejoint la délégation américaine à la Conférence de paix de Paris, où il fait la connaissance de John Maynard Keynes. À l’instar de l’économiste britannique, il est profondément choqué par les termes des traités issus des négociations et exprime publiquement sa désapprobation. De retour aux États-Unis, il exerce la profession d’avocat d’affaires, collabore régulièrement à des revues libérales telles que The Nation et The New Republic et débute, en 1927, l’enseignement du droit des sociétés à l’université Columbia.
À la suite du krach de 1929, Berle s’engage dans ce qui allait constituer son principal projet intellectuel : The Modern Corporation and Private Property, coécrit avec l’économiste Gardiner Means et publié en 1932. Dans cet ouvrage devenu une référence, Berle et Means analysent les transformations structurelles du capitalisme américain en cours. Ils montrent comment la domination des “barons voleurs” — Andrew Carnegie, Thomas Edison, John D. Rockefeller, J.P. Mellon — a cédé la place à la montée en puissance des sociétés anonymes cotées en bourse. Ces entreprises, tout aussi puissantes que les anciens trusts, n’étaient désormais plus contrôlées par leurs fondateurs tout-puissants, ni, à proprement parler, par des propriétaires identifiables. Chacune comptait des myriades d’actionnaires — plus de 500 000 pour American Telephone and Telegraph —, si bien que le pouvoir effectif était désormais exercé par leurs dirigeants et administrateurs salariés. Cette dissociation inédite entre propriété et pouvoir constituait, selon Berle et Means, une rupture historique majeure dans l’évolution du capitalisme.
A leurs yeux, le fait que l’économie américaine soit gouvernée par des dirigeants largement soustraits à toute responsabilité directe suscitait d’évidentes inquiétudes. Toutefois, ni Berle ni son coauteur ne préconisaient un retour au capitalisme des propriétaires : ils ne partageaient ni la nostalgie de Joseph Schumpeter pour l’âge des capitaines d’industrie autocratiques, ni la conviction du juge Louis Brandeis selon laquelle le démantèlement des grandes entreprises au moyen de la législation antitrust constituait la seule voie de régulation. La question, pour eux, n’était pas de restaurer les privilèges du capital privé - qu’il soit détenu par des magnats ou des petits entrepreneurs -, mais de mettre la puissance des grandes sociétés au service de l’intérêt général. Plutôt que de rendre du pouvoir aux actionnaires ou de fragmenter les grandes firmes, il convenait de réguler le pouvoir excessif des dirigeants. Autrement dit, tant la menace que la concentration économique faisait peser sur la démocratie que le potentiel de prospérité associé à l’expansion des grandes entreprises appelaient une intervention renforcée de l’État en faveur des travailleurs, des consommateurs et des différentes parties prenantes.
Berle fut bientôt en mesure de mettre en pratique ces principes. Après avoir rencontré Franklin Roosevelt en 1932, il joue un rôle actif dans la campagne présidentielle du gouverneur, rédigeant notamment le célèbre Commonwealth Club Address, qui définissait les orientations économiques du premier New Deal. Une fois Roosevelt installé à la Maison-Blanche, Berle décline toutefois les propositions de nomination à un poste ministériel, préférant demeurer conseiller officieux au sein du Brain Trust présidentiel. Son influence se traduit rapidement par trois réformes économiques majeures : la séparation des activités de dépôt et d’investissement bancaire (loi Glass-Steagall de 1932), la garantie fédérale des dépôts bancaires et la régulation des émissions de titres financiers des entreprises. À l’instar de Keynes, bien qu’au moyen d’instruments différents, Berle s’efforçait de contenir les déséquilibres du capitalisme ; les premières années du New Deal marquèrent à cet égard une avancée significative.
L’invalidation du National Recovery Administration par la Cour suprême réduisit néanmoins son influence directe. Il conserva toutefois un rôle important, notamment en tant que secrétaire d’État adjoint aux Affaires latino-américaines dès 1939, rédigeant en 1941 le message de déclaration de guerre adressé par Roosevelt au Congrès. Après la perte de son poste en 1944, il fut nommé ambassadeur des États-Unis au Brésil, avant de se retirer définitivement de la haute fonction publique en 1946. Il poursuivit néanmoins son activité de conseiller auprès de nombreux responsables politiques — d’Adlai Stevenson à Nelson Rockefeller et John Kennedy — et demeura un défenseur infatigable du compromis du New Deal qu’il avait contribué à forger, ainsi que, par extension, du rôle prétendument bienveillant des États-Unis dans l’ordre mondial. Cette orientation le conduisit à soutenir sans réserve les interventions impériales américaines, de l’Amérique latine au Vietnam.
Cinq ans après sa mort, en 1971, la conception de l’entreprise défendue par Berle fait l’objet d’une remise en cause décisive. Dans un article intitulé Theory of the Firm, Michael Jensen et William Meckling reprennent le diagnostic de The Modern Corporation and Private Property quant à la dissociation entre propriété et contrôle propre aux grandes entreprises modernes, qui laissait aux dirigeants une marge de manœuvre considérable. Toutefois, la solution qu’ils proposent rompt radicalement avec l’approche régulatrice de Berle et Means : au lieu de prendre pour acquis la personnalité juridique autonome des sociétés cotées et de limiter les dirigeants par la régulation fédérale, Jensen et Meckling soutiennent que ces derniers ne sont que des agents, strictement chargés de servir les intérêts des actionnaires. Abandonner la reconnaissance de l’entreprise comme entité autonome constituait, selon eux, une étape décisive vers la réconciliation de la propriété et du contrôle. De même que The Modern Corporation avait constitué un texte fondateur du New Deal, la publication de Theory of the Firm peut être interprétée comme un tournant annonciateur de notre nouvel “âge doré” et de ses nouveaux “barons voleurs”.
1 Cité par Nicholas Lemann dans « Institution Man », le premier chapitre de son ouvrage Transaction Man: The Rise of the Deal and the Decline of the American Dream (New York, Farrar Straus and Giroux, 2019). [https://business.columbia.edu/sites/default/files-efs/imce-uploads/richman_center/pdf/Nicholas%20Lemann%20_%20Berle%20%2B%20Political%20Economy%20_%202.pdf]
Robert Mercer

Né en 1946, l’ingénieur en informatique Robert Mercer a fait fortune en travaillant comme analyste financier pour le fonds spéculatif Renaissance Technologies. En 2009, il en est devenu le codirecteur général, mais a dû quitter ce rôle et renoncer à son siège au conseil d'administration en 2017, après la médiatisation de son implication dans le scandale Cambridge Analytica.
En 2013, le milliardaire a racheté SCL Group, une entreprise spécialisée dans l'analyse des données Internet. Tout en rebaptisant la société “Cambridge Analytica” pour lui donner l'apparence d'une entreprise légitime, il a complètement redéfini son activité. Grâce à l'analyse des données de profils Facebook obtenues sans le consentement éclairé des 87 millions de personnes ciblées, Cambridge Analytica a déployé une stratégie publicitaire secrète à grande échelle, adaptée aux différentes psychologies et aux facteurs socio-économiques des électeurs, afin de les inciter à voter "Leave" lors du référendum sur le Brexit, et à voter pour Ted Cruz et Donald Trump lors du cycle électoral américain de 2016. Parce qu'il finançait une entreprise privée, Mercer a pu contourner les lois sur les campagnes électorales, éviter les retombées politiques et les éventuelles actions en justice liées à l'acquisition de données, tout en ayant un impact majeur sur ces élections, jusqu'à ce que l'affaire éclate en mai 2017.
Mercer a également influencé la politique en faisant des dons à des organisations conservatrices et libertariennes, ainsi qu’à des PACs. Lui et sa fille, Rebekah Mercer, coordonnent leurs contributions politiques par l'intermédiaire de la Mercer Family Foundation, qu'ils ont créée en 2004 et qu'elle dirige. Ils ont donné des millions à la Heritage Foundation - Rebekah fait partie de son conseil d'administration depuis 2014 -, à la Federalist Society, à la Citizens United Foundation (de 2011 à 2015), au Media Research Center et à l'organisation libertarienne et climatosceptique Heartland Institute, entre autres.
Les Mercer ont également cofondé et investi au moins 10 millions de dollars dans Breitbart News, un important média d'extrême droite. C’est notamment par ce biais qu’ils ont promu, dès 2010, les idées et la carrière de Steve Bannon, et c’est par leur intermédiaire que Trump a rencontré son conseiller politique. Leurs dons leur permettent d’imposer leurs opinions conservatrices à différents niveaux - dans la sphère politique, dans les médias, mais aussi au niveau populaire avec leur organisation de surveillance Reclaim New York, qui encourage les New-Yorkais à signaler les dépenses publiques excessives. La dynamique de leur duo et la similitude des bénéficiaires de leurs dons leur ont valu d'être comparés aux frères Koch.
Scott Bessent

Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor des États-Unis, n'avait pour toute expérience politique que la collecte de fonds qu'il a organisée pour Al Gore en 2000 avant d’intégrer l’administration Trump. En tant que gestionnaire de fonds spéculatifs, il a toutefois une certaine expérience des gouvernements, puisqu’on lui doit d’avoir “cassé” la Banque d'Angleterre en pariant contre la livre sterling en 1992. À l’époque, il était partenaire du Soros Management Fund et donc associé de Georges Soros, dont les activités philanthropiques figurent parmi les principales cibles des campagnes anti-wokedu MAGA, et dont le nom constitue un déclencheur de la haine antisémite au sein du mouvement.
Lorsqu’il quitte le Soros Management Fund, Scott Bessent cofonde, en 2015, le Key Square Group. C’est là qu’il embrasse plus résolument les causes libertariennes chères à la communauté des fonds spéculatifs. En 2024, il figure parmi les plus grands soutiens financiers de Donald Trump, faisant don d'un million de dollars au MAGA Super PAC et de 100 000 dollars à Right for America, un autre Super PAC trumpiste. Il organise également deux collectes de fonds pour sponsoriser la campagne du candidat républicain, l'une chez lui à Greenville, en Caroline du Sud, qui permet de récolter près de 7 millions de dollars, et l'autre à Palm Beach, en Floride, qui lève 50 millions de dollars.
Lors de son audition de confirmation, Bessent a fait l'éloge de la politique fiscale qu'il a été chargé de mettre en œuvre, et bien qu’il ne soit pas taillé pour le rôle, il s’est efforcé de lui donner une coloration populiste : “Si nous ne renouvelons pas ces réductions d’impôts, prévient-il, nous serons confrontés à une calamité économique et, comme toujours, à une instabilité financière qui touchera avant tout les classes moyennes et ouvrières”.
Le “jour de la libération”, la frénésie tarifaire de Donald Trump met Bessent visiblement mal à l’aise. Malgré tout, il s’applique discrètement à réconcilier les positions mercantilistes de son patron avec les préférences de Wall Street. D'où le discours, soigneusement élaboré, qu’il livre le 23 avril 2025, lors de la réunion de printemps du FMI, devant les représentants des principaux partenaires des États-Unis. Cherchant à les rassurer, il insiste sur le fait que le but de l’administration Trump n’est pas de détruire, mais plutôt de réformer les institutions internationales tels que le FMI et la Banque mondiale : “L'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule”, soutient-il.
Dans le même temps, Scott Bessent n’a pas manqué de rappeler à son auditoire que l’heure était venue pour le FMI et la Banque mondiale de “prendre du recul par rapport à leurs programmes tentaculaires et non ciblés qui ont étouffé leur capacité à remplir leurs missions fondamentales”. Autrement dit, le FMI doit cesser de consacrer “un temps et des ressources disproportionnés au changement climatique, au genre et aux questions sociales", tandis que “la Banque mondiale doit répondre aux priorités et aux besoins énergétiques des pays en se concentrant sur des technologies fiables, aptes à soutenir la croissance économique, plutôt que de chercher à atteindre des objectifs de financement de la préservation du climat qui ne font que créer des distorsions”.
Patrick Buchanan

Selon ses apologistes, Patrick Buchanan n’est ni raciste ni antisémite. Il tient simplement des propos racistes et antisémites. En tant qu’ancien rédacteur de discours et commentateur politique, Buchanan a certes eu recours aux mots pour gagner sa vie. Il serait toutefois injuste de suggérer que son racisme relève d’un rôle de composition destiné aux plateaux de télévision.
Au sujet des questions de race aux États-Unis, Richard Nixon, qui l’employait à l’époque, a résumé l’opinion de son conseiller politique par la formule “ségrégation pour toujours”. Quant aux juifs, les déclarations de Buchanan selon lesquelles Treblinka n’aurait pas été un camp d’extermination relève clairement de la négation de l’Holocauste – sans parler de ses propos élogieux à l'égard d'Hitler. Comme l’a fait remarquer le commentateur conservateur Charles Krauthammer, “ce qui est intéressant [avec Buchanan], c’est qu’il peut dire ce genre de choses et rester une figure nationale”.
Même ses partisans les plus fervents n’ont jamais prétendu que ses diatribes homophobes, xénophobes et sexistes ne reflétaient pas sa vraie nature. Au mieux, ils ont justifié ses sorties sur l’épidémie du SIDA – une revanche de la nature contre les pratiques homosexuelles –, l’immigration – une menace existentielle – et le rôle des femmes – “construire le nid” comme “Maman Oiseau” – par son obédience religieuse : ces opinions ne seraient pas tant les siennes que celles du Dieu qu’il vénère.
Né à Washington en 1938, Patrick Buchanan a été élevé dans une famille catholique traditionaliste. Son arrière-grand-père a combattu sous le général Robert E. Lee, et il reste un fier membre des Fils de Vétérans Confédérés. Bagarreur et harceleur dans sa jeunesse – ses voisins juifs étaient sa cible favorite – “Pat” finit par mûrir, fait ses études à l’école de journalisme de Columbia et commence sa carrière de journaliste au Saint-Louis Globe-Democrat.
En 1966, Buchanan est recruté par l’équipe de campagne de Richard Nixon pour rédiger les discours ciblant la base électorale conservatrice du candidat républicain. Entre autres prouesses, Buchanan forge alors l’expression “majorité silencieuse”. Après la victoire électorale, il devient assistant et rédacteur de discours à la Maison Blanche, conserve son poste jusqu’à la démission de Nixon lors de son second mandat, Fidèle à son patron jusqu’à la fin, il va même même jusqu’à exhorter le président à brûler les enregistrements du Watergate pour rester au pouvoir.
Lors de l’arrivée au pouvoir de Gerald Ford, la nouvelle administration envisage brièvement de nommer Buchanan ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, le pays de l’apartheid. Toutefois, en raison de ses inclinations ségrégationnistes et de son enthousiasme excessif à l’idée d’obtenir le poste, le Département d’État finit par faire marche arrière. Temporairement retiré de la politique, Buchanan entame alors une longue et fructueuse carrière de commentateur dans les médias, d’abord à la radio NBC, puis à la télévision, où il rejoint successivement les émissions The McLaughlin Group diffusée sur NBC, puis Crossfire et The Capital Gang sur CNN. Dans ces émissions populaires, Buchanan tient le rôle du conservateur chargé de débattre avec un progressiste.
Le rhéteur de plateaux télévisés revient à la Maison Blanche en 1985 en tant que directeur de la communication de Ronald Reagan. Au cours de son mandat de deux ans, Buchanan joue un rôle clé dans l’organisation de la visite du président au cimetière allemand de Bitburg, où sont enterrés 48 membres de la Waffen SS. Tout en défendant la décision de l’administration face à l’indignation générale pendant ses journées de travail, le directeur de la communication utilise également son temps libre pour s’opposer à la déportation de criminels de guerre nazis présumés vers des pays du bloc de l’est. Pour Buchanan, honorer le sacrifice de la Wehrmacht et déjouer les plans des “chasseurs de nazis obsédés par la vengeance” sont les deux facettes d’une même mission – que son arrière-grand-père aurait sûrement approuvée.
Après avoir quitté l’administration Reagan et être retourné à ses activités de commentateur, Buchanan se sent plus libre de défendre ouvertement ses causes favorites. En 1989, par exemple, il rend un nouvel hommage à son ancêtre confédéré en écrivant une chronique sur l’affaire dite des “Central Park Five” : dans son article, il appelle à la pendaison publique d’au moins un des adolescents noirs accusés à tort d’avoir violé une joggeuse blanche.
À peu près à la même époque, Pat commence à encourager sa sœur Bay, qui a aussi travaillé pour l’administration Reagan, à poursuivre l’initiative “Buchanan for President” qu’elle a fondée. Le programme de la fratrie comportait deux volets.
Sur le plan intérieur, Buchanan fustige la politique d’ouverture des frontières prônée par l’aile globaliste du Parti républicain – ou au moins par les contributeurs des pages éditoriales du Wall Street Journal : l’immigration massive en provenance de pays non-européens, avertit-il, mettrait fatalement en péril le tissu culturel et moral des États-Unis.
En matière de politique étrangère, l’ancien rédacteur de discours soutient que la fin de la guerre froide devrait également marquer la fin de l’engagement militaire américain dans le monde entier. D’où son opposition farouche à la guerre du Golfe en 1990, qui l’a poussé à se présenter contre George H.W. Bush deux ans plus tard.
Lors des primaires républicaines de 1992, Buchanan se présente en tant que candidat paléoconservateur : il s’oppose au président sortant, qu’il accuse de poursuivre un agenda libéral et impérialiste. Selon Buchanan, Bush n’a pas seulement manqué d’honorer son engagement de ne mettre en place “aucune nouvelle taxe”, mais plus important encore, son administration n’a pas réussi à freiner l’immigration, à entraver l’accès des femmes à l’avortement et à supprimer les droits des homosexuels. Par ailleurs, ajoute-t-il, le lobby juif et ses relais néoconservateurs ont été autorisés à dicter les termes de la politique étrangère américaine.
Buchanan n’a pas remporté l’investiture, mais a tout de même obtenu près d’un quart des voix. À l’occasion de la convention républicaine, il a également délivré son célèbre discours sur la “guerre culturelle”, dans lequel il clame que l’Amérique est engagée dans une lutte décisive pour le salut de son âme, ayant le choix entre rester “le pays de Dieu”, ou s'enfoncer davantage dans la voie libérale et multiculturelle du déclin moral. Bien que certains commentateurs aient attribué la défaite républicaine à l'élection présidentielle à l'effet dissuasif de l'éloquence de Buchanan, le tribun paléoconservateur persistera. Après son retour à Crossfire, il crée une fondation appelée American Cause afin de se préparer pour sa prochaine candidature. Aux primaires de 1996, il se présente contre Bob Dole et est battu une nouvelle fois.
Après cette seconde tentative, Buchanan commence à désespérer du Parti républicain, qu’il quitte en 1999. L’année suivante, il est le candidat du Parti de la réforme. Alors que sa campagne échoue lamentablement, il joue involontairement un rôle décisif dans la victoire controversée de George W. Bush. À Palm Beach, en Floride, environ 2000 bulletins Al Gore, le candidat démocrate, lui ont été crédités par erreur. La Cour Suprême conservatrice ayant rejeté la demande de recomptage des voix formulée par Al Gore, son adversaire a été déclaré vainqueur en Floride, ce qui lui a octroyé suffisamment de grands électeurs pour devenir président.
Après 2000, Buchanan abandonne la course à la présidence et quitte CNN pour MSNBC, où il est l’un des rares éditorialistes à s’opposer à la décision de Bush d’envahir l’Irak. Il défend de plus en plus ouvertement ses causes préférées : dans l’une de ses chroniques, il déclare ainsi que le Royaume-Uni n’aurait pas dû déclarer la guerre à l’Allemagne nazie, tandis que dans son ouvrage Suicide of a Superpower, il déplore explicitement le déclin de la suprémacie blanc en Amérique. Malgré cela, ce n’est qu’en 2011 que MSNBC se décide à mettre fin à son contrat.
Cinq ans plus tard, Donald Trump remporte l’élection présidentielle, sur un programme qui fait largement écho à celui de Buchanan. Ce dernier a évidemment apporté son soutien au candidat MAGA, même si le succès de Trump a dû avoir un goût amer pour le vétéran de la guerre culturelle – qui a continué à écrire des articles, principalement pour VDARE, le site web du suprémaciste blanc Peter Brimelow, jusqu’en 2023.
En dépit des similitudes entre leurs programmes, l’étendue de l’influence réelle de Buchanan sur le 47ème président reste sujette à débat. Ce que sa carrière florissante révèle cependant, c’est que bien avant Trump, les médias grand public et l’establishment politique de Washington étaient déjà prêts à accueillir un ségrégationniste décomplexé et un sympathisant d’Hitler comme l’un des leurs.
Les frères Koch
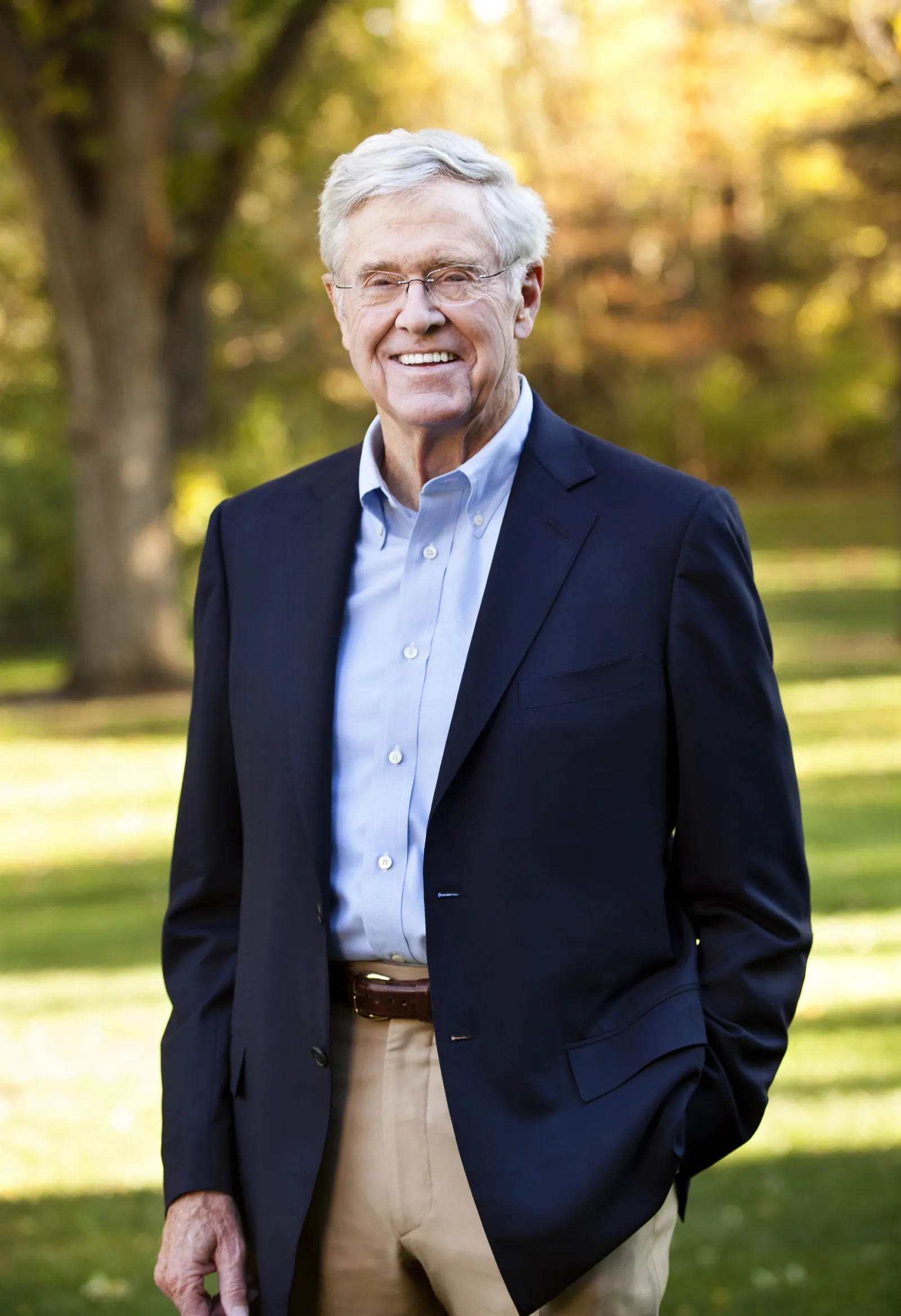
Charles (né en 1935) et David (1940-2019) Koch, généralement appelés les “frères Koch”, sont les héritiers de la firme de leurs parents, Koch Industries, la deuxième plus grande société privée des États-Unis. Charles est président du conseil d'administration et codirecteur général depuis 1967, tandis que David était vice-président exécutif.
Tirant leur immense richesse de cet empire pétrolier - leur père a inventé un nouveau procédé de raffinage du pétrole - les frères Koch ont consacré leur temps et leur capital personnel à la promotion des idées libertariennes en politique. Au fil des ans, leur stratégie est passée du soutien aux institutions libertariennes existantes au déploiement de leur propre réseau politique pour innerver la politique conservatrice américaine de libertarianisme.
Au début de leur engagement, ils soutiennent économiquement et publiquement le parti libertarien - David s'est présenté comme vice-président pour le candidat du parti à l’élection présidentielle de 1980. Dans les années 1980, ils commencent également à financer des think tanks libertariens tels que le Cato Institute et le Mercatus Center, et à parrainer des programmes et des bourses universitaires par l'intermédiaire de la Fondation Charles G. Koch, afin d’encourager les recherches visant à documenter l’impact négatif de toute mesure sociale, collectiviste ou redistributive sur l’économie de marché. En 1984, ils fondent leur propre organisation, Citizens for a Sound Economy (Citoyens pour une économie saine), afin d'exercer un lobbying direct en faveur des réductions d'impôts et de la déréglementation pour le compte de leurs entreprises clientes.
Pendant les présidences de Bush père et d'Obama, ils ont massivement soutenu l'association 60 Plus qui menait campagne contre les politiques gouvernementales en matière de sécurité sociale et de programmes de santé. À partir de 2003, les frères ont également favorisé la mise en réseau des riches donateurs en organisant des séminaires semestriels avec des conférences économiques sur le libre marché et sur les stratégies politiques libertariennes, ainsi que des sessions “en tête-à-tête” avec les dirigeants et les donateurs de l'organisation Koch. En y conviant des candidats et des membres du GOP, les frères Koch ont ainsi amorcé leur opération d'influence sur le Parti républicain, entreprise qu'ils ont poursuivie avec la création du réseau Americans for Prosperity (AFP) en 2004.
Cette organisation, présente dans 36 États, combine publicité, lobbying et agitation populaire pendant et entre les cycles électoraux - son site web affirme qu'elle compte plus de 4 millions de membres sur tout le territoire américain. Au cours des 20 dernières années, l'AFP a pris de l'importance et a œuvré à faire pencher l'agenda républicain toujours plus vers la droite. Notamment en raison de la porosité entre le réseau d’influence et le Parti Républicain lui-même. Ainsi, comme l'ont montré les chercheurs Skocpol et Hertel-Fernandez, une large partie des directeurs et des salariés de l'AFP garnissent, avant ou après leur prise de poste, les rangs des états-majors du parti de Donald Trump, où ils ont alors tout le loisir d’imprimer leur vision idéologique du monde dans le programme politique républicain1. Ces portes tambour leur ont permis d’engranger de plus en plus de victoires législatives.
Si les frères Koch tentent sans relâche depuis près de 50 ans d’influer sur les élections américaines, c’est depuis 2010 et leur financement massif du Tea Party pour tenter de défaire le “socialiste” Barack Obama, que leur impact sur le processus politique a commencé à prendre une ampleur aussi tentaculaire que décisive. Chantres précoces du libertarianisme, climatosceptiques convaincus et pourfendeurs de la démocratie, Charles et David Koch ont investi, au fil des années, des centaines de millions de dollars dans l’extrême-droitisation du paysage politique américain, jusqu’à obtenir le retour sur investissement que l’on sait aujourd’hui.
1 Skocpol T, Hertel-Fernandez A. The Koch Network and Republican Party Extremism. Perspectives on Politics. 2016;14(3):681-699. doi:10.1017/S1537592716001122
David Sacks

Nommé “Tsar de l’IA et de la crypto de la Maison Blanche” par Donald Trump en décembre 2024, David Sacks est un entrepreneur et un investisseur de la Silicon Valley sans aucune expérience gouvernementale préalable. Membre de la première heure de la mafia PayPal - il était directeur des opérations (COO) quand eBay a racheté PayPal en 2002 -, il est resté proche d’Elon Musk et de Peter Thiel qui, comme lui, sont nés en 'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid.
Paléo-libertarien de longue date - il a coécrit The Diversity Myth : Multiculturalism and the Politics of Intolerance avec Peter Thiel en 1995 -, Sacks a récemment joué un rôle notable dans la dérive droitière de la Silicon Valley grâce à son podcast sur le business et la technologie All-In - 766 000 abonnés sur YouTube -, qu'il co-anime avec trois autres investisseurs en capital-risque, Jason Calacanis, Chamath Palihapitiya et David Friedberg.
C’est grâce à son amitié avec J.D. Vance que Sacks se rapproche d’abord de Donald Trump. En juin 2024, il organise une collecte de fonds qui recueille 12 millions de dollars pour le financement de la campagne du candidat républicain. Ses missions gouvernementales en tant que tsar de l'IA et des cryptomonnaies n'ont pas été précisément définies par le président des États-Unis, mais l’idée générale est claire: il s’agit de lever toute forme de réglementations contraignantes impactant ces deux technologies censément cruciales pour rendre à l’Amérique sa grandeur. Sacks est un “employé spécial du gouvernement”, un statut qui lui permet d’en être membre sans avoir ni à se soumettre à des audiences de confirmation, ni à divulguer ses états financiers. Par conséquent, il restera gérant associé de Craft Ventures, le fonds de capital-risque qu'il a cofondé.
Michael Jensen
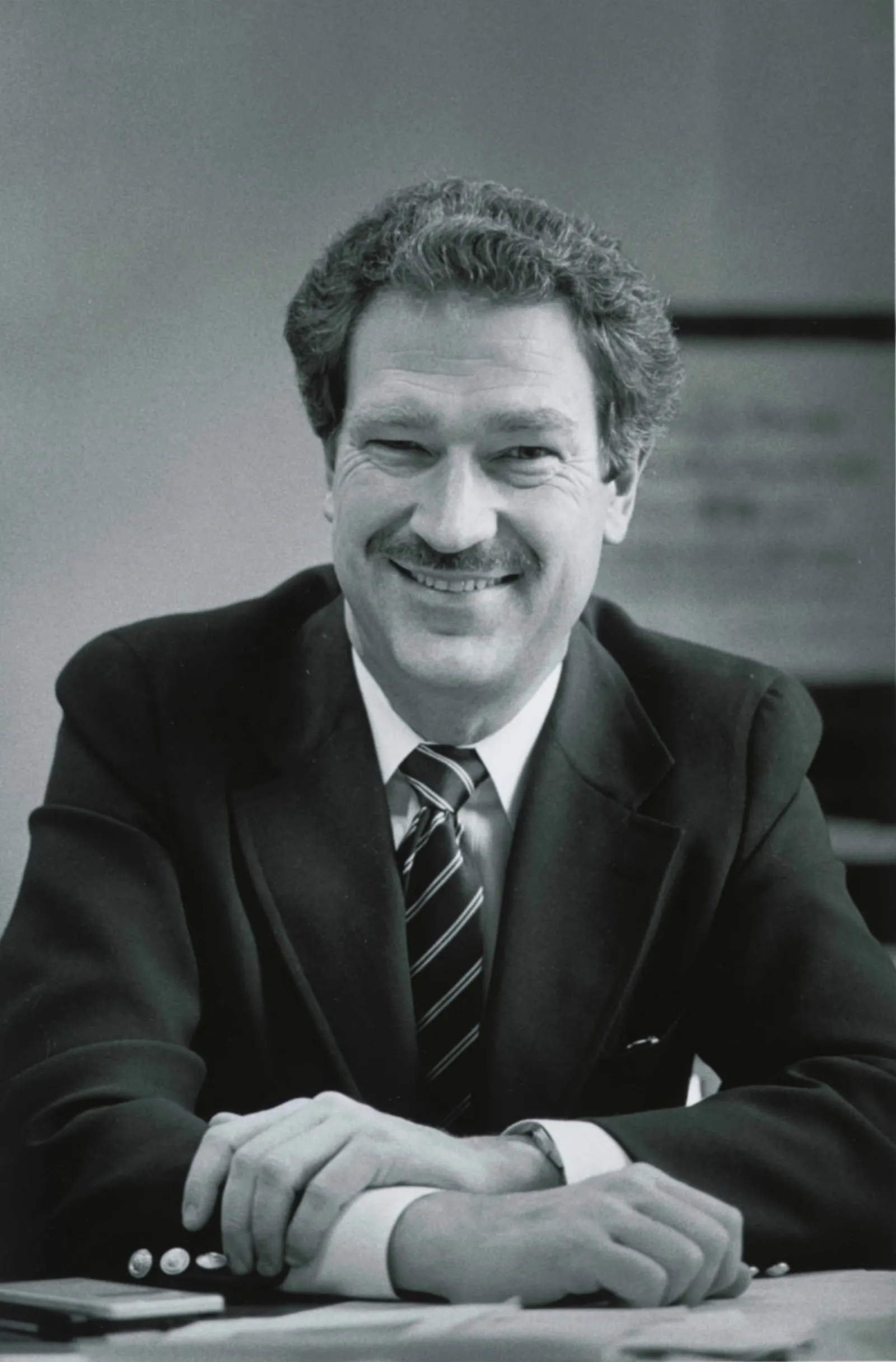
Dans leur article traitant de l'influence de la théorie de l'agence sur les pratiques des conseils d'administration, des analystes et des gestionnaires de fonds, les sociologues Jiwook Jung et Frank Dobbin écrivent que “les théories économiques fonctionnent autant comme des prescriptions comportementales que comme des descriptions. Les économistes et les théoriciens du management, ajoutent-ils, agissent souvent comme des prophètes plutôt que comme des scientifiques, décrivant le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être1 ». Michael Jensen illustre parfaitement cette affirmation : plus que pour décrire le fonctionnement d'une firme ou même pour anticiper un changement dans la gouvernance d'entreprise, on peut lui reconnaître le mérite d'avoir contribué à la réalisation de ses propres prophéties.
Né dans le Minnesota en 1939, « Mike » Jensen, décédé en 2024, a été formé à la Chicago University School of Business, où il a obtenu un MBA en 1964 et un doctorat en 1968. Deux ans plus tard, Milton Friedman publiait dans le New York Times Magazine son célèbre éditorial intitulé “La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits”. S'insurgeant contre cette responsabilité sociale qu'il considérait comme une voie directe vers un “socialisme pur et dur”, Friedman rejetait l'idée que les dirigeants d'entreprise soient responsables devant l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qui les employait. Selon l'économiste, le seul objectif de leur travail était d’engendrer autant de profits qu’il était légalement possible d’en réaliser, non pas pour l'entreprise elle-même mais pour ceux qui les employaient, à savoir les actionnaires de la société.
Jensen a transformé la provocation de Friedman en une doctrine de gestion d'entreprise en 1976, lorsqu'il a coécrit avec William Meckling “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” (Théorie de l'entreprise : comportement managérial, coûts d'agence et structure de propriété). Le point de départ de cet article extrêmement influent était un problème identifié dès 1932 par Adolf Berle et Gardiner Means : la séparation entre la propriété et le contrôle dans les entreprises américaines modernes. Berle et Means avaient expliqué que, comme les sociétés cotées en bourse comptaient généralement une multitude d'actionnaires, le pouvoir était entre les mains des dirigeants salariés. Ces PDG invoquaient avec assurance leur loyauté envers l'entreprise – par opposition aux intérêts particuliers poursuivis par les détenteurs de capitaux, les employés et les consommateurs – afin de légitimer leur pouvoir.
Alors que Berle et Means considéraient l’“entreprise moderne” comme un fait accompli et appelaient donc le gouvernement à contrôler et à réglementer le pouvoir des dirigeants, Jensen et Meckling, suivant l'exemple de Friedman, pensaient que la propriété et le contrôle pouvaient être à nouveau conciliés. Il suffisait, selon eux, de remettre en question l'idée que la société était une personne morale dont les intérêts étaient distincts de ceux des détenteurs de ses actions. Selon les propres termes de Jensen, “c'était le début de l'ouverture de la boîte noire de l'entreprise”. Selon la “théorie de l'agence” de Jensen et Meckling, une entreprise n'était rien d'autre qu'un ensemble de relations contractuelles entre un “principal” – c'est-à-dire les propriétaires du capital – et une grande variété d'”agents”. Ces derniers étaient donc contractuellement tenus d'obéir aux ordres des premiers.
La « théorie de l'entreprise » prétendait délégitimer l'autorité managériale au nom de la démocratie actionnariale : ses auteurs se présentaient avec enthousiasme comme les défenseurs des actionnaires privés de pouvoir menant un combat juste contre des technocrates irresponsables. Leur véritable objectif était toutefois d'écarter la perspective d'une démocratie des parties prenantes, dans laquelle la firme serait responsable devant toutes les personnes concernées par ses activités. Tenant compte de l'avertissement de Friedman, Jensen et Meckling ont estimé que lorsqu'”une entreprise prend au sérieux ses responsabilités en matière d'emploi, de lutte contre la discrimination [et] de prévention de la pollution”, le socialisme n'est pas loin.
Si “Theory of the Firm” présentait des arguments solides contre la “responsabilité sociale des entreprises” – du moins pour les lecteurs du Journal of Financial Economics –, une question pratique subsistait : comment contraindre ou convaincre les dirigeants de servir les intérêts de leur « principal » ? La réponse de Jensen consistait à combiner la carotte et le bâton : d'une part, dans un article intitulé “CEO Incentives: It Is not How Much You Pay but How” (Les rémunérations des PDG : ce n'est pas combien vous payez, mais comment), Kevin Murphy et lui affirmaient que si les PDG étaient rémunérés en stock-options et autres incitations financières liées à la performance, ils finissaient inévitablement par s'aligner sur les intérêts des détenteurs de capital.
D'autre part, afin de dissuader davantage les dirigeants d'entreprise de négliger la poursuite de la valeur actionnariale, Jensen préconisait de les menacer de rachats avec effet de levier (LBO). La crainte de voir des prédateurs financiers prendre le contrôle de l'entreprise avec de l'argent emprunté, écrivait-il dans “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers”, contribuerait grandement à discipliner les agents récalcitrants.
Après avoir enseigné à l'université de Rochester de 1967 à 1986 et fondé le Journal of Financial Economics en 1974, Jensen a rejoint la Harvard Business School en tant que professeur titulaire en 1988. Le cours qu'il dispensait sur “la coordination, le contrôle et la gestion des organisations” a rencontré un immense succès tant auprès des étudiants qui souhaitaient être embauchés par des entreprises de Wall Street, que des partenaires de ces entreprises, qui ont montré leur gratitude en finançant généreusement la Harvard Business School. Jensen a alors été reconnu comme le champion infatigable de la valeur actionnariale, des rachats par effet de levier, des stock-options et des parachutes dorés.
Cependant, au milieu des années 2000, alors que Wall Street s'enfonçait de plus en plus dans les scandales et les faillites frauduleuses – d'Enron à Lehmann Brothers –, Jensen a en quelque sorte changé d'avis. Tout en restant attaché à sa conception de l'entreprise, il se plaignait que le monde des affaires soit gangréné par des failles morales : “Les stock-options”, se lamentait-il dans une interview au New Yorker, sont devenues “l'héroïne des managers”. Après avoir pris sa retraite de Harvard, Jensen a rencontré Werner Erhard, gourou du développement personnel et fondateur de l'EST. Ensemble, ils ont lancé en 2012 une initiative ontologique/phénoménologique baptisée Erhard/Jensen, dont l'objectif était d'organiser des séminaires d'une semaine sur “l'intégrité”, principalement dans des stations balnéaires.
Pete Hegseth

Pete Hegseth n’est pas pour rien le secrétaire à la Défense de Donald Trump. Lorsqu’il était co-animateur de Fox & Friends,l’une des émissions préférées de Trump, Hegseth n’a pas seulement réussi à persuader celui qui était alors le 45ème président des États-Unis de gracier trois soldats américains inculpés pour crimes de guerre en Afghanistan et en Irak (en 2019). Il a également imité son patron actuel en achetant le silence d'une femme qui l’accusait de viol (en 2017). Plus largement, Hegseth correspond en tout point à l’image que la nouvelle administration Trump se fait d’un secrétaire à la Défense.
Premièrement, après avoir servi trois fois dans l’armée (2003-2006, 2010-2014, 2019-2021), notamment en tant que garde national à la prison de Guantanamo, puis comme volontaire en Irak et en Afghanistan, il a démissionné de ce qu'il appellera plus tard une “armée woke” lorsqu'on lui a interdit d'assister à l'investiture de Joe Biden en raison de son tatouage Deus vult - une référence aux Croisades, signe notoire d'allégeance à l'extrême-droite nationaliste chrétienne.
Deuxièmement, “nationaliste chrétien” est précisément la façon dont Hegseth se définit lui-même. C’est à ce titre qu’il attribue le déclin de la “gloire” de l'armée américaine aux politiques DEI (Diversité, Équité, Inclusion) et qu’il mise sur le renvoi des soldats transgenres, l'exclusion des femmes des postes de combat et la réduction drastique du nombre d'officiers non blancs et non chrétiens pour restaurer cette gloire. Récemment, ne serait-ce que pour rendre ses intentions plus claires, il a décidé d'introduire un “service de prière et de culte chrétien du secrétariat à la Défense” dans l'auditorium du Pentagone - un événement mensuel destiné à louer Dieu, mais aussi Donald Trump, le leader que le Seigneur a donné aux États-Unis.
Troisièmement, en matière de gestion, l'approche de Pete Hegseth est également inspirée par celle de l'homme qu'il sert. Au milieu des années 2010 - avant de devenir animateur à plein temps sur Fox News - le secrétaire à la Défense a été contraint de démissionner des “deux groupes de défense à but non lucratif qu'il dirigeait - Veterans for Freedom et Concerned Veterans for America - face à de graves allégations de mauvaise gestion financière, d'inconvenance sexuelle et de mauvaise conduite personnelle1”.
Enfin, depuis sa nomination à la tête du Département de la Défense, Hegseth a fait preuve d’une conception des frontières entre sphères privée et professionnelle elle aussi inspirée des pratiques de la galaxie Trump. À l’approche d’une opération de bombardement au Yémen, il n’a pas su résister à l'envie de partager des informations sensibles avec un journaliste de The Atlantic, lors d’une conversation sur Signal, et d’inviter sa femme à plusieurs réunions confidentielles. Toutefois, davantage que son comportement irresponsable, ce qui est le plus frappant dans cette affaire, reste l'empressement de Hegseth à se vanter de la mort imminente de civils yéménites.
1. Jane Mayer, “Pete Hegseth’s secret history”, The New Yorker, December 1, 2024.
Philip Hamburger
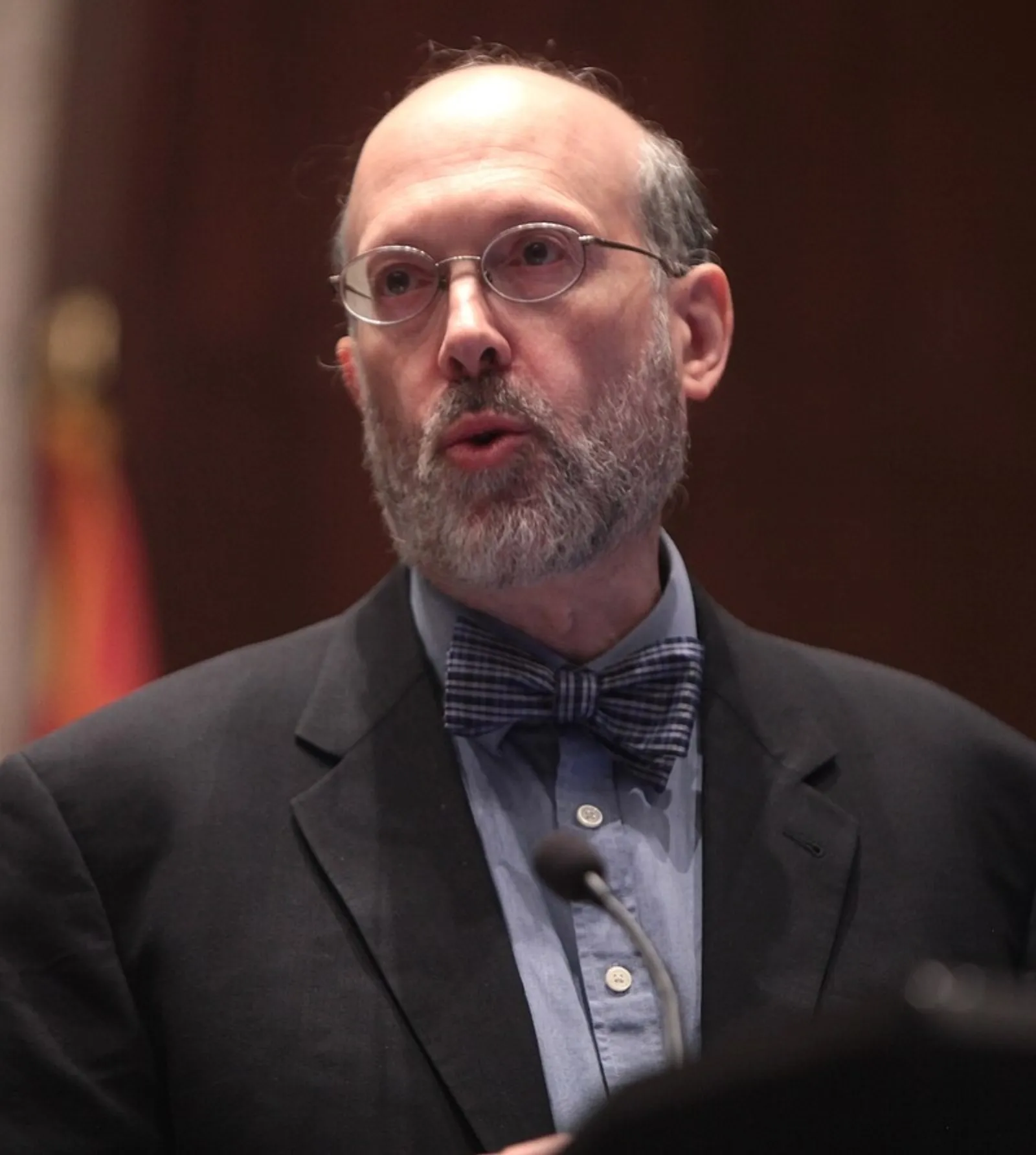
Professeur de droit constitutionnel et d’histoire du droit à l’Université Columbia, Philip Hamburger s’impose comme l’un des principaux pourfendeurs de la “tyrannie” de l’État administratif américain. En 2014, il fonde au sein de la faculté de droit de Columbia le Center for Law and Liberty, un centre de recherche consacré aux menaces que des penseurs paléolibertariens tels que lui identifient comme les plus graves pour la liberté individuelle. Ces menaces englobent aussi bien les comités d’éthique universitaire, qui encadrent les critères de validité de la recherche scientifique, que la surveillance des contenus par les grandes entreprises technologiques, accusées de pratiques de censure et d’hostilité systématique à l’égard du discours religieux.
Trois ans plus tard, alors que Donald Trump entre en fonction, Hamburger fonde et prend la direction de la New Civil Liberties Alliance (NCLA), une organisation à but non lucratif officiellement non partisane, mais largement financée par Charles Koch et Leonard Leo. Comme le suggèrent les noms de ses principaux mécènes, la NCLA s’est donnée pour mission de “protéger les libertés constitutionnelles contre les abus de l’État administratif”. Les avocats de l’organisation intentent régulièrement des actions contre la Securities and Exchange Commission (SEC) et l’Environmental Protection Agency (EPA), qu’ils accusent de confisquer illégitimement des prérogatives relevant du pouvoir exécutif. Par ses interventions militantes autant que par ses travaux académiques, Hamburger est devenu l’un des architectes intellectuels de la conception trumpienne des libertés publiques.
L’un de ses principaux combats, qu’il développe dès 2002 dans Separation of Church and State puis en 2018 dans Liberal Suppression, porte sur ce qu’il considère comme une lecture abusive du Premier Amendement. Selon lui, interpréter la protection constitutionnelle de la liberté d’expression comme fondement juridique de la séparation de l’Église et de l’État relève d’une déformation de la Constitution, ancrée dans une tradition anticatholique de longue date. Loin de protéger la liberté religieuse contre les empiètements du pouvoir, les tribunaux auraient ainsi permis à l’État de contrôler l’expression des croyances religieuses et de les reléguer dans la sphère privée. Dans Liberal Suppression, sous-titré Section 501(c)(3) and the Taxation of Speech, Hamburger avance également que le retrait du statut fiscal d’exonération aux organisations caritatives refusant d’abandonner des pratiques jugées discriminatoires au regard des normes adoptées après le mouvement des droits civiques constitue une atteinte caractéristique à la liberté religieuse, relevant d’un véritable État policier. À ses yeux, les constituants avaient précisément voulu garantir à la liberté religieuse une protection absolue.
La contribution sans doute la plus décisive de Hamburger à l’élaboration de l’agenda de l’extrême droite réside toutefois dans la défense radicale qu’il propose de la théorie de l’exécutif unitaire. Cette doctrine, aujourd’hui majoritairement adoptée par les juges de la Cour suprême présidée par John Roberts, soutient que l’intégralité du pouvoir exécutif est concentrée entre les mains du président. Ses partisans, tels le juge Antonin Scalia, affirment qu’en tant qu’”unique individu constituant à lui seul une branche de gouvernement1”, le président détient non pas une partie, mais la totalité du pouvoir exécutif. Cette théorie implique que le chef de l’État puisse révoquer à sa discrétion tout fonctionnaire de l’exécutif fédéral, qu’il ait été nommé par ses prédécesseurs ou par lui-même.
Dans son ouvrage Is Administrative Law Unlawful?, publié en 2014, Hamburger s’attaque à l’arrêt unanime Humphrey’s Executor v. United States de 1935, qui reconnaît aux agences administratives des compétences “quasi-législatives” et “quasi-judiciaires” dans le cadre des missions que leur confie le Congrès, qu’il s’agisse de protection de l’environnement ou de mise en œuvre des droits civiques. Pour le professeur de Columbia, cette délégation des prérogatives normatives et juridictionnelles constitue précisément le mécanisme par lequel un “État profond” s’arroge le contrôle des citoyens sous couvert de protéger leurs libertés et leur bien-être. Pour résister à l’enracinement de ce despotisme administratif qu’il assimile au pouvoir monarchique de l’Ancien Régime, Hamburger préconise paradoxalement de soumettre ces agences à l’autorité exclusive de la Maison-Blanche. Les agents de l’administration publique doivent, selon lui, être considérés comme de simples exécutants des décisions présidentielles.
La lecture qu’il défend de la théorie de l’exécutif unitaire vient d’être récemment consacrée par deux arrêts de la Cour suprême, Loper Bright Enterprises v. Raimondo et Relentless, Inc. v. Department of Commerce, qui ont annulé la doctrine dite de la Chevron deference. Celle-ci imposait jusqu’alors aux tribunaux de s’en remettre aux interprétations juridiques des agences administratives lorsqu’elles appliquent la législation fédérale. Dans son ensemble, l’œuvre de Philip Hamburger incarne ainsi une forme paradigmatique de l’instrumentalisation libertarienne de la liberté, qu’il s’agisse de promouvoir les intérêts des organisations religieuses, de réduire le contrôle public sur les entreprises privées ou de légitimer la concentration autoritaire du pouvoir exécutif.
1 Voir Antonin Scalia’s dissenting opinion in Morrison, Independent Counsel vs. Olson et al., 1987: https://tile.loc.gov/storage-s...
James M. Buchanan

Né en 1919, James McGill Buchanan grandit dans le Tennessee rural. Son grand-père, ancien gouverneur de l’État élu sous la bannière de l’Alliance des agriculteurs, avait transmis à la famille un nom chargé de prestige. Lorsque James vient au monde, celle-ci a toutefois perdu à la fois son influence politique et ses ressources économiques. Encouragé à restaurer le renom des Buchanan, il s’engage alors dans une brillante carrière universitaire qui le mène à l’Université de Chicago, où il est admis en doctorat d’économie.
À son arrivée, il est encore marqué par le populisme hérité de son grand-père, mais se convertit rapidement, selon ses propres termes, du socialisme à l’orthodoxie pro-marché de ses maîtres, au premier rang desquels Frank Knight, ainsi que les jeunes professeurs de l’époque, tels Milton Friedman et Friedrich Hayek. Ce dernier reconnaît immédiatement le potentiel du jeune chercheur et le fait intégrer la Société du Mont Pèlerin. Après avoir obtenu son doctorat, Buchanan enseigne successivement au Tennessee et en Floride, avant de rejoindre, en 1957, l’Université de Virginie, où il fonde avec Gordon Tullock le Jefferson Center for Studies in Political Economy and Social Philosophy.
Grâce au financement du très conservateur Volker Fund, le Centre devient rapidement l’un des principaux foyers de la pensée néolibérale aux États-Unis. Partageant avec ses collègues la volonté de discipliner la démocratie et de restreindre la capacité des gouvernements élus à lever l’impôt et à dépenser, Buchanan entreprend d’étendre au domaine politique l’analyse du comportement humain développée par l’école de Chicago. Sa théorie du choix public, qui lui vaut le prix Nobel d’économie en 1986, visait à légitimer l’agenda néolibéral en démontrant que les élus et les fonctionnaires poursuivaient, comme tout un chacun, des intérêts propres. Derrière l’apparente vocation au service de l’intérêt général, ils n’agissaient, selon lui, que comme des maximisateurs rationnels, soucieux de leurs propres personne et avenir.
Selon Buchanan, la spécificité des responsables politiques résidait à la fois dans les illusions largement répandues quant à leurs motivations et dans le pouvoir largement incontrôlé dont ils jouissaient, qu’ils le justifient par le mandat démocratique ou par leur statut de fonctionnaires. Pour contrer ces tendances prédatrices, il proposait de limiter l’autorité de la souveraineté populaire en encadrant constitutionnellement le recours au déficit budgétaire et en multipliant les procédures exigeant des super-majorités parlementaires, tout en soumettant les fonctionnaires à des critères de performance et de concurrence analogues à ceux du secteur privé.
Exposée dans The Calculus of Consent, ouvrage coécrit avec Gordon Tullock et publié en 1962, sa théorie connaît un succès académique considérable et attire d’importants financements. Toutefois, dès le milieu des années 1960, l’administration de l’Université de Virginie manifeste ses inquiétudes face à l’orientation idéologique rigide du Jefferson Center. En réaction, Buchanan décide de dissoudre le Centre et quitte l’université. En 1968, il rejoint le département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles, où il est profondément troublé, voire radicalisé, par l’activisme étudiant qu’il y découvre.
Jusqu’alors persuadé qu’une large majorité des électeurs américains demeurait attachée aux droits de propriété, aux valeurs familiales et au fédéralisme authentique, et qu’elle limiterait spontanément l’expansion de l’État-providence, Buchanan devient soudain plus pessimiste mais aussi plus résolu. Son séjour californien le convainc que le maintien de l’ordre libéral suppose des limitations constitutionnelles renforcées du pouvoir majoritaire. Faute de telles barrières, explique-il dans The Limits of Liberty, le système électoral favorisera inévitablement les bénéficiaires des aides sociales, des politiques de discrimination positive et des privilèges syndicaux, au détriment des propriétaires et des entrepreneurs. Il comprend en outre que ces réformes ne pourront voir le jour qu’à condition de s’appuyer sur un puissant mouvement social en leur faveur. C’est ainsi qu’il s’engage activement, en tant qu’intellectuel organique, dans la révolte fiscale californienne de la fin des années 1970.
Après avoir quitté UCLA en 1969, Buchanan retourne en Virginie et fonde avec Tullock un nouveau Center for Study of Public Choice au Virginia Polytechnic Institute. Ses relations avec la Californie ne s’interrompent cependant pas. En 1972, il intègre le Tax Reduction Task Force convoqué par Ronald Reagan, alors gouverneur de l’État. Selon Buchanan, si une personnalité de l’envergure nationale du gouverneur Reagan acceptait de prendre la tête du mouvement, on pourrait enfin espérer lancer une révolution des contribuables.
L’idée sous-jacente à cette révolution fiscale reposait sur la conviction que l’expansion continue des impôts progressifs et des dépenses publiques financées par le déficit susciterait davantage de ressentiment que de soutien. Au lieu de profiter des prestations sociales et des services publics, un nombre croissant de citoyens finiraient par estimer que le fruit de leur travail était confisqué au profit de groupes rentiers composés d’allocataires assistés, de fonctionnaires surprotégés et paresseux, de syndicalistes privilégiés et d’enseignants ou intellectuels publics jugés déconnectés et condescendants. Une fois mobilisés contre cet État perçu comme parasitaire, les contribuables pourraient devenir les nouveaux révolutionnaires, à l’image de ceux qui avaient porté son grand-père au pouvoir, mais désormais pour exiger des réformes néolibérales destinées à défendre les producteurs contre les preneurs.
La vision de Buchanan est confirmée par le succès des référendums sur la proposition 13 en 1976 et sur la proposition 4 l’année suivante. Ces mesures visent à réduire drastiquement la fiscalité foncière et les budgets des collectivités locales, tout en imposant qu’une majorité des deux tiers dans les deux chambres de l’État soit désormais requise pour toute modification de la politique fiscale californienne. En 1980, l’élection triomphale de Ronald Reagan à la présidence ouvre la possibilité d’étendre cette dynamique à l’échelle nationale. En 1983, Buchanan transfère son Center for Study of Public Choice à la George Mason University, bénéficiant du soutien financier des frères Koch. À la tête de ce que le Wall Street Journal qualifie de Pentagone de l’université conservatrice, il demeure jusqu’à sa mort en 2014 un infatigable promoteur des réformes constitutionnelles néolibérales, plaidant aussi bien pour un amendement d’équilibre budgétaire que pour l’abolition de la sécurité sociale, qu’il assimilait à un système de Ponzi. Si ces propositions échouèrent systématiquement au niveau fédéral, ses attaques répétées contre la prodigalité de l’État continuent d’influencer la législation de la majorité des États américains, dont quarante-quatre exigent aujourd’hui encore l’adoption de budgets en équilibre.
Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti occupe une position singulière dans l’histoire de la gauche italienne. Fondateur du Parti communiste italien (PCI) et fervent opposant au fascisme, il est aussi l’homme du compromis et de l’abandon des espoirs révolutionnaires après le guerre de résistance.
Ami de Gramsci, il adhère au Parti socialiste italien (PSI) en 1914 et milite à son extrême gauche pour sa transformation en parti révolutionnaire. Face au réformisme du PSI lors des occupations d’usines du biennio rosso, il prend la tangente et participe à la fondation du PCI lors du Congrès de Livourne. Dans les années 1920, Togliatti assume un nombre croissant de responsabilités au sein du parti, et se distingue comme un intermédiaire privilégié entre Moscou et l’Europe. Après l’arrestation de Gramsci devenu secrétaire général du PCI, Togliatti doit lui aussi faire face à la répression. Par chance, il se trouve à Moscou lorsque les principaux dirigeants communistes sont arrêtés. Nommé à la direction du parti, il travaille depuis l’étranger à l’organisation clandestine du PCI et à l’élaboration d’une stratégie pour défaire le fascisme, qui prend progressivement la forme de la "politique des fronts populaires". Son analyse du fascisme comme "régime réactionnaire de masse" est consignée dans le "Cours sur les adversaires" qu’il donne à Moscou au printemps 1935.
Pendant la guerre, le combat antifasciste est étroitement lié à la lutte contre le capitalisme (voir l’encadré sur le Parti d’action dans le chapitre 2). C’est en ce sens que les différents partis de la résistance (PCI, PSI et Partito d’Azione) s’accordent sur un principe de non-compromission avec la monarchie. Les antifascistes demandent l’abdication du roi et la démission du maréchal Badoglio, complices du régime de Mussolini, afin d’éviter que l’effort populaire de résistance ne soit accaparé par l’élite monarchiste.
Pourtant, lorsqu’il rentre en Italie au mois de mars 1944, Togliatti rompt avec la ligne antifasciste et appelle à la formation d’un gouvernement avec le roi et Badoglio. Cette rupture, appelée "Svolta di Salerno", s’explique par les directives qu’il a reçues de Staline dans la nuit du 3 au 4 mars 1944. Elles privilégient les intérêts géopolitiques de l’URSS, c'est-à-dire la consolidation de la puissance de l’Italie face à l’Allemagne et l’Angleterre, plutôt que les intérêts de la classe ouvrière italienne. Là où l’antifascisme aurait pu mener à la construction d’un nouvel ordre politique, le tournant de Salerne neutralise ses aspirations et lui substitue un antifascisme diplomatique, sous la houlette du Parti communiste.
A la Libération, Togliatti se trouve donc à la tête du plus grand parti communiste d’Occident, et semble déterminé à tout mettre en œuvre pour son intégration à la démocratie libérale. L’amnistie qu’il signe le 22 juin 1946 en tant que ministre de la justice, a pour objectif de favoriser la réconciliation italienne après la guerre civile et de stabiliser les institutions de la République. Concrètement, elle absout des milliers de fascistes de leurs crimes de guerre, et leur permet de se maintenir en poste dans l’administration, l’armée et les grandes entreprises. Bien que les crimes aggravés soient théoriquement exclus de l’amnistie, ces exceptions sont très peu appliquées par la magistrature italienne – qui reste issue à 90% de l’administration fasciste. En revanche, les partisans sont poursuivis par les tribunaux, ce qui nourrit un profond ressentiment chez les anciens résistants. Si ce geste permet de comprendre comment s’est opérée la transition italienne du fascisme vers la démocratie, il permet également d’expliquer les survivances du fascisme dans la démocratie. En effet, l’amnistie a permis la renaissance rapide d’un fascisme politique légal, avec la fondation dès 1946 du Mouvement Social Italien. En privilégiant la reconstitution institutionnelle et étatique, Togliatti et le PCI ont participé à un processus d’effacement de la mémoire des crimes fascistes, qui bénéficie durablement à l’extrême-droite italienne.
L’itinéraire de Togliatti, qui restera à la tête du PCI jusqu’à sa mort en 1964, illustre la façon dont l’antifascisme a été rattrapé par des logiques hétérogènes (soviétiques, conservatrices et libérales), et détourné ainsi de son horizon initial.
Beppe Grillo

Beppe Grillo, comptable reconverti en humoriste puis en leader populiste, est une figure importante pour comprendre les mutations du paysage politique dans l’Italie des années 2010. Connu dans toute la péninsule pour ses spectacles satiriques et ses interventions dans des émissions télévisées, il fait rire des stades entiers en critiquant les hommes politiques italiens, qu’il accuse de corruption. Il dénonce le fonctionnement de certaines industries, en n’hésitant pas à faire appel à des spécialistes pour comprendre tous les enjeux et pouvoir entrer dans le détail dans ses sketchs. Pour critiquer la privatisation de Telecom Italia, il en a acheté des parts pour être invité à l’assemblée générale annuelle et y effectuer sa dénonciation devant tous les investisseurs.
La carrière de Beppe Grillo prend un tournant lorsqu’il rencontre Gianroberto Casaleggio au début des années 2000. Venant le rencontrer à la fin d’un de ses spectacles, ce spécialiste de la communication numérique l’encourage à créer un site web pour partager sa vision des choses et de la politique. Le blog de Beppe Grillo, créé en 2004, devient une page Internet incontournable en Italie. Il y écrit pour reprocher aux hommes politiques le coût de leurs dépenses, ainsi que l’absence de renouvellement du personnel politique. Il qualifie ainsi le système politique italien de "gérontocratie". Il dénonce la privatisation des services publics et la corruption qui prend place dans son processus. En 2007, fort de son influence, Grillo appelle à l’organisation d’un "Vaffanculo Day", qui a lieu le 8 septembre. Des milliers de personnes se rassemblent dans toute la péninsule pour recueillir des signatures pour un projet de loi appelé "Parlement propre", en référence à l’épisode des Mani pulite, visant à interdire d'entrée au Parlement les personnes condamnées par la justice et limiter à deux mandats successifs les carrières parlementaires. Alors que 50 000 signatures étaient suffisantes, les grillini en récoltent plus de 300 000.
En octobre 2009, Beppe Grillo fonde le Movimiento V Stelle, "Mouvement Cinq Étoiles". "Ni de droite ni de gauche", le parti adopte une ligne populiste, dans ses méthodes et dans le contenu de ses revendications. Les cinq thèmes principaux de son programme reprennent les thématiques de son blog, et visent à rassembler le maximum d’intéressés en les attirant avec des sujets touchant à leurs conditions matérielles et ayant comme point commun la critique de leur gestion actuelle par le gouvernement : retour à la gestion publique de l’eau, politique zéro déchets, développement des transports publics durables, transition vers les énergies renouvelables, et gratuité du Wi-Fi. Le thème de la corruption est omniprésent, et le libre accès à Internet est présenté comme une manière d’échapper à la propagande politique présentée à la télévision.
Grillo et Casaleggio ont réfléchi à une structure qui pourrait, à leur sens, empêcher la corruption qu’ils dénoncent dans les autres partis politiques. Leur "stratégie de la transparence" stipule que les orientations du parti et les candidats aux élections sont choisis par vote en ligne. Tout est dématérialisé : le mouvement ne possède même pas de siège. Internet, dont ne se sont pas encore totalement emparés leurs concurrents politiques, est leur outil de construction d’une démocratie directe : l’ensemble des statuts du mouvement, les communiqués, les propositions politiques sont disponibles en ligne. Les communications se font presque uniquement sur les réseaux sociaux : jugeant la presse négativement orientée à son égard, le mouvement n’effectue pas de grande annonce via les journaux, et limite les interventions télévisées. Le parti n’a pas de structure hiérarchique. Les candidats doivent avoir la droiture morale dont ils accusent les autres politiques de manquer : les élus du mouvement sont requis d’avoir un casier judiciaire vierge et de s’engager à lutter contre le financement public des partis. Condamné en 1980 pour homicide involontaire de trois personnes suite à un accident de voiture, Beppe Grillo ne pourra ainsi jamais être élu. Loin d’affaiblir son rôle au sein du mouvement, cette mesure augmente en fait sa popularité parce qu’elle est perçue comme un gage de sa sincérité. Par ailleurs, il profite de son pouvoir pour exclure les militants qui le dérangent.
Malgré cette attention portée à la démocratie directe, à la critique de l’ordre établi et l’intérêt pour l’environnement et certains services publics, Beppe Grillo ne défend pas les droits des travailleurs. Précurseur d’un Javier Milei ou d’un Donald Trump, il profite de sa critique du système politique pour critiquer certains aspects de l’État, notamment les aides sociales. Reprenant les discours anti-étatiques de la droite de Berlusconi, il s’oppose à "l’assistancialisme" et critique le pouvoir des syndicats. Le modèle de société qu’il propose est certes respectueux de l’environnement mais repose surtout sur la responsabilité individuelle. Grâce à cette combinaison, Beppe Grillo et le Mouvement V Étoiles réussissent à attirer à droite et à gauche. Rapidement, le mouvement remporte des victoires électorales. Aux élections législatives de février 2013, le parti de Grillo secoue le monde politique en obtenant 25,6% des voix à la Chambre et 23,8% des voix pour le Sénat. Le mouvement envoie ainsi 109 militants à la Chambre et 54 au Sénat. Tous sont inexpérimentés en politique et, dans un premier temps, leur arrivée ébranle les habitués du Parlement. Enrico Letta, président du Conseil entre 2013 et 2014, reconnaît que : "Ça nous a réveillés. Et c'est en grande partie grâce à eux que nous avons choisi des figures nouvelles pour diriger les Assemblées : un ancien magistrat anti-Mafia au Sénat [Pietro Grasso] et une ancienne du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la Chambre [Laura Boldrini]" (1). En 2014, 17 grillini sont élus députés européens — alors que le mouvement avait toujours porté le message anti-UE de son fondateur, qui jugeait les sièges de l’Italie à l’Union européenne trop chers. Aux élections municipales de juin 2016, le Mouvement V Étoiles l’emporte à Rome et à Turin. Le parti de Beppe Grillo profite largement de la crise de la droite italienne, et notamment du conflit qui a lieu depuis 2010 entre Silvio Berlusconi et son ancien bras droit Gianfranco Fini. En 2014, la révélation d’un scandale de marchés publics truqués pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2015 à Milan, dans lequel Berlusconi et le Parti démocrate sont impliqués, renforce la popularité du Mouvement V Étoiles. Aux élections législatives de 2018, il devient le premier parti italien en remportant 32% des voix, et forme un gouvernement de coalition avec la Ligue de Salvini, dont Giuseppe Conte, proche du parti, prend la tête.
Toutefois, l’arrivée du Mouvement V Étoiles au gouvernement marque le début de son déclin. En effet, les incohérences ne tardent pas à se révéler : une fois au pouvoir, le mouvement ne renverse pas les élites traditionnelles. Les promesses antisystème paraissent creuses. Le revenu citoyen universel tant promis par Beppe Grillo est mis en place, mais de manière beaucoup plus réduite que ce qui avait été prétendu. Tandis que les résultats électoraux du mouvement diminuent et que le gouvernement de Conte s’effondre en raison de conflits au sein de la coalition, Beppe Grillo est désavoué par sa base. En novembre 2024, son rôle de "garant" du parti lui est retiré par vote de l’assemblée constituante du mouvement. Il continue néanmoins de prêcher aux convertis en alimentant son blog.
Sources
(1) "L’irrésistible ascension d’un ovni politique", Jérôme Gautheret, Le Monde, 13 mars 2017
"En Italie, la normalisation politique du Mouvement 5 étoiles", Jérôme Gautheret, Le Monde, 17 novembre 2020
"Le temps des frondeurs", Raffaele Laudani, Manière de voir, 1e avril 2021
"L’homme de la semaine : élections législatives en Italie", Philippe Ridet, Le Monde, 7 janvier 2013
"Beppe Grillo navigue sur l’impuissance de la politique", Gaël de Santis, L’Humanité, 21 mai 2014
Gianfranco Fini

Né en 1952, Gianfranco Fini a fait vivre l’héritage du fascisme de Mussolini jusqu’à la fin du 20ème siècle. Journaliste de formation, il a fait ses premières armes au Front de la jeunesse, le mouvement des jeunes du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste fondé en 1946 par des ex-dirigeants de la République de Salò — entre autres — et fréquenté par des anciens membres et des nostalgiques du régime fasciste. Le Front de la jeunesse disposait d’une certaine autonomie par rapport au MSI, et ne prenait pas uniquement la forme d’une organisation institutionnelle. Comme de nombreux mouvements d’extrême droite, notamment ceux qui étaient constitués de jeunes, le Front de la jeunesse utilisait la violence comme mode d’action politique. Dans le contexte des années de plomb, les militants du Front de la jeunesse et des militants antifascistes s’affrontaient régulièrement dans des altercations violentes et parfois mortelles.
Poulain de la figure de proue du MSI, Giorgio Almirante, Fini connaît une ascension rapide au sein du Front de la jeunesse : il en est nommé président par Almirante en 1977, poste qu’il occupe jusqu’en 1988. Il est ensuite élu secrétaire général du MSI. Depuis 1947, le Mouvement social italien fait l’objet d’une exclusion de l’"Arc constitutionnel" : pour tenir à l’écart le fascisme dont le MSI se revendique, tous les partis ont passé un accord pour ne jamais l’inclure dans une alliance électorale et ne jamais en intégrer un membre au gouvernement. Afin d’arriver au pouvoir, le MSI ne peut qu’essayer d’élargir son électorat par ses propres moyens. Convaincu qu’il fallait, pour que le parti gagne en popularité, se concentrer sur la récupération d’une partie de l’électorat de la Démocratie chrétienne — plutôt que d’essayer de recruter des communistes comme le suggéraient certains au sein du MSI —, Gianfranco Fini réoriente la ligne politique du parti vers le centre-droit. Cette stratégie se montrera gagnante quelques années plus tard, lorsque la Démocratie chrétienne est fortement ébranlée par le scandale de Tangentopoli alors qu’aucun membre du MSI n’est visé par les enquêtes de corruption. Dans les urnes le MSI gagne en popularité. Mais l’allégeance du parti au fascisme et les paroles parfois fleuries de Fini empêchent le MSI de devenir véritablement populaire dans l’opinion publique : en 1989, il a déclaré qu’il "[croyait] encore dans le fascisme" ; en 1990, il affirme que "Mussolini a été le plus grand homme d’État du 20e siècle" ; en 1994, que "Mussolini n’était pas un criminel". En 1993, il perd au second tour les élections municipales de Rome. Après cet échec électoral, Fini décide d’adopter une nouvelle stratégie discursive, afin d’offrir davantage de respectabilité au MSI. Ni fasciste ni néofasciste, il se présente désormais comme un "post-fasciste".
Si la tactique de dédiabolisation est en marche, elle n’est pas encore suffisante pour complètement renverser l’opinion. C’est la collaboration avec le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, qui va permettre à Fini de faire entrer son parti au gouvernement en 1994 — l’"arc constitutionnel" est finalement rompu. Cinq ministres, dont la vice-présidente du conseil des ministres, font partie du MSI. Pour aller plus loin encore dans le recentrage du parti, notamment à l’international, Fini décide en 1995 de transformer le MSI en "Alliance nationale" – il demeure à sa tête. Le parti refondé supprime tous les éléments “archéo”-fascistes du programme politique du MSI, notamment la vision corporatiste de l’État pour le capitalisme de marché. Fini affirme que dorénavant, le fascisme ne serait plus qu’une référence historique et non plus l’idéologie ni l’objectif du parti. Sous la direction de Fini, l’ex-MSI devient donc un parti censément de droite modérée. Fin tacticien, il fait même des apparitions publiques au cours desquelles il dénonce le fascisme, notamment lors d’une visite à Auschwitz en 1999 — ce qui n’empêche pas les anarchistes polonais de lui lancer des œufs. Au cours d’un voyage diplomatique en Israël en 2003, il ira même jusqu’à dire que le régime de Mussolini a été "un chapitre honteux de l’histoire de notre peuple" et que le fascisme était "le mal absolu". À cette époque, Fini brigue le poste de Berlusconi : les procureurs tournant autour de ce dernier, il espère le remplacer à la tête du Conseil des ministres s’il venait à tomber. En attendant, il occupe des postes importants dans le gouvernement et au parlement italiens. De 2001 à 2006, il est vice-président du Conseil, rôle qu’il cumule avec celui de ministre des affaires étrangères de 2004 à 2006. De 2008 à 2013, il est le président de la chambre des députés.
En 2009, Fini et Berlusconi décident de fusionner l’Alliance nationale et Forza Italia. Mais à partir de 2010, le premier désapprouve la politique du second, qu’il juge trop alignée avec celle de la Ligue du Nord, et demande la démission du président du Conseil à de nombreuses reprises, avant de fonder le groupe parlementaire Futur et Liberté pour l’Italie. Il n’obtient cependant aucun siège de député aux élections de 2013, une première depuis 1983, et se retire de la vie politique. En 2024, Fini a été condamné à deux ans et huit mois de prison — peine qu’il ne purgera sûrement pas — après qu’un média appartenant à Berlusconi a révélé qu’il a autorisé la vente frauduleuse d’un appartement monégasque qui appartenait à l’Alliance nationale à la famille de sa compagne.
Enrico Berlinguer

Né en Sardaigne le 25 mai 1922 dans une famille d’intellectuels, Enrico Berlinguer connaît une ascension rapide dans le Parti communiste italien qu’il intègre en 1944. Dès 1949, il devient secrétaire général de la Fédération de la jeunesse communiste, poste qu’il occupe jusqu’en 1956. Il tient également le rôle de président de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique de 1950 à 1953. En 1956, le secrétaire général du parti, Palmiro Togliatti, l’invite à intégrer le groupe dirigeant du PCI. Lorsque Luigi Longo décède, il prend sa place en 1972 à la tête du PCI.
La postérité de la figure d’Enrico Berlinguer l’associe avant tout au "compromis historique" qu’il a essayé d’organiser avec la Démocratie chrétienne dans les années 1970. Dans un article publié dans la revue Rinascita le 28 septembre 1973 intitulé "Réflexions sur l’Italie après les événements du Chili", il tire la conclusion suivante de l’assassinat de Salvador Allende au Chili en 1973 et du coup d’État de Pinochet : dans un monde divisé en deux blocs, celui de la démocratie libérale avec les États-Unis en tête de file, et celui de l’Union soviétique, une union des gauches ne pourra jamais arriver au pouvoir en Europe sans être renversée par un coup d’État fasciste organisé par la CIA et les réseaux atlantistes. Il appelle le parti de la Démocratie chrétienne à "transcender les clivages partisans" et former un gouvernement de coalition pour représenter la majorité de la population italienne. Dans un contexte de forte contestation sociale ouvrière depuis 1968, ravivée avec les grèves sauvages suscitées par la crise mondiale de 1973, le "compromis historique" est également un moyen, pour Berlinguer, d’essayer de calmer sa base électorale en lui promettant des avancées sociales une fois au gouvernement.
Berlinguer avait raison de s’inquiéter de l’ingérence états-unienne. D’une part, l’interventionnisme américain après la guerre ne manque pas d’exemples. D’autre part, le travail de Frédéric Heurtebize retrace la surveillance du PCI menée par la CIA depuis le début de la république, et qui s’est intensifiée dans les années 1970.
Lors du 14e congrès du PCI à Rome en mars 1975, Berlinguer fait donc la proposition formelle d’établir ce "compromis historique" avec la Démocratie chrétienne. Pour Aldo Moro, à la tête de la DC, ce compromis n’est pas dénué d’intérêt. Alors qu’aux législatives de mai 1972, le PCI avait récolté 27,2% des voix, ce score s’est élevé à 34,4% aux législatives de juin 1976. La DC profiterait bien du soutien du parti représentant un tiers des électeurs et dont la popularité est en hausse pour rester au pouvoir. La DC vient également d’essuyer un échec : alors qu’elle avait soutenu l’abrogation de la loi sur le divorce, la population italienne a voté à presque 60% pour son maintien au référendum du 12 mai 1974, ce qui porte un coup à la mainmise symbolique de la Démocratie chrétienne sur la vie politique.
De tous les côtés, le compromis historique est difficile à accepter. Les électeurs de la DC redoutent l’arrivée de communistes au gouvernement. Les mouvements d’extrême droite s’indignent et proclament qu’il s’agit d’un plan du PCI pour prendre le pouvoir. La base communiste se sent trahie et juge que Berlinguer abandonne son électorat pour défendre la démocratie bourgeoise. Quant aux Américains, c’est peu dire qu’ils ne sont pas rassurés par l’éventualité de voir des communistes intégrer un gouvernement de l’OTAN, même si Berlinguer affirme s’éloigner de la politique de Moscou et se sentir "plus en sécurité" à l’ouest du rideau de fer. Washington craint qu’en dépit des paroles apaisantes de Berlinguer, le compromis historique ne soit un cheval de Troie soviétique pour imposer des politiques communistes mais aussi pour accéder aux secrets militaires de l’OTAN. Lors d’une rencontre avec Aldo Moro, Gerald Ford et Henry Kissinger le menacent de devoir se retirer de l’OTAN si des communistes participaient au gouvernement italien.
Malgré ces intimidations, Berlinguer et Moro travaillent à la mise en place du compromis historique. À partir de l’été 1976, les communistes à la chambre des députés et au sénat cessent de s’opposer aux lois proposées par le gouvernement pour permettre leur adoption. En juillet 1977, un accord programmatique signé par les deux partis autorise la participation active du PCI à la conception des politiques défendues par le gouvernement de la DC, sauf en matière de politique extérieure. En janvier 1978, Berlinguer, fort de l’influence de son parti et conscient de la dépendance de la DC à l’égard du PCI, demande la nomination de ministres communistes. Après un refus, des milliers de rassemblements de masse sont organisés par le parti pour exiger l’entrée de communistes au gouvernement. Le 9 mars, Berlinguer obtient que les communistes rejoignent la majorité parlementaire en échange de pouvoirs décisionnels accrus.
Un événement vient pourtant bouleverser la collaboration entre la DC et le PCI. Le 16 mars 1978, jour où pour la première fois, des membres du PCI allaient entrer au gouvernement, cinq membres de l’escorte d’Aldo Moro sont assassinés par un groupe de Brigades rouges et le chef de la DC est séquestré pendant 54 jours. Alors que les Brigades rouges proposaient de négocier un échange de prisonniers contre sa libération, la DC et le PCI choisissent la fermeté. Pour Berlinguer, la situation est délicate : même si les Brigades rouges n’ont pas de lien avec le PCI, leur affiliation idéologique à l’extrême gauche amène une portion de l’opinion publique à amalgamer les deux organisations. En tant que chef du PCI, négocier reviendrait à légitimer la violence des Brigades rouges. Quant à eux, les représentants de la DC craignent qu’une négociation ne diminue l’autorité de l’État — ce qui ne les empêchera pas, trois ans plus tard, de payer une rançon pour libérer Ciro Cirillo, autre membre du parti enlevé par les Brigades rouges en 1981. En réalité, l’enlèvement d’Aldo Moro arrange ceux qui redoutaient l’arrivée de communistes au gouvernement. Effectivement, cette affaire mettra fin au compromis historique. Le 9 mai 1978, Aldo Moro est retrouvé mort dans le coffre d’une voiture. La DC refuse la demande d’intégration de ministres communistes au gouvernement, formulée par Berlinguer. Pour la première fois depuis le début de la république, le PCI perd des voix aux élections locales partielles du 14 mai 1978, totalisant seulement 26,5% des voix. En janvier 1979, sous la pression des métallurgistes qui veulent organiser une grève générale, le PCI cesse de soutenir le gouvernement Andreotti aux deux chambres et redevient le premier parti d’opposition : Berlinguer juge que le gouvernement ne consulte pas suffisamment son opinion. Dans ses rapports, la CIA se réjouit de la perte de vitesse de son parti aux élections législatives de 1979 et aux élections régionales de 1980. Face à l’hostilité du parti socialiste de Bettino Craxi à une alliance avec le PCI, Berlinguer réinvestit son électorat ouvrier en soutenant les grèves des usines Fiat.
Le compromis historique était, pour Berlinguer, une composante d’une politique plus large, dont il a été à l’origine : l’eurocommunisme. D’après l’historien Frédéric Heurtebize, ce "phenomène politique largement oublié aujourd’hui" a pourtant constitué une évolution majeure pour les partis communistes italien et, dans une moindre mesure, français parce qu’il a marqué une prise de distance par rapport à l’Union soviétique et un effort pour concilier principes communistes, principes démocratiques et sociétés capitalistes. Ce n’est pas la première fois que le PCI affirme son autonomie par rapport à Moscou : en 1956, Palmiro Togliatti, le prédécesseur de Berlinguer à la tête du parti, a appelé au développement d’une "voie italienne vers le socialisme", et en 1968, le PCI a dénoncé la répression du Printemps de Prague par les chars communistes. Mais sous la direction de Berlinguer, le PCI opère un rapprochement avec les autres partis communistes à l’ouest du rideau de fer. En juillet 1975, il rencontre le secrétaire national du PCE, Santiago Carrillo, et en septembre de la même année, celui du PCF, Georges Marchais. En mars 1977, les trois hommes se réunissent à Madrid pour réaffirmer leur autonomie par rapport au communisme soviétique. Mais les divergences d’opinion entre le PCF et le PCI, notamment sur les politiques économiques et étrangères — contrairement au PCF, le PCI est en faveur de l’intégration européenne — et leurs différences de poids dans leurs vies politiques respectives — le PCI est plus influent —, en plus de l’échec du compromis historique qui était le fer de lance de la politique d’eurocommunisme, participeront à l’échec de la sensibilité eurocommuniste.
Malgré l’interruption du compromis historique et l’échec de l’intégration à l’échelle européenne d’un communisme occidental, Berlinguer a profondément modifié la pratique politique communiste, en la conciliant avec le fonctionnement de la démocratie italienne. Sous sa présidence, le PCI a remporté de nombreuses victoires électorales et a ainsi représenté environ un tiers de la population. En campagne électorale pour les élections européennes de 1984, il décède d’une hémorragie cérébrale survenue lors d’un discours public le 11 juin 1984 : ironie du sort, il ne verra pas que quelques jours plus tard, le PCI remporte 34% des voix. Son décès entame le déclin du parti : ses successeurs auront en effet de plus en plus de mal à éviter la crise générale du communisme en Europe.
Sources
"Enrico Berlinguer", Encyclopédie Universalis, Geneviève Bibes.
Les Transitions italiennes. De Mussolini à Berlusconi, Philippe Foro, L’Harmattan, 2004.
"Washington face à la participation des communistes au gouvernement en Italie (1973-1979)", Frédéric Heurtebize, Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2014/1 n°121, 95-111.
Le péril rouge. Washington face à l’eurocommunisme, Frédéric Heurtebize, Presses Universitaires de France, 2014.
Charles Murray

“Il ne sera jamais le conservateur le plus célèbre du pays, mais il pourrait bien être le plus dangereux1”. C’est ainsi que le New York Times définissait le politologue Charles Murray dans le long portrait qu’il lui consacrait à l’occasion de la sortie The Bell Curve, en 1994. Co-écrit avec le psychologue Richard J. Herrnstein, cet ouvrage, vendu à plus d’1,3 million d’exemplaires, “est sans doute le livre le plus controversé publié aux États-Unis depuis la fin de la Guerre froide2” souligne Quinn Slobodian. Sa thèse s’inscrit en effet dans la plus pure tradition eugéniste : si les Noirs sont disproportionnellement pauvres, incarcérés et dépendants de l’aide gouvernementale, c’est parce qu’ils ont un QI plus faible que les Blancs. Ils n’y peuvent rien, cela relève des gènes dont ils ont hérité, soutiennent Murray et Herrnstein.
Afin de donner corps à cette relation entre race, classe sociale, gènes et intelligence, les auteurs ont truffé le livre de graphiques, de tableaux et de statistiques, conférant une aura scientifique à leur brûlot racialiste. Ce qu’ils ne précisent pas, en revanche, c’est que nombre des références et sources qu’ils produisent ont été élaborées par des défenseurs de la pureté raciale dont la recherche a été financée par l’organisation suprémaciste blanche Pioneer Fund.
Dans ses écrits, Charles Murray tend à se présenter comme un chercheur accablé qui arrive à des conclusions troublantes avec le plus grand regret. Ce n’est pas lui qui parle, c’est la science. “Je ne pense vraiment pas être raciste3”, assure-t-il, précisant que s’il utilise le verbe modérateur “penser”, c’est uniquement parce qu’il se méfie des affirmations péremptoires.
Tous les ouvrages du politologue ne s’inscrivent pas dans la veine racialiste de The Bell Curve. Le premier d’entre eux, Losing Ground, publié en 1984, s’attaquait principalement aux programmes sociaux et leurs bénéficiaires, qu’ils soient noirs ou blancs. En particulier les mères célibataires, cibles privilégiées de Charles Murray depuis plus de 40 ans. Dans ce livre, l’essayiste libertarien utilisait déjà la même méthode : remplir ses pages de données pseudo-scientifiques pour donner l’apparence du raisonnable à ses thèses antigouvernementales. Selon le dogme qu’il défend, les programmes sociaux causeraient plus de problèmes qu’ils n’en résolvent, alors autant les abolir. Responsables de l’émergence d’une sous-classe blanche, ils sont même tellement dangereux qu’ils pourraient, dans un avenir proche, contraindre les élites cognitives à avoir recours à la répression militaire pour contenir les hordes de faibles d’esprit. Et inutile de compter sur l’éducation publique, qui demeurera à jamais impuissante face à leurs limites intellectuelles, alors autant l’abolir elle aussi. “Pour beaucoup de gens, il n’y a rien qu’ils puissent apprendre qui justifie le coût de l’enseignement”, estime Murray.
Dans le dernier chapitre de The Bell Curve, Herrnstein et Murray disent espérer que leur livre suscitera un débat sur la manière de “manipuler la fertilité des personnes ayant un QI élevé ou faible”. Trente ans plus tard, c’est dans la Silicon Valley libertarienne que cette idée s’est le plus largement développée. Ainsi des sociétés comme Genomic Prediction proposent aux futurs parents d’effectuer des tests sur les embryons afin de calculer leurs “scores polygéniques” et de donner naissance à une génération d’enfants génétiquement optimisés. Ces pratiques, qui connaissent un “essor alarmant” selon le magazine Nature, ravissent le milieu de la tech. Aussi Malcolm et Simone Collins, grands admirateurs de Trump et chantres du pronatalisme, se réjouissent-ils d’avoir offert au monde “le premier bébé sélectionné pour son intelligence4”. Quant à Elon Musk, il incite ses amis blancs et riches à imiter son activisme en matière de procréation - il est le géniteur de 14 enfants - en leur conseillant de regarder “Idiocracy”. Le scénario de ce film dystopique fait frémir le patron de X : l’élite intelligente cesse de procréer, laissant les idiots peupler la Terre.
1 Jason Deparle, “Daring Research or ‘Social Science Pornography’?”, The New York Times, October 9, 1994.
2 Quinn Slobodian, “The Unequal Mind: How Charles Murray and Neoliberal Think Tanks Revived IQ”, in Capitalism: A Journal of History and Economics, University of Pennsylvania Press, vol.4, N°1, Winter 2023.
3 Jason Deparle, ibid.
4 Raphaëlle Besse Demoulière, “Ces Américains en croisade pour faire le plus d’enfants possible, et sauver l’humanité”, Le Monde, 29 octobre 2023.
Lee Raymond

Lee R. Raymond (1983) prend la tête d’Exxon, puis ExxonMobil, de 1993 à 2025. Il supervise l’entreprise pendant une période décisive du débat mondial sur le climat. Bien que les scientifiques d’Exxon confirment, dès le début des années 1980, que la combustion d’énergies fossiles entraîne un réchauffement climatique considérable, Raymond remet publiquement en question ces conclusions dès qu'il devient PDG. Des rapports internes datant de 1982 mettent déjà en garde contre des changements climatiques majeurs, mais sous la direction de Raymond, ExxonMobil adopte une position nettement sceptique à l’égard du changement climatique d’origine anthropique.
Tout au long des années 1990, Raymond se positionne comme l’un des opposants les plus virulents à la politique climatique de l’époque. Lors du Congrès mondial du pétrole de 1997 à Pékin, juste avant les négociations du protocole de Kyoto, il déclare que les “les arguments en faveur du soi-disant réchauffement climatique sont loin d'être irréfutables”, affirmant que la variabilité naturelle expliquerait les changements de température observés et que la réduction des émissions irait à l’encontre du "bon sens". En tant que président de l’American Petroleum Institute, il diffuse des messages qui insistent sur l’incertitude scientifique. Sous sa direction, Exxon finance des groupes de réflexion et des organisations de défense, dépensant notamment près de 20 millions de dollars entre 1997 et 2005 pour promouvoir le scepticisme climatique et retarder toute action politique.
Dans une interview accordée à Charlie Rose en 2005, Raymond réitère ses arguments concernant le réchauffement climatique: le climat de la planète a toujours connu des variations naturelles, la science ne démontre pas une interférence humaine, et le consensus n’équivaut pas à la vérité. Il compare même la croyance au réchauffement climatique au moment où “90 % des gens pensaient que la Terre était plate”. Il soutient qu’agir sur la base d’une science incomplète nuira à l’économie et qu’il reste “du temps pour mieux comprendre le problème”.
Sous la direction de Raymond, ExxonMobil devient emblématique de l’obstruction des entreprises à l’action climatique. Alors que des concurrents comme BP commencent à reconnaître les risques climatiques à la fin des années 1990, Exxon redouble de scepticisme. Après le départ à la retraite de Raymond, la Royal Society et d’autres organisations condamnent les communications trompeuses d’ExxonMobil, et en 2008, l’entreprise met discrètement fin au financement de certains groupes climatosceptiques.
Aujourd’hui, les historiens considèrent Raymond comme l’une des figures ayant le plus façonné le discours climatique de la fin du XXᵉ siècle. Sous sa direction, l’opposition de l’industrie aux politiques de réduction des émissions se renforce, amplifiant les doutes du public et contribuant à retarder l’action mondiale pendant une décennie ou plus. L’“ère Raymond” devient un exemple édifiant de la manière dont la stratégie d’entreprise et la rhétorique persuasive peuvent entraver le consensus scientifique et freiner les progrès politiques.
William A. Nordhaus

Selon l’économiste français Antonin Pottier, la trajectoire intellectuelle de William Nordhaus commence de manière paradoxale avec sa critique du rapport The Limits to Growth du Club de Rome, publié en 1972. Ce rapport mettait en cause la durabilité de la croissance économique en affirmant que l’épuisement des ressources et la pollution finiraient par contraindre le développement mondial. À cette époque, Nordhaus était un jeune professeur à l’université de Yale et déjà un partisan affirmé de l’économie dominante. Il examina le rapport de manière critique et insista sur son absence de fondement empirique solide. Parmi les nombreux facteurs présentés comme susceptibles de provoquer un effondrement, Nordhaus identifia le changement climatique comme le seul capable d’engendrer de graves conséquences macroéconomiques au cours du siècle à venir.
À partir de 1974, Nordhaus se consacre plus directement à l’économie du changement climatique. Sa première contribution quantitative date de 1977, lorsqu’il propose une analyse coût-efficacité. À l’aide d’un modèle énergétique et d’un modèle du cycle du carbone, il estime les coûts associés à différents objectifs de stabilisation du CO₂ atmosphérique. En l’absence de référence établie, il définissait lui-même ces objectifs et considérait qu’un doublement de la concentration de CO₂, soit environ 550 parties par million, constituait une limite supérieure qu’il serait prudent de ne pas franchir.
Nordhaus se montre cependant insatisfait de ce qu’il juge être une méthode trop arbitraire. À ses yeux, les objectifs climatiques ne doivent pas reposer sur des préférences subjectives ni sur des principes moraux, mais être définis de manière "scientifique", c’est-à-dire par le calcul lui-même. Cette conviction le conduit, au cours des années 1980, à abandonner l’analyse coût-efficacité pour l’analyse coût-bénéfice. Il s’agit cette fois d’identifier le niveau optimal de réduction des émissions en évaluant l’équilibre entre les coûts de l’atténuation et les dommages évités.
Ce nouveau cadre intellectuel le mène à élaborer le modèle DICE (Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy), finalisé au début des années 1990. DICE devient rapidement le modèle d’évaluation intégré de référence en économie du climat. Conçu comme une extension simplifiée du modèle néoclassique de croissance optimale, il interprète la réduction des émissions comme un investissement destiné à améliorer le bien-être futur et soumis à la même logique de rendement que les autres investissements productifs. L’objectif est de déterminer la trajectoire d’investissement optimale, ce qui revient à calculer un "niveau optimal de réchauffement" que devrait accepter un agent rationnel.
Du fait de l’influence centrale de Nordhaus dans la discipline et de la simplicité du modèle, directement inspiré des cadres de croissance standard, DICE se répand rapidement et devient l’outil analytique dominant en matière de politique climatique chez les économistes. En inscrivant l’évaluation du climat dans une optimisation intertemporelle de la consommation, Nordhaus place l’économiste au cœur du problème climatique. Il en fait l’arbitre des transferts de richesse entre générations et le juge chargé de concilier deux impératifs : minimiser les coûts économiques et limiter le réchauffement global.
Comme l’ont montré Naomi Oreskes et Erik M. Conway, l’héritage de Nordhaus s’inscrit aussi dans l’histoire du retard organisé de l’action climatique. Nordhaus cosigne notamment, avec Jesse Ausubel et Gary Yohe, le premier chapitre du troisième rapport de l’Académie nationale des sciences publié en 1983 sous la direction de William Nierenberg. Leur contribution, consacrée à l’usage de l’énergie et aux émissions de CO₂, reconnaît d’emblée qu’il existe "un large accord selon lequel les émissions de dioxyde de carbone d’origine anthropique augmentent régulièrement, principalement du fait de la combustion des combustibles fossiles". Leur attention se porte toutefois moins sur ce que l’on sait que sur ce que l’on ignore : l’"immense incertitude au-delà de l’an 2000" et l’"incertitude plus grande encore" concernant les effets sociaux et économiques des trajectoires possibles de CO₂.
À l’aide d’analyses probabilistes, ils projettent les concentrations atmosphériques jusqu’en 2100 selon différents scénarios d’usage de l’énergie, de coût et d’efficacité économique. Les résultats couvrent un éventail très large, mais ils estiment le scénario le plus probable à un doublement du CO₂ vers 2065. Ils admettent cependant qu’il existe une probabilité non négligeable d’un doublement avant 2050 et reconnaissent qu’il serait imprudent d’écarter cette possibilité. Pourtant, comme le soulignent Oreskes et Conway, ils tendent en pratique à la minimiser.
Que faire pour enrayer le changement climatique ? Pour Nordhaus, assez peu de choses. Selon lui, "la mesure la plus efficace serait d’imposer une taxe carbone permanente élevée", mais une telle mesure serait difficile à instaurer et à faire respecter. Il estime par ailleurs que des politiques strictes de réduction du CO₂ exigeraient des choix très contraignants, tandis que les stratégies évoquées par Schelling dans le même rapport, fondées sur l’adaptation ou la modification du climat, paraissent plus économiques. Il conclut qu’on ignore si les effets secondaires sur les sociétés seront plus coûteux qu’une réduction rigoureuse des gaz à effet de serre.
La contribution de Nordhaus au rapport de 1983 incarne ainsi une tendance majeure des politiques climatiques américaines : reconnaître le consensus scientifique tout en soulignant l’incertitude, préconiser le report de l’action et présenter l’adaptation ou l’innovation technologique comme des réponses préférables à l’atténuation immédiate.
Dans cette perspective, l’historien Jean-Baptiste Fressoz replace Nordhaus dans une histoire plus large de l’optimisme économique moderniste qui associe l’économie de l’innovation à l’imaginaire technopolitique de l’ère atomique. Dans Sans transition (2024), Fressoz décrit Nordhaus comme "l’un des futurologues atomistes des années 1970", dont la confiance dans le progrès technologique, notamment dans l’énergie nucléaire et les réacteurs surgénérateurs, soutient l’idée même de transition énergétique. Dans un article publié en 1973, Nordhaus soutient même que les efforts de sobriété énergétique risquent d’être excessifs, car "le progrès technologique résoudra bientôt la crise énergétique". Il prédit qu’à la fin du XXIe siècle, l’économie mondiale fonctionnera à l’hydrogène et à l’électricité issus de ressources illimitées, ce qu’il appelle le "stade final de la transition ». Le réacteur surgénérateur constitue pour lui une « technologie ultime", une sorte de filet de sécurité technologique que l’on retrouve ensuite dans ses modèles climatiques.
Pendant son séjour à l’International Institute for Applied Systems Analysis entre 1974 et 1975, Nordhaus rencontre l’ingénieur italien Cesare Marchetti qui l’initie à la modélisation du climat. Ensemble, ils imaginent un monde doté de ressources énergétiques inépuisables et de possibilités de géo-ingénierie. Nordhaus élabore alors un modèle mathématique simple visant à maximiser le PIB mondial tout en évitant un doublement du CO₂ et conclut que l’humanité dispose d’un "temps confortable" pour agir. Comme le remarque Fressoz, "la trajectoire optimale ne se distinguait guère de la trajectoire non régulée", résultat qui deviendra central dans son raisonnement ultérieur.
Fressoz souligne aussi que l’influence de Nordhaus dépasse largement le champ académique. Exxon s’appuie directement sur son idée selon laquelle il existe « assez de temps » pour organiser une transition ordonnée, afin de justifier la poursuite de l’exploitation fossile. Dans les années 1990, le modèle DICE s’impose au sein du Groupe de travail III du GIEC et institutionnalise une logique de procrastination. L’objectif de DICE est en effet de calculer la température optimale de la Terre que Nordhaus estime à trois degrés et demi, une valeur qu’il juge compatible avec la prospérité d’une "espèce technologique et nomade" qu’il nomme Homo adaptus.
Pour Fressoz, Nordhaus représente ainsi l’aboutissement d’une confiance moderniste dans l’innovation et les mécanismes de marché, confiance qui a sous-estimé les contraintes matérielles et l’inertie des systèmes énergétiques. En assimilant technologie et innovation, Nordhaus et ses héritiers ont entretenu l’idée que croissance économique et décarbonation peuvent progresser de concert. Une telle vision, écrit Fressoz, "a fourni les outils intellectuels de la procrastination", en légitimant le retard politique tout en introduisant dans les scénarios climatiques des options technologiques parfois fantaisistes comme la géo-ingénierie.
Sources :
Antonin Pottier, Comment les économistes réchauffent la planète, Seuil, 2016.
Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Merchants of Doubt, Bloomsbury Press, 2010.
Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition, Seuil, 2024.
Thomas C. Schelling
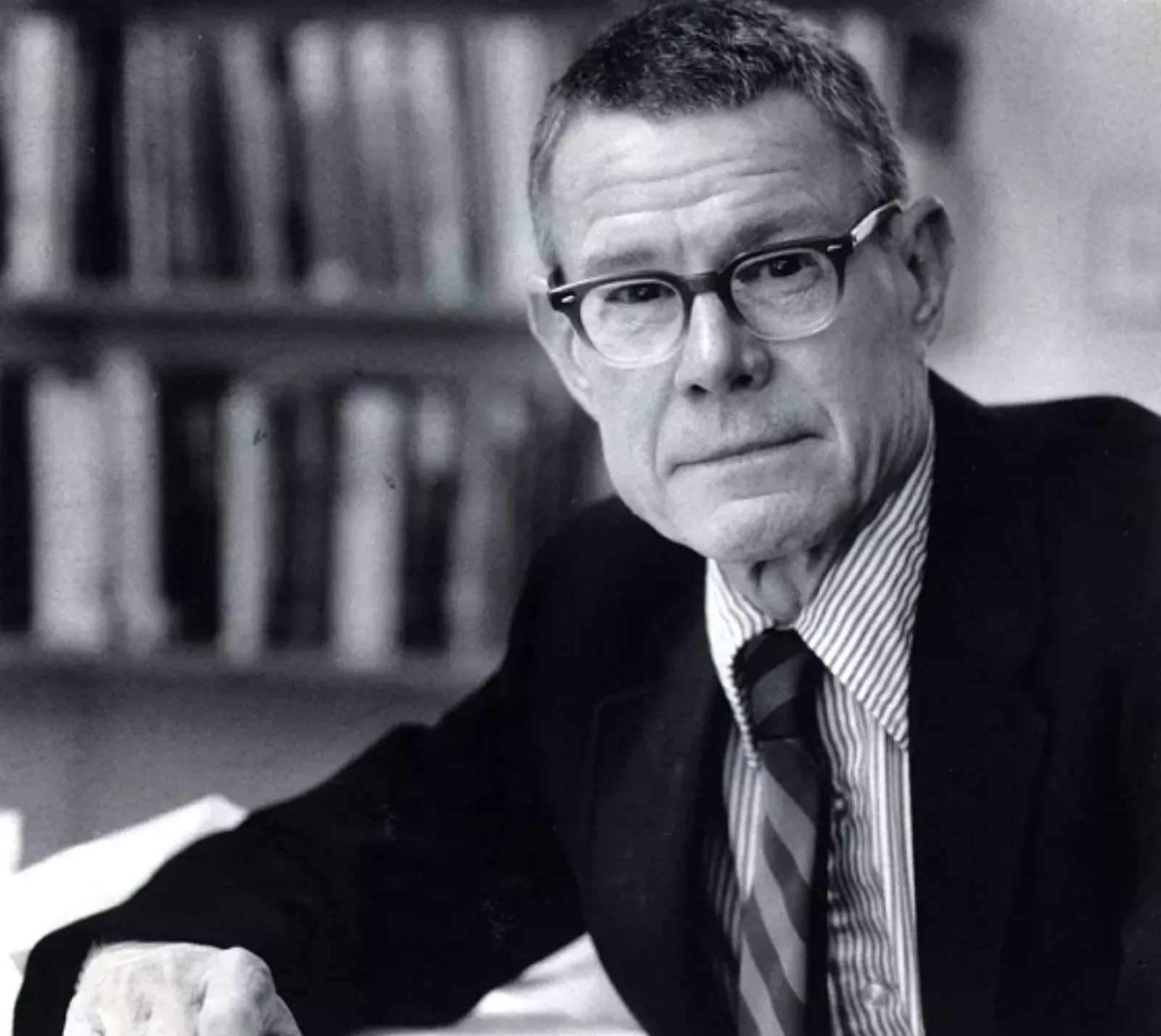
Thomas C. Schelling fut un économiste et stratège de premier plan, connu pour ses contributions à la théorie des jeux et à l’analyse économique du conflit et de la coopération. Figure centrale de la rationalité stratégique de la guerre froide, il participa de manière décisive à l’élaboration de la doctrine de la dissuasion nucléaire grâce à The Strategy of Conflict, publié en 1960, où il décrivait la négociation comme un processus visant à obtenir un avantage par la menace plutôt que par l’usage direct de la force. Il développa également la notion de "point focal", cet équilibre tacite auquel deux adversaires se rallient pour éviter une destruction mutuelle.
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Schelling transpose cette logique stratégique à la question émergente du changement climatique d’origine anthropique. Il préside l’étude que l’Académie nationale des sciences consacre en 1980 aux dimensions sociales et politiques du réchauffement, puis siège au Comité d’évaluation du dioxyde de carbone qui publie en 1983 le rapport Changing Climate sous la supervision de William A. Nierenberg. Contrairement aux usages de l’Académie, ce rapport ne fut pas signé collectivement, car il résultait en réalité de deux analyses distinctes. Les cinq chapitres rédigés par des scientifiques examinaient la probabilité d’un changement climatique causé par l’homme, tandis que deux chapitres consacrés aux émissions et aux impacts relevaient d’économistes comme William Nordhaus et Thomas Schelling.
Ce nouveau rapport répondait largement à ce que Naomi Oreskes et Erik Conway décrivent comme "l’année décisive du climat", 1979. Cette année-là, le météorologue Jule Charney, l’un des fondateurs de la modélisation numérique moderne de l’atmosphère, réunit huit scientifiques dans le centre d’étude estivale de l’Académie à Woods Hole, dans le Massachusetts. Il invita Syukuro Manabe et James E. Hansen à présenter les résultats de leurs modèles tridimensionnels les plus récents. La question centrale portait sur la sensibilité du climat, c’est-à-dire sur l’élévation moyenne de température attendue en cas de doublement du CO₂. La meilleure estimation disponible était d’environ trois degrés Celsius, avec une marge d’erreur de un degré et demi. Le rapport Charney concluait que la poursuite de l’augmentation du CO₂ provoquerait à coup sûr des changements climatiques et qu’il n’existait aucune raison de penser que ces changements seraient négligeables.
Dans la préface, Verner E. Suomi, président du Climate Research Board de l’Académie, insistait sur un point essentiel. L’océan, "immense volant d’inertie du système climatique", ralentirait la manifestation visible du changement, si bien qu’une politique d’attentisme risquait de conduire à réagir trop tard. Il soulignait que cette conclusion serait sans doute difficile à accepter pour les responsables politiques.
Cette prévision se vérifia. Avant même la publication du rapport Charney, la Maison-Blanche demanda des informations supplémentaires à l’Académie. La seconde étude, envoyée sous forme de lettre en avril 1980, fut présidée par Schelling. Elle avançait que les incertitudes scientifiques et économiques entourant le réchauffement justifiaient une suspension de toute mesure immédiate et un investissement accru dans la recherche. Schelling considérait qu’il n’était pas établi que les effets du réchauffement seraient majoritairement négatifs. Il estimait plausible que le climat du siècle suivant diverge fortement de celui du présent, mais jugeait tout aussi possible que les changements demeurent modérés et non nécessairement défavorables.
Pour Schelling, le réchauffement ne créerait pas des climats inédits. Il déplacerait les zones climatiques existantes, ce qui annonçait un argument récurrent du scepticisme : plutôt que de limiter l’usage des combustibles fossiles, l’humanité pourrait migrer et s’adapter. Il rappelait que la colonisation du Nouveau Monde avait déjà confronté de nombreuses populations à des environnements climatiques très différents, et en concluait que l’adaptation constituait la meilleure réponse, malgré la différence évidente entre le monde précolonial et celui des États modernes aux frontières rigides.
Il avançait également que l’horizon temporel du réchauffement laisserait suffisamment de temps pour se préparer. Selon lui, la hausse progressive du prix des combustibles fossiles réduirait d’elle-même leur consommation. Cette diminution permettrait à ses yeux d’atténuer le réchauffement, d’encourager les puits de carbone non atmosphériques et de faciliter la transition vers des énergies alternatives. Il pensait que ce processus suivrait spontanément les lois du marché, ce qui rendait toute régulation inutile.
Compte tenu des incertitudes qu’il soulignait, cette confiance dans les mécanismes spontanés du marché était remarquable. La consommation de combustibles fossiles a pourtant largement augmenté durant les décennies suivantes. Si sa prévision s’était révélée juste, aucune action réglementaire n’aurait été nécessaire. Le comité ne recommanda donc aucune réduction des émissions, tout en reconnaissant que « plus la transition serait amorcée tôt, plus elle serait aisée ». Il conclut cependant que la priorité devait aller à la recherche, menée « avec le profil politique le plus bas possible », dans l’idée que la science progresserait plus vite que le problème.
Le météorologue John Perry répondit à cette position dans Climatic Change par un article intitulé "Energy and Climate: Today’s Problem, Not Tomorrow’s", où il soutenait que le report des décisions constituait un risque en soi.
La troisième évaluation de l’Académie fut le rapport Changing Climate publié en 1983. Les chapitres rédigés par les scientifiques soulignaient la gravité des impacts d’un réchauffement non maîtrisé, tout en appelant à affiner les connaissances. Les chapitres rédigés par les économistes, ainsi que la synthèse, adoptaient en revanche une approche prudente et attentiste. Le premier chapitre, écrit par William Nordhaus, Jesse Ausubel et Gary Yohe, reconnaissait la progression continue des émissions de CO₂ d’origine humaine et leur lien avec la combustion des combustibles fossiles. Il insistait néanmoins sur l’ampleur des incertitudes au-delà de l’an 2000, en particulier quant aux effets sociaux et économiques. Les auteurs estimèrent que les changements majeurs pouvaient être renvoyés à l’avenir et recommandèrent l’introduction d’une taxe carbone permanente.
Dans son propre chapitre, Schelling développa une logique de "décote climatique". Il considérait que les effets du réchauffement appartenaient à un horizon trop éloigné pour les décideurs actuels. Il jugeait aussi qu’il serait abusif de traiter les émissions de CO₂ isolément, puisque la poussière atmosphérique, les changements d’usage des sols ou les variations naturelles contribuaient également aux dynamiques climatiques. Selon lui, il n’était pas évident que la solution doive nécessairement se situer du côté de la cause principale.
La synthèse rédigée par Nierenberg reprit ces arguments. Elle affirmait que les problèmes globaux de pollution et de dégradation environnementale rendaient la question du CO₂ difficile à traiter. Elle ajoutait cependant qu’en envisageant les effets du réchauffement à une échelle locale, il devenait possible d’y répondre comme à d’autres stress environnementaux par l’adaptation. La montée du niveau des mers pourrait rendre certaines régions inhabitables, mais l’histoire humaine, disait-il, montrait la grande capacité des sociétés à se déplacer et à reconstituer leurs structures sociales et matérielles.
Ce rapport convenait parfaitement aux attentes de la Maison-Blanche. Il minimisait les désaccords scientifiques, suggérait un consensus entre scientifiques et économistes et affirmait que l’innovation technologique réglerait les problèmes futurs. Il concluait qu’aucune action réglementaire immédiate n’était nécessaire, à l’exception du financement de la recherche.
La Maison-Blanche s’en servit pour affaiblir les premières évaluations climatiques de l’EPA. L’agence avait publié deux rapports qui décrivaient le réchauffement comme une menace sérieuse et recommandaient une réduction rapide de la consommation de charbon. Le conseiller scientifique du président, George Keyworth, invoqua les conclusions du comité Nierenberg pour discréditer les évaluations de l’EPA et affirma que la presse avait rejeté "l’alarmisme de l’EPA" au profit de la "position prudente de l’Académie".
La lecture que le philosophe Pierre Charbonnier propose de Schelling diffère en partie de celle de Naomi Oreskes et Erik Conway. Pour ces derniers, Schelling appartient à la constellation d’experts qui ont fourni un cadre intellectuel permettant de retarder l’action climatique en mobilisant l’incertitude et l’intérêt national. Charbonnier ne conteste pas ce constat mais estime qu’il ne suffit pas à expliquer son influence. Schelling réussit surtout à traduire le changement climatique dans le langage du pouvoir, de la sécurité et de la négociation stratégique, un langage déjà familier aux élites étatiques. Autrement dit, même en l’absence de lobbying fossile, son approche aurait trouvé un écho parmi les gouvernants.
Charbonnier reconstruit son paradigme climatique autour de trois principes. Le risque est d’abord subordonné aux capacités d’adaptation : le réchauffement est réel mais évolue plus lentement que le progrès technologique et reste donc gérable, notamment grâce à l’innovation future, même s’il accentuera les inégalités mondiales. Ensuite, il estime que des accords climatiques universels et contraignants sont structurellement improbables, car le climat est inséparable de la sécurité énergétique et des rivalités géopolitiques, et les États ne sont pas disposés à sacrifier leur souveraineté pour un risque considéré comme secondaire. Enfin, la politique climatique devient une négociation permanente, analogue aux discussions sur le contrôle des armements, qui vise à déterminer un niveau « optimal » de réchauffement. Ce niveau correspond au point focal climatique de Schelling, au-delà duquel les émissions cessent d’être économiquement profitables pour devenir stratégiquement dangereuses.
Pour décrire cette combinaison de pensée de la dissuasion, de calcul coûts–avantages et de développement fossile, Charbonnier parle d’une "écologie Strangelove". Cette écologie ne remet pas en cause les prémisses stratégiques de l’État de la guerre froide. Elle s’en sert pour rendre le climat gouvernable. Sa force réside dans la capacité à offrir aux décideurs une synthèse géoéconomique immédiatement disponible, que la plupart des écologies normatives n’ont jamais su produire.
Sources : Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Merchants of Doubt, Bloomsbury Press, 2010, chap. 6; Pierre Charbonnier, Vers l’écologie de guerre, La Découverte, 2024, chap. 5.
Roger Revelle

Roger Revelle fut un océanographe et un spécialiste du climat de tout premier plan. Il joua un rôle décisif dans l’histoire de la recherche climatique et exerça une influence durable comme enseignant, notamment sur Al Gore, qui suivit ses cours à Harvard dans les années 1960.
L’intérêt de Revelle pour le changement climatique mondial s’affermit à la fin des années 1950 lorsqu’il cosigna avec Hans E. Suess l’article fondateur intitulé "Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO₂ During the Past Decades". Cette étude montrait que les océans ne pouvaient absorber l’ensemble du dioxyde de carbone d’origine anthropique. Elle indiquait ainsi que la concentration atmosphérique de CO₂ augmenterait de manière inévitable du fait de la combustion des combustibles fossiles. Peu après, Revelle obtint des financements pour permettre à son collègue, le chimiste Charles David Keeling, d’effectuer des mesures systématiques de la concentration atmosphérique en CO₂. Ces travaux produisirent la célèbre courbe de Keeling, qui met en évidence la progression continue du CO₂ dans l’atmosphère. Keeling reçut plus tard la National Medal of Science et fut largement popularisé par Al Gore dans An Inconvenient Truth.
En 1965, le President’s Science Advisory Committee demanda à Revelle, alors directeur de la Scripps Institution of Oceanography, de rédiger une synthèse sur les effets possibles d’un réchauffement provoqué par le dioxyde de carbone. Conscient des incertitudes persistantes, il choisit de se concentrer sur l’impact qu’il jugeait le plus certain : l’élévation du niveau de la mer. Il formula également une prévision remarquable pour l’époque : "D’ici l’an 2000, l’atmosphère pourrait contenir environ vingt-cinq pour cent de CO₂ en plus qu’aujourd’hui, et cette augmentation modifiera le bilan thermique de l’atmosphère au point que des changements marqués du climat pourraient se produire".
Deux décennies plus tard, Revelle contribua à Changing Climate: Report of the Carbon Dioxide Assessment Committeepublié en 1983, une étude dirigée par William A. Nierenberg. Il y avertissait à nouveau que la désintégration de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental pourrait entraîner une élévation du niveau des mers de cinq à six mètres. Selon lui, un tel scénario aurait pour effet d’inonder les ports existants, les zones côtières basses, de vastes régions agricoles situées dans les deltas densément peuplés, ainsi que des portions importantes de la Floride, de la Louisiane et de nombreuses grandes métropoles. Sur le plan des politiques publiques, Revelle recommandait une transition progressive vers le gaz naturel et l’énergie nucléaire, accompagnée d’une réduction de l’usage du charbon et du pétrole. Il insistait aussi sur la nécessité de soutenir la recherche scientifique et mettait en garde contre la tentation de surestimer les incertitudes.
Revelle se retrouva au centre d’une controverse au début des années 1990 lorsque quelques scientifiques affirmèrent qu’il avait changé de position sur le réchauffement climatique. Cette affirmation provenait d’un article cosigné avec S. Fred Singer et Chauncey Starr, intitulé "What to Do About Greenhouse Warming: Look Before You Leap", publié en 1991 dans Cosmos: A Journal of Engineering and Science, revue du très sélectif Cosmos Club de Washington. Revelle y apparaissait comme deuxième auteur et semblait soutenir l’idée que le réchauffement attendu au cours du siècle serait probablement modéré, inférieur à un degré Celsius.
Cet article provoqua pourtant la gêne de Revelle. Cosmos n’était pas une revue scientifique évaluée par les pairs, et plusieurs collègues rapportèrent qu’il qualifiait le texte en privé de « foutaise ». L’océanographe Walter Munk souligna qu’il était connu pour son incapacité à refuser une demande et suggéra qu’il n’avait peut-être jamais donné son accord explicite pour figurer comme coauteur. Christa Beran, sa secrétaire de longue date, affirma plus tard dans un témoignage écrit que Revelle lui avait confié : "Certains pensent que Fred Singer n’est pas un très bon scientifique".
Cet épisode se déroula alors que Revelle vivait les derniers mois de sa vie et lui causa une tension considérable. En février 1991, il fut victime d’une grave crise cardiaque en rentrant à La Jolla après une conférence. Il dut subir un pontage coronarien triple, qui fut suivi de complications et d’infections. Son état se dégrada rapidement, au point de ne plus pouvoir assurer une correspondance régulière ou un encadrement scientifique. Il mourut d’une seconde crise cardiaque en juillet 1991. L’article de Cosmos fut ensuite instrumentalisé lors de la campagne présidentielle de 1992 pour affaiblir Al Gore, présenté à tort comme l’élève d’un Revelle prétendument revenu sur ses propres mises en garde concernant le changement climatique.
Source : Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, New York, Bloomsbury Press, 2010.
Siegfried Fred Singer

Siegfried Fred Singer (1924–2020) fut un physicien et entrepreneur politique dont la carrière embrassa la recherche sur la haute atmosphère et la météorologie satellitaire avant de se tourner vers des interventions déterminantes dans les débats de politique environnementale. Comme l’ont montré Naomi Oreskes et Erik Conway dans Merchants of Doubt, son parcours illustre comment une autorité scientifique forgée durant la guerre froide put être reconvertie pour contester les politiques de régulation en exaltant l’incertitude, les coûts économiques et les vertus présumées du marché. Formé comme physicien pendant la Seconde Guerre mondiale, il se distingue dans les années 1950 par ses travaux menés à l’aide de fusées sondes sur les rayonnements cosmiques et le champ magnétique terrestre, et compte parmi les tout premiers promoteurs des satellites scientifiques. Il dirige ensuite le National Weather Satellite Center et occupe divers postes de conseil au sein des administrations Nixon et Reagan, s’installant durablement à l’interface entre institutions de recherche et appareils gouvernementaux.
Au tournant des années 1970, Singer apparaît d’abord comme un environnementaliste inspiré par les diagnostics éco-malthusiens. Lors d’un symposium de l’American Association for the Advancement of Science, il mobilise l’article influent de Garrett Hardin sur la "Tragédie des biens communs" et plaide en faveur d’une protection accrue de l’environnement. Dans un ouvrage consacré à la question démographique publié en 1971, il met en garde contre les risques d’une croissance incontrôlée et appelle à des mesures de précaution. La seconde moitié de la décennie marque cependant un tournant décisif. Un rapport rédigé pour la Mitre Corporation promeut l’analyse coûts–avantages comme outil central d’évaluation des politiques environnementales et insiste sur le poids financier de la lutte contre la pollution comparé à des bénéfices qu’il juge incertains. Au début des années 1980, Singer adopte une vision nettement plus optimiste en affirmant que l’innovation technologique, stimulée par la dérégulation, serait en mesure de dissiper d’elle-même les contraintes écologiques.
Cette inflexion idéologique devient manifeste lors de la controverse sur les pluies acides. En 1982 et 1983, l’administration Reagan décide de contourner l’Académie nationale des sciences et de commander sa propre expertise. William Nierenberg est alors nommé à la présidence du comité. À la demande de la Maison-Blanche, Singer est intégré au groupe. Il en est le seul membre sans affiliation universitaire permanente. Le rapport consensuel conclut que les émissions de dioxyde de soufre constituent la cause principale des dépôts acides et recommande des réductions immédiates. Singer refuse cette conclusion et rédige une annexe dissidente. Il y met en avant les incertitudes persistantes et souligne le coût des mesures de contrôle des émissions. Il préconise un essai limité et peu coûteux avant toute réduction substantielle. Cette position rejoint les arguments de l’industrie électrique et contribue à retarder la mise en œuvre des mesures envisagées. Le résumé exécutif du rapport est ensuite remanié en concertation avec l’Office of Science and Technology Policy, de manière à faire apparaître l’incertitude en premier lieu. Singer affirmera plus tard que ce report a permis d’économiser plusieurs milliards de dollars par an.
Dans les années suivantes, Singer étend sa contestation aux fondements scientifiques de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Il soutient que le trou d’ozone observé au-dessus de l’Antarctique pourrait résulter du refroidissement stratosphérique et de la variabilité naturelle. Selon lui, les émissions de chlorofluorocarbures ne jouent qu’un rôle secondaire. Cette affirmation contredit pourtant les conclusions largement établies de la chimie atmosphérique. Singer met également en cause les rapports du Surgeon General et de l’Environmental Protection Agency qu’il accuse de poursuivre des objectifs avant tout politiques. Son étude hostile à l’EPA, financée de manière indirecte par le Tobacco Institute grâce à l’Alexis de Tocqueville Institution, confirme sa proximité croissante avec les intérêts industriels opposés à la régulation environnementale.
De la fin des années 1980 au cours des années 1990, Singer s’impose comme l’une des voix les plus influentes de la contestation publique des sciences du climat. Il affirme que les incertitudes scientifiques restent trop importantes pour justifier des politiques coûteuses. En 1991, il cosigne un article dans Cosmos avec Roger Revelle et Chauncey Starr intitulé "What to Do About Greenhouse Warming: Look Before You Leap"1. Des archives et témoignages montrent pourtant que Revelle, affaibli après une lourde intervention cardiaque, s’était montré réticent et n’avait participé à sa rédaction qu’à la marge. L’article suggère que le réchauffement restera modéré et difficile à distinguer de la variabilité naturelle. Cette thèse contredit les conclusions que Revelle et Hans Suess avaient établies dès 1957 dans leur étude fondatrice sur les échanges de dioxyde de carbone entre l’atmosphère et l’océan2. Lors de la campagne présidentielle de 1992, le texte de Cosmos est utilisé pour affaiblir Al Gore, ancien étudiant de Revelle. Lorsque Justin Lancaster, doctorant proche de Revelle, conteste publiquement la présentation défendue par Singer, celui-ci engage une action en diffamation. L’affaire se conclut par une ordonnance de silence et un accord amiable.
Au milieu des années 1990, les sciences du climat franchissent un seuil important avec les études de détection et d’attribution. Grâce aux techniques de fingerprinting, des chercheurs comme Benjamin Santer démontrent que les schémas observés de réchauffement correspondent aux signatures attendues d’un forçage par les gaz à effet de serre. Ces schémas ne peuvent être attribués à la seule variabilité naturelle. En 1995, Santer, Tom Wigley et plusieurs collègues rédigent le chapitre 8 du deuxième rapport d’évaluation du GIEC. Ils y concluent que l’ensemble des données disponibles indique une influence humaine discernable sur le climat. Cette conclusion suscite une réaction immédiate. Singer, Frederick Seitz et d’autres membres du réseau du Marshall Institute dénoncent publiquement le fonctionnement du GIEC dans Science et dans le Wall Street Journal. Ils accusent Santer d’avoir modifié son chapitre après son approbation et d’avoir minimisé les incertitudes. Ils affirment également qu’il aurait exclu des contributions dissidentes, notamment celle de Patrick Michaels. Ces accusations sont infondées, car les révisions suivaient les procédures officielles du GIEC. Les incertitudes figuraient clairement dans le texte final et Michaels avait été invité à participer, ce qu’il a décliné. Aussi infondée qu’elle soit, la campagne orchestrée par Singer et Seitz trouve un écho important dans les sphères politiques et médiatiques. Seitz évoque une "corruption du processus d’évaluation par les pairs" et Singer parle de "nettoyage scientifique". De nombreuses sociétés savantes et plusieurs climatologues de premier plan défendent pourtant Santer et le GIEC mais la polémique contribue à semer le doute à propos de la science climatique. Elle offre ainsi un argument supplémentaire à ceux qui souhaitent retarder l’action politique.
La trajectoire intellectuelle de Singer rejoint enfin la philosophie cornucopienne défendue par Julian Simon. L’idée que l’ingéniosité humaine permettrait d’accroître indéfiniment les ressources disponibles innerve une large part de ses prises de position. Dès 1970, il manifeste une nette irritation face à ce qu’il perçoit comme des discours alarmistes. Dans un éditorial publié dans Science, il soutient que la combustion des énergies fossiles ne produira pas de réchauffement notable, les aérosols atmosphériques étant, selon lui, susceptibles de compenser l’effet de serre. Il met alors en garde la communauté scientifique contre le risque de "crier au loup". Si les aérosols ont effectivement atténué une partie du réchauffement durant les premières décennies, Singer refuse d’admettre que l’accumulation continue de dioxyde de carbone finit nécessairement par dépasser cet effet transitoire.
Dans les années 1980, Singer admet encore que la vision cornucopienne qu’il défend suppose l’existence durable d’une énergie abondante et peu coûteuse, condition sans laquelle l’ingéniosité humaine ne suffirait pas à repousser les limites écologiques. Il abandonne pourtant rapidement cette réserve, et au cours des années 1990 il adopte pleinement l’optimisme technologique de Julian Simon. La publication en 1999 de Hot Talk, Cold Science: Global Warming’s Unfinished Debate, préfacé par Frederick Seitz et largement fondé sur cette perspective, en offre une illustration explicite. Sa participation au volume collectif dirigé par Simon, The State of Humanity, aux côtés de Patrick Michaels et Laurence Kulp, confirme encore son adhésion à cette orientation intellectuelle.
La trajectoire de Singer évolue ainsi progressivement d’un profil de physicien de la guerre froide vers celui d’un acteur central du déni organisé. Les compétences scientifiques qui avaient contribué à l’institutionnalisation de la météorologie satellitaire deviennent des instruments mobilisés dans des campagnes destinées à retarder la régulation des pluies acides, des substances destructrices de la couche d’ozone, de la fumée de tabac ou encore des gaz à effet de serre. Singer ne s’emploie que rarement à nier directement les phénomènes documentés par la recherche ; il préfère amplifier les incertitudes résiduelles, insister sur les coûts économiques associés à toute action publique et promouvoir des solutions fondées sur les mécanismes de marché. Aux côtés de Frederick Seitz, William Nierenberg et Robert Jastrow, il s’impose ainsi comme l’un des architectes majeurs du scepticisme climatique organisé.
1 Revelle, Roger, Chauncey Starr, and S. Fred Singer. “What to Do About Greenhouse Warming: Look Before You Leap.” Cosmos: A Journal of Engineering and Science 5, no. 2 (1991): 28–33.
2 Revelle, Roger, and Hans E. Suess. “Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO₂ During the Past Decades.” Tellus 9, no. 1 (1957): 18–27.
Source : Naomi Oreskes et Erik M. Conway, Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, New York, Bloomsbury Press, 2010.
William A. Nierenberg
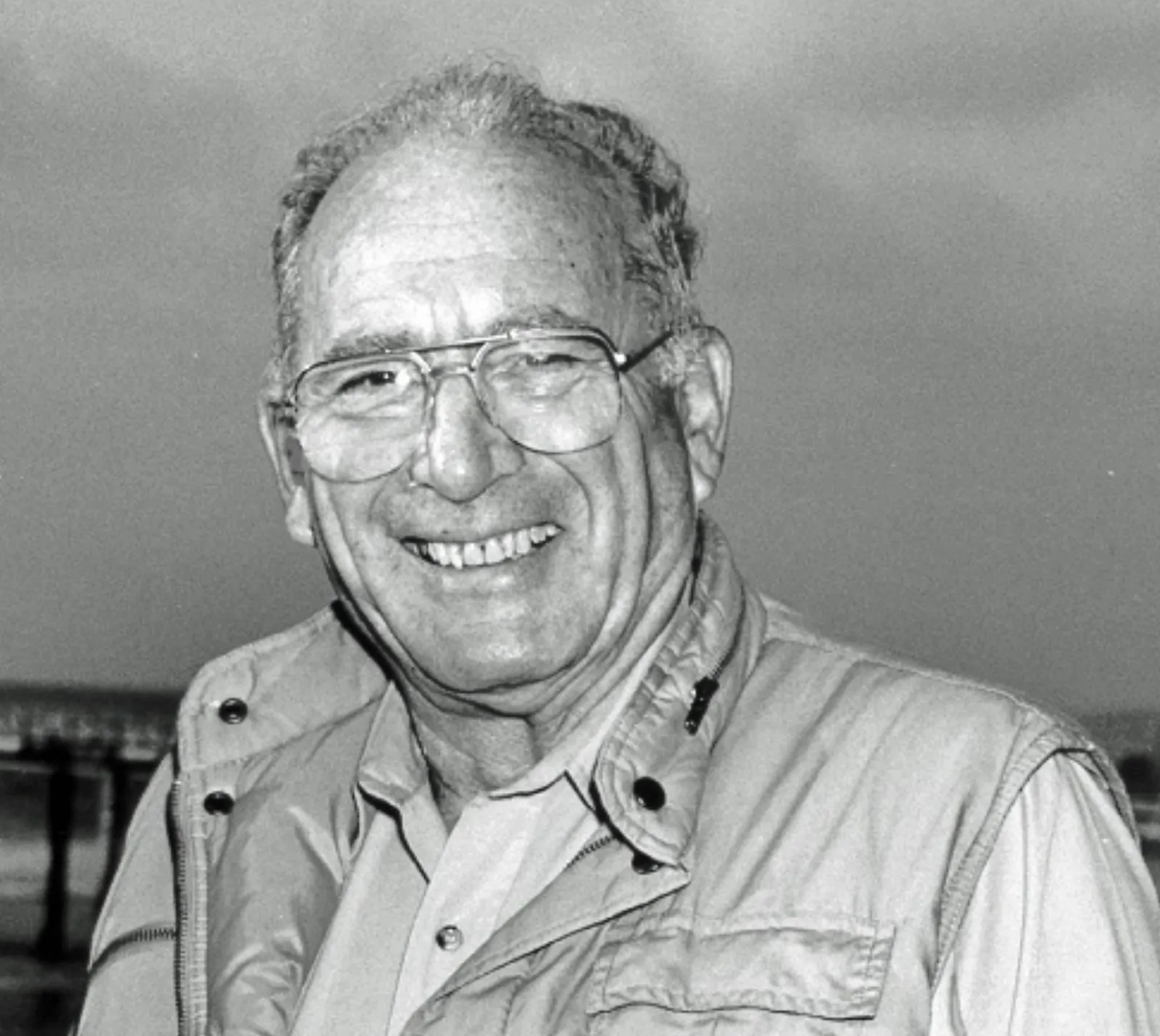
William Aaron Nierenberg (1919-2000) est un physicien de la génération de la guerre froide dont l’autorité scientifique et l’engagement politique font de lui une figure clé de la gestion des sciences environnementales sous l’administration Reagan. Formé à l’université de Columbia pendant le projet Manhattan, il dirige ensuite les laboratoires Hudson de Columbia avant de devenir, en 1965, directeur de l’Institut d’océanographie Scripps, où il consolide les liens étroits entre l’océanographie et la recherche financée par l’armée.
Dans les années 1970, Nierenberg s’impose à la fois comme un administrateur de premier plan et comme un conservateur au franc-parler. Il soutient la guerre du Vietnam, critique le mouvement étudiant et adopte une position combative à l’égard de l’environnementalisme, en particulier dans son opposition à l’énergie nucléaire. Ces positions font de lui un atout précieux pour le programme de Ronald Reagan. Il fait partie des équipes de transition de l’administration, est envisagé pour le poste de conseiller scientifique, rejoint le National Science Board et est consulté à plusieurs reprises sur des questions de défense et d'énergie.
Son rôle le plus marquant se manifeste lors de la controverse sur les pluies acides au début des années 1980. À cette époque, des recherches approfondies menées en Amérique du Nord et en Europe démontrent que les émissions de dioxyde de soufre provenant du charbon et du pétrole constituent la principale cause des précipitations acides. Les rapports de l’Académie nationale et de l’Agence de protection de l’environnement appellent à une réduction drastique des émissions. Confrontée à ces conclusions et à la perspective de réglementations coûteuses, l’administration Reagan commande une nouvelle étude à l’Office of Science and Technology Policy, qu’elle confie à Nierenberg.
Le "panel Nierenberg" confirme largement le consensus scientifique : les pluies acides sont réelles, anthropiques et nuisibles, et il recommande de réduire rapidement les émissions. Cependant, une fois rédigé, le rapport est modifié sous la pression politique. Sur l’insistance de la Maison Blanche, Fred Singer est ajouté au panel et rédige une annexe dissidente qui met l’accent sur l’incertitude et les coûts. Plus important encore, le résumé destiné aux décideurs est révisé en consultation avec la Maison Blanche : les termes forts appelant à une réduction rapide des émissions sont adoucis, l’incertitude est mise en avant et les progrès réalisés dans le cadre des lois existantes sont valorisés. Plusieurs membres du panel protestent contre ces modifications non autorisées, mais Nierenberg les laisse en l’état, offrant ainsi à l’administration un prétexte pour reporter toute action.
À court terme, son autorité permet à Reagan de bloquer les initiatives du Congrès, de faire stagner les négociations bilatérales avec le Canada et de retarder l’adoption d’une réglementation substantielle jusqu’aux amendements de 1990 à la Clean Air Act. À plus long terme, Nierenberg maintient et même accroît son influence grâce au George C. Marshall Institute. Cofondé en 1984 par lui-même, Robert Jastrow et Frederick Seitz, cet institut devient une plateforme centrale pour remettre en question la science du climat. La trajectoire de Nierenberg montre comment les physiciens de la guerre froide, façonnés par le complexe atomique et militaro-industriel, en viennent à mobiliser leur autorité non pas pour nier purement et simplement les sciences environnementales, mais pour amplifier l’incertitude et mettre en avant les coûts économiques afin de retarder la réglementation.
Fidèle à son idéologie et à ses méthodes, Bill Nierenberg devient également une figure clé des débats scientifiques et politiques autour du changement climatique lorsqu’il est nommé président du Comité d’évaluation du dioxyde de carbone (voir le portrait de Thomas Schelling dans le chapitre 4).
Source : Naomi Oreskes and Erik M. Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (New York: Bloomsbury Press, 2010).
Russell Vought

Russell Vought est l'actuel directeur du Bureau de la Gestion et du Budget (Office of Management and Budget - OMB) de l'administration Trump - poste qu'il retrouve après l'avoir déjà occupé de juillet 2020 à janvier 2021. Vought, qui aime à se définir comme un nationaliste chrétien, a été pendant sept ans le vice-président de Heritage Action for America, organe de lobbying et de plaidoyer du think tank conservateur The Heritage Foundation, et attaché à soutenir des candidats prompts à “restaurer l'épanouissement humain”.
En 2021, il a fondé le Center for Renewing America, un groupe de réflexion ouvertement réactionnaire qui vise à rendre à l'Amérique sa qualité de “nation soumise à Dieu”, que ce soit en promouvant le christianisme au sein du gouvernement, ou en purgeant un “État profond” prétendument infiltré par la “théorie critique de la race “(Critical Race Theory) et “l'idéologie radicale woke”.
À la fois libertarien et défenseur du privilège exécutif, Russell Vought a rédigé le chapitre sur le Bureau Exécutif du Président des États-Unis dans le Projet 2025 de The Heritage Foundation. Pour lui, il est indispensable de s'attaquer à l'État administratif pour deux raisons principales. D'une part, parce qu'il est “excessivement coûteux” - et doit donc faire l'objet de coupes sombres. D'autre part, parce qu'il est politiquement trop ambitieux, dans la mesure où les agences publiques ont tendance à vouloir usurper le pouvoir exécutif du Président.
Le rôle de l'OMB, outre d'établir le budget de l’État, est de déterminer si les programmes, les politiques et les procédures des agences américaines sont conformes aux politiques du Président. À la tête de son ministère, main dans la main avec le Département de l'Efficacité Gouvernementale d'Elon Musk, Russell Vought joue un rôle clé dans la réduction des budgets fédéraux, le démantèlement des agences associées à l'”État profond” et le licenciement d'un grand nombre de fonctionnaires. Mais au-delà de ces considérations budgétaires, le Républicain conservateur est également investi d'une mission, celle de s'assurer que les agents de l’État font preuve d'une double loyauté : envers Dieu, en adhérant aux valeurs nationalistes chrétiennes qui lui sont chères, et envers Donald Trump, en s'engageant à mettre en œuvre sans ambages l'agenda du Président.
Kyle Rittenhouse

Un homme “qui a pour seule qualification de tuer des gens engagés dans la défense des vies noires et de s’en tirer sans dommage.” C’est ainsi que Cori Bush, alors députée démocrate du Missouri, a défini Kyle Rittenhouse en 2021. Le jeune meurtrier venait en effet d’être reconnu non-coupable dans le procès qui lui avait été intenté pour homicide volontaire, tentative d’homicide et mise en danger de la vie d’autrui. Le 25 août 2020, il avait pourtant abattu deux personnes dans la ville de Kenosha, au Wisconsin : Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, deux manifestants venus protester contre le meurtre de Jacob Blake par un policier local. Rittenhouse a ensuite blessé un troisième homme, Gaige Grosskreutz, qui tentait de mettre fin à la tuerie en braquant une arme de poing sur lui. Alors même que ses deux premières victimes n’étaient pas armées – sinon d’un skateboard dans le cas de Huber – et qu’il était de son côté en possession d’un fusil semi-automatique AR-15, la future coqueluche de l’écosystème MAGA a été acquittée au motif de la légitime défense.
Rittenhouse avait 17 ans au moment des faits. Il était venu d’Antioch, dans l’Illinois, pour œuvrer à Kenosha en tant que ‘’vigilante’’, c’est-à-dire comme milicien volontaire. Son but, expliquera-t-il lors des audiences, était d’empêcher les militants anti-racistes de s’en prendre à la sécurité et à la propriété des honnêtes commerçants. Paradant dans les rues avec son fusil chargé, il a tiré lorsque Rosenbaum, Huber et Grosskreutz ont successivement tenté de le désarmer.
Pendant le procès et davantage encore après son acquittement, tant les médias de droite et les groupuscules néofascistes que les élus républicains et leur base ont traité Rittenhouse en héros – deux tiers des électeurs de Donald Trump voyaient en lui un exemple de patriotisme. Il a été interviewé à deux reprises par le célèbre éditorialiste Tucker Carlson, qui officiait encore sur FOX News à l’époque et a obtenu un record absolu d’audience en l’interrogeant; les Proud Boys, l’une des principales organisations d’extrême droite, ont fait de lui leur mascotte ; quantité d’emplois et de stages lui ont étés offerts – tant par le lobby des armes que par des sénateurs et députés du parti trumpiste. Enfin, il a même été reçu, avec sa mère, par l’ex- et futur Président. La visite a eu lieu dans l’antre présidentiel de Mar-a-Lago en novembre 2021.
Après avoir tenté, sans guère de succès, de se lancer dans l’édition de jeux vidéo basés sur ses exploits, Rittenhouse est progressivement revenu dans l’ombre, même si le chapitre texan de la National Association for Gun Rights continue de faire appel à ses services et si Turning Point, l’association libertarienne dirigée par Charlie Kirk, s’obstine à organiser des événements où il est présenté comme le gendre idéal de l’Amérique. C’est que, comme le soulignait Cori Bush, tirer sur des manifestants désarmés est vraiment sa seule qualification.
En revanche, l’heure de gloire qu’a connu Rittenhouse demeure une importante piqûre de rappel pour quiconque douterait que la haine meurtrière est bien le plus puissant moteur du mouvement MAGA.
Joe le Plombier

12 octobre 2008, dimanche après-midi, un homme joue au football avec son fils dans le jardin de sa maison de Toledo, Ohio. Image d’Épinal de l’Américain ordinaire. Samuel Joseph Wurzelbacher s’apprête alors à devenir un héros populaire, celui des “vrais gens”, ceux qui travaillent dur mais sont harassés d’impôts au profit de toutes sortes de parasites.
Ce jour-là, Barack Obama mène campagne dans ce quartier ouvrier, suivi par les caméras de ABC News. Le voyant passer devant sa clôture, Samuel Wurzelbacher l’interpelle. Il aimerait que le candidat démocrate justifie sa proposition d’augmenter les impôts des petites entreprises. Comme il le racontera plus tard au groupe d’extrême droite Family Security Matters, il commence par demander au sénateur de l’Illinois s’il croit au rêve américain. Obama lui répondant par l’affirmative, le père de famille s’enquiert donc : “Alors pourquoi vous voulez me pénaliser pour essayer de réaliser ce rêve ?”.
Son rêve américain à lui, c’est “une maison, un chien, quelques fusils, un bateau de pêche1” et monter sa propre entreprise de plomberie. Il en est empêché par une crainte, celle que les Démocrates redistribuent indûment son argent à d’autres. “Ce n’est pas que je veuille punir votre réussite, lui répond Barack Obama. Je veux juste m’assurer que tous ceux qui sont derrière vous aient aussi une chance de réussir. Je pense que si l’économie est bonne pour les gens en bas de l’échelle, alors elle est bonne pour tout le monde”. Le candidat démocrate précise également que l’augmentation d’impôt ne concernerait que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 000 $. Mais l’argument ne convainc pas Wurzelbacher qui voit là “la pente glissante” du socialisme prompt à exploiter la sueur des braves gens.
Le camp républicain s’empare immédiatement de la figure de celui à qui il attribue le surnom de “Joe le plombier”, dérivé du “Joe Six-Pack” ou “ordinary Joe”. Soit l’incarnation de l’Américain moyen, qui ne ménage pas sa peine, et qui serait malmené plus qu’il ne l’était déjà en cas de victoire d’Obama. Sarah Palin le porte au pinacle. John McCain l’invoque à plus de vingt reprises lors du débat entre les candidats à la Maison blanche et lui adresse même un message direct face caméra : “Joe, je veux te dire, je maintiendrai tes impôts à un niveau bas”. L'occasion est trop belle pour les commentateurs conservateurs qui voient en Joe le plombier le meilleur argument pour défendre la politique populiste de l’offre défendue par les Républicains.
Le petit contribuable, col bleu, masculin et blanc, avait déjà été adopté comme partenaire de la politique fiscale du GOP au début du mandat de Ronald Reagan. Œuvrant généralement dans les secteurs du bâtiment ou du camionnage, entrepreneur individuel ambitieux, il incarne le courage et l’abnégation face aux travailleurs féminisés et racisés du secteur public et à leurs revendications salariales inflationnistes. Patron indépendant évoluant dans des domaines qui nécessitent rarement d’obtenir un diplôme universitaire, il personnifie en outre le bon sens du peuple face à l’élite intellectuelle déconnectée et de gauche.
Melinda Cooper note que ce groupe démographique était surreprésenté parmi les partisans du Tea Party lors de la vague populiste de droite des années 20103. Et ces propriétaires de petites entreprises sont restés, depuis l’allégeance du parti de Sarah Palin à Donald Trump en 2016, les défenseurs les plus enthousiastes et les plus fidèles du président américain.
Samuel Wurzelbacher a tenté de surfer sur sa popularité dans les années qui ont suivi son altercation avec Barack Obama. En 2012, il s’est présenté au Congrès sous les couleurs des Républicains. Pendant sa campagne, se revendiquant “politiquement incorrect”, il a multiplié les déclarations polémiques, expliquant notamment que si l’Allemagne nazie avait pu perpétrer l’Holocauste, c’était en raison des lois européennes sur la limitation des armes à feu qui avaient empêché les victimes de se défendre. Ou encore, qu’il serait bon de “commencer à tirer” sur les Mexicains. S’il a remporté l’investiture GOP, il a lourdement échoué face à sa concurrente démocrate.
Au moment de son pic de célébrité, des journalistes du journal local, le Toledo Blade, se sont penchés sur le profil de Joe le plombier. Ils ont non seulement découvert qu’il devait près de 1200 $ aux impôts, mais surtout qu’il n’avait jamais eu de licence de plombier.
1 Martin Pengelly, “‘Joe the Plumber’, who challenged Obama on taxes in 2008, dies aged 49”, The Guardian, 28 Aug 2023.
2 Cooper, Melinda (2024) Counterrevolution: Extravagance and Austerity in Public Finance. New York: Zone Books (Near Futures series)
JD Vance

JD Vance fait partie de ces personnalités publiques dont le récit qu’elles produisent sur elles-mêmes est un écran de fumée masquant leurs alliances réelles. Né à Middletown, en Ohio, le futur vice-président est d’abord élevé par une mère victime de la crise des opioïdes. Celle-ci touche particulièrement la région désindustrialisée des Appalaches où vit une population blanche pauvre et taxée par le reste du pays du terme péjoratif de “hillbilly” – un équivalent de “beauf”. Sa mère offrant un foyer instable, ses grands-parents prennent en charge l’éducation de JD. Selon ses dires dans son autobiographie Hillbilly Elegy, c’est d’abord sa grand-mère, en le poussant à suivre ses études sérieusement, et ensuite l’armée, en lui imposant un cadre strict lors de quatre années – dont six mois en 2005 en tant que journaliste militaire en Irak –, qui lui ont permis d’échapper au sort de ses pairs hillbillies et de sortir de la misère en empruntant la voie royale. Il bénéficie en effet de la célèbre G.I. Bill, qui lui ouvre les portes de l’Université de l’Ohio en 2007 puis de Yale en 2010 pour des études de droit. C’est d’ailleurs une de ses professeurs à Yale, Amy Chua, qui l’encouragera à écrire Hillbilly Elegy. Publié en 2016, l’ouvrage reçoit un accueil largement favorable, atteint la liste des best-sellers du New York Times et est même adapté au grand écran en 2020. Il est cependant fortement critiqué pour ses faux airs d’ouvrage sociologique. Vance contribue en effet à populariser le narratif selon lequel les franges blanches pauvres américaines ont commencé à soutenir Trump en raison d’un affaiblissement physique et moral lié à l’addiction. Largement misérabiliste et généralisant son cas individuel en faisant fi des travaux de recherche portant spécifiquement sur la pauvreté dans les Appalaches, Hillbilly Elegy a propulsé JD Vance au rang de personnalité publique critique de Trump. D’aucuns, y compris chez les libéraux et à gauche, allaient même jusqu’à lui reconnaître le mérite d’expliquer le phénomène Trump.
En parallèle avec ses aspirations à devenir le prophète des Appalaches, JD Vance s’est frayé un chemin dans les milieux du capital-risque grâce à Peter Thiel. Après avoir assisté à une conférence que l’entrepreneur a donnée à Yale, Vance lui écrit pour lui demander de lui donner sa chance. Impressionné, selon ses dires, par la motivation de Vance et ce qu’il avait à offrir, Thiel l’embauche dans la société de capital-risque qu’il a co-fondée, Mithril Capital, de 2016 à 2017 – même si Vance consacre majoritairement son temps à la promotion de son livre1. En 2017, l’auteur de Hillbilly Elegy retourne en Ohio : comme il le raconte dans le New York Times, ce retour est motivé par la lassitude qu’il ressent à l’égard de ses collègues de la Silicon Valley, qu’il trouve déconnectés de la réalité du reste du pays2. À Colombus, Ohio, il fonde une organisation philanthropique, Our Ohio Renewal, visant à combattre la crise des opioïdes dans cet État du Midwest. L’organisation cessera toute activité en 2021, avec un faible bilan à son actif: elle n’a récolté récolté qu’environ 220 000$ en 2017, dont 80 000$ provenant des poches de Vance lui-même, et moins de 50 000$ de 2018 à 20213. Plutôt que de renouveler l’Ohio, les salariés de l’organisation expliqueront avoir eu l’impression de relancer la carrière de JD Vance, soit de lui fournir une occasion de se lancer en politique4. De fait, le New York Times relève que la plupart des fonds récoltés ont servi à payer un consultant politique qui a conseillé à Vance de candidater aux élections de 2018 pour le Sénat américain – ce qu’il n’a pas fait –, ainsi qu’un assistant pour écrire ses discours politiques. Plus gênant encore, Our Ohio Renewal a financé la résidence dans les Appalaches de l’addictologue et psychiatre Sally Satel, qui, de 2004 à 2016, a entretenu des liens étroits avec Purdue Pharma, l’entreprise responsable de la crise des opioïdes. Entre autres, Dans un article d’opinion publié par le New York Times, Satel a minimisé le rôle de Purdue dans cette crise - responsable de la mort de des centaines de milliers de personnes. Pis encore, elle a cité des recherches produites par l’entreprise dans ses articles de presse et a même partagé ses brouillons d’articles avec l’entreprise avant publication5.
Tout en se livrant à son opération de marketing philanthropique, Vance continue de travailler dans le capital-risque : de 2017 à 2019, il est salarié par Revolution LLC, et est chargé de l’initiative “Rise of the Rest”, dont l'objectif est de promouvoir la culture du capital-risque en-dehors de la Silicon Valley en offrant du capital à de jeunes entreprises du Midwest et des Appalaches. Une telle opération doit lui permettre de concilier son activité professionnelle avec l’image qu’il tente de se donner d’homme proche du peuple. En 2020, il fonde Narya Capital, une société de capital-risque basée à Cincinnati, Ohio, avec le soutien financier de Peter Thiel (qui a fourni 15% du capital initial), de l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, et du puissant capital-risqueur Marc Andreessen.
En 2021, Vance débute officiellement sa carrière politique en déclarant sa candidature au siège de sénateur de l’Ohio. Jusque-là critique de Trump, il se convertit au républicanisme MAGA et recueille aussitôt les bonnes grâces de l’ancien président – sûrement autant le résultat d’un calcul électoral que de sa longue fréquentation de Thiel et de son entourage dans le capital-risque. Les sources de financement de sa campagne révèlent ses véritables alliances, par-delà les discours anti-élitistes : Vance est largement financé par Thiel, qui a versé 15 millions de dollars pour sa campagne6, ainsi que par les familles Mercer, Uihlein et Lindner, grandes familles bénéficiaires du capitalisme patrimonial jouant un rôle moteur dans l’extrême droitisation de la politique américaine. Ensemble, ces riches et droitiers bienfaiteurs ont contribué à sa campagne à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars7. Vance est également un des candidats favoris de l’industrie des énergies fossiles, qui lui offrent 340 000$8. Doté de la sorte, il gagne les primaires républicaines en mai 2022 et est élu en novembre. Durant son mandat, il soutient plusieurs propositions de loi visant à supprimer les mesures de diversité, d’inclusion et d’équité (DEI) et à criminaliser les interventions chirurgicales d’affirmation du genre pour les mineurs.
Après l’avoir encouragé à candidater aux élections sénatoriales et avoir financé sa campagne, ce sont encore ses amis du capital-risque et de la tech qui vont ouvrir les portes de la Maison Blanche à J.D. Vance. Le Washington Post rapporte que Trump a reçu de nombreux appels de David Sacks - l’entrepreneur de la tech maintenant “tsar de la crypto et de l’IA” - ainsi que de Thiel et de son collègue à Palantir Jacob Helberg, lui demandant de choisir Vance comme vice-président. Celui à qui cette alliance avec la tech a valu le surnom de “shillbilly” est officiellement inauguré vice-président le 20 janvier 2025. Bras droit de Trump, Vance joue un rôle actif dans le tournant conservateur-révolutionnaire opéré aux États-Unis. Opposé aux droits reproductifs, tardivement converti à un catholicisme nationaliste et réactionnaire sous les conseils de Peter Thiel - lequel jouerait également auprès de lui le rôle d’autorité spirituelle - le vice-président se pose à la fois en promoteur décomplexé du suprémacisme blanc et du masculisme, mais non sans seconder les ambitions des brasseurs de capital-investissement et de capital-risque.
1 “Inside the powerful Peter Thiel network that anointed JD Vance”, Elizabeth Dwoskin, Cat Zakrzewski, Nitasha Tiku, and Josh Dawsey, July 28, 2024, Washington Post
2 “Why I’m moving home” JD Vance, March 16, 2017, New York Times
3 Voir Our Ohio Renewal, ProPublica : https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/821611741
4 “ J.D. Vance’s First Attempt to Renew Ohio Crumbled Quickly”, David A. Fahrenthold, Oct. 8, 2022.
5 “Inside Purdue Pharma’s Media Playbook: How It Planted the Opioid “Anti-Story””, David Armstrong, Nov. 19, 2019, ProPublica.
L’article en question publié dans le New York Times : “Doctors Behind Bars: Treating Pain is Now Risky Business”, Sally Satel, Oct. 19, 2004
6 Thiel a effectué un versement de 10 millions de dollars, un de 3,5 millions et un de 1,5 million au PAC de JD Vance pour sa campagne, “Protect Ohio Values” https://www.opensecrets.org/po...
7 “The billionaire who fueled JD Vance’s rapid rise to the Trump VP Spot”, Daniel Klaidman, July 16, 2024 CBS News. “Vance's super PAC also received hundreds of thousands in contributions from the Mercer, Uihlein and Lindner families, all staples of mega-conservative political giving in recent years.”
8 “Climate advocates fear picking JD Vance for VP is a ‘dangerous step backward’”, Nina Lakhani, 16 Jul 2024, The Guardian.
Newt Gingrich

Newt Gingrich revendique fièrement sa place parmi les précurseurs du trumpisme. Le programme du 47e président, écrit-il dans son dernier ouvrage intitulé Trump’s Triumph, s’inscrit dans “l’héritage de Barry Goldwater, de Ronald Reagan et, pour être franc, du mien”. Derrière cette emphase, son propos n’est toutefois pas dénué de fondement.
Né en 1943, fils de militaire en partie élevé en Europe, Gingrich s’installe en Géorgie avec sa famille à l’âge de seize ans. Diplômé de l’université Emory, il poursuit des études de doctorat en histoire à l’université Tulane, où il soutient en 1971 une thèse non publiée consacrée à l’éducation au Congo sous domination coloniale belge.
Très tôt, sa préférence va à la politique plutôt qu’à la carrière universitaire. Candidat au Congrès dès 1974, en tant que républicain modéré et nixonien, il remporte finalement le siège du 6ᵉ district de Géorgie lors de sa troisième tentative, en 1978. Entre-temps, il a rencontré Paul Weyrich, cofondateur de la Heritage Foundation et créateur du concept de moral majority. Weyrich, qui s’était donné pour mission de former une nouvelle génération de candidats conservateurs au Congrès, perçoit immédiatement le potentiel de Gingrich.
À peine élu, celui qui deviendra président de la Chambre des représentants affiche sans détour ses ambitions. Il entend les réaliser en bousculant les règles de préséance internes à son propre parti et en menant des attaques systématiques contre les dirigeants démocrates. Son arrivée au Congrès coïncide avec la création de C-Span (Cable-Satellite Public Affairs Network), qui retransmet pour la première fois en direct les débats parlementaires. Gingrich se montre particulièrement habile à exploiter ce nouveau dispositif médiatique à des fins personnelles et politiques.
Pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, que les Républicains n’avaient plus dirigée depuis 1952, Gingrich met en œuvre une stratégie offensive visant à discréditer la direction démocrate. Il cible successivement les présidents de la Chambre qu’il ambitionne de supplanter, d’abord Tip O’Neill, puis son successeur Jim Wright, qu’il accuse d’un manque de patriotisme et de manquements aux règles éthiques. S’il échoue à ébranler la réputation d’O’Neill, sa campagne finit néanmoins par provoquer la démission de Wright en 1989.
Ironie révélatrice : le grief principal qu’il adresse à Wright porte sur la vente de son livre lors d’événements publics organisés par le Congrès, en violation supposée des règles éthiques - accusation qui visait également Gingrich au même moment. Cette stratégie consistant à reprocher à ses adversaires des pratiques qu’il partage avec eux deviendra récurrente. En 1992, il accuse les Démocrates d’avoir abusé de leurs comptes bancaires parlementaires - pratique dont il s’est lui-même rendu coupable - et en 1998, il engage la procédure de destitution de Bill Clinton dans l’affaire Monica Lewinsky, alors qu’il entretient lui-même une liaison extraconjugale avec une femme beaucoup plus jeune.
Après la démission de Jim Wright, Gingrich est élu minority whip (chef de la minorité républicaine). Fidèle aux préceptes de Weyrich, il use de sa nouvelle position pour durcir encore l’agenda reaganien, allant jusqu’à s’opposer au président George H. W. Bush lorsque ce dernier renonce à son engagement de ne pas augmenter les impôts (‘read my lips: no new taxes”), tout en imposant à ses collègues républicains ses méthodes d’affrontement permanent.
Revigoré par l’élection de Bill Clinton à la présidence en 1992, Gingrich redouble d’efforts pour miner l’agenda du nouveau président. À l’approche des élections de mi-mandat de 1994, il rédige, avec Dick Armey - président de la conférence républicaine de la Chambre - et sous l’égide de la Heritage Foundation, le Contract with America. Ce programme visait à unifier les candidats républicains autour d’une plateforme nationale — seuls deux candidats républicains refuseront de le signer — et à signaler à l’administration Clinton qu’elle ferait face à une opposition parlementaire résolument conservatrice. Le contrat prévoyait notamment l’équilibre budgétaire couplé à des baisses d’impôts pour les PME et les familles, des réformes drastiques de la sécurité sociale et des prestations sociales, ainsi que l’instauration de limites au nombre de mandats parlementaires.
La victoire des Républicains lors des élections de mi-mandat leur permet de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants pour la première fois en quarante ans. Fort de ce succès, Gingrich accède à la présidence de la Chambre. Il s’engage alors à faire adopter l’intégralité des mesures du Contract with America dans les cent premiers jours du 104ᵉ Congrès. S’il n’y parvient que partiellement, malgré deux paralysies budgétaires imposées pour contraindre la Maison-Blanche, son intransigeance et sa stratégie d’obstruction finissent néanmoins par porter leurs fruits.
Les mesures les plus inégalitaires de l’ère Clinton portent clairement son empreinte — en particulier la réforme de l’aide sociale (Personal Responsibility and Work Opportunity Act) et la loi fiscale (Taxpayer Relief Act), qui comprend la plus importante réduction de l’impôt sur les plus-values de l’histoire des États-Unis. Par ailleurs, en polarisant la Chambre — ou peut-être grâce à cette radicalisation —, Gingrich parvient à maintenir la majorité républicaine lors des élections de 1996, malgré la réélection de Clinton.
Au début de l’année 1997 toutefois, le président reconduit de la Chambre va trop loin. Ses collègues républicains finissent par se lasser de la contradiction flagrante entre son ton inquisitorial et l’accumulation de mises en cause pour manquements éthiques. Après l’ouverture d’une procédure disciplinaire qui l’accuse d’avoir sciemment enfreint les règles parlementaires, une large majorité bipartisane vote le blâme.
Loin de renoncer, Gingrich tente de restaurer son autorité en reprenant la méthode qui a fait sa notoriété : abattre un haut responsable démocrate. Porté par l’émergence du scandale Clinton-Lewinsky, il prend la tête de la procédure de destitution du président, qu’il fait du même coup le thème central des élections de mi-mandat de 1998. Mais l’opération échoue : les Républicains perdent leur majorité à la Chambre. Conscient qu’un putsch interne se prépare contre lui, Gingrich se retire aussitôt de la présidence de la Chambre et annonce qu’il ne se représentera pas en 2000.
Éloigné du Congrès, l’ancien président de la Chambre demeure actif dans les cercles conservateurs, notamment à la Hoover Institution et à l’American Enterprise Institute. En 2007, il fonde l’organisation American Solutions for Winning the Future — financée par le milliardaire républicain Sheldon Adelson — chargée de promouvoir la déréglementation, l’exploitation pétrolière offshore et même l’extraction charbonnière. En 2011, il se porte candidat à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle. Battu par Mitt Romney lors des primaires, il consacre les années suivantes à restructurer la lourde dette de sa campagne.
En 2015, Newt Gingrich figure parmi les premiers responsables républicains de premier plan à soutenir la candidature de Donald Trump. Un temps pressenti pour être son colistier, il reste un conseiller informel et un soutien fidèle du président. Son épouse actuelle, Callista Gingrich - avec laquelle il entretenait une liaison lors de la procédure de destitution de Bill Clinton - occupe, sous l’administration Trump, des fonctions diplomatiques : d’abord ambassadrice des États-Unis auprès du Vatican durant le premier mandat, elle est aujourd’hui ambassadrice en Suisse.
Ludwig von Mises

La littérature sur le néolibéralisme présente souvent les pères fondateurs du mouvement comme des libéraux, tant sur le plan politique qu'économique. Leur souci premier aurait été de s'opposer à la montée des totalitarismes, qu'il s'agisse du nazisme, du fascisme ou du stalinisme. Pourtant, un examen plus approfondi des débuts du mouvement montre que ses représentants autrichiens - Ludwig von Mises et son protégé Friedrich Hayek en particulier - étaient avant tout préoccupés par le déclin des empires, dans le sillage de la Première Guerre mondiale, et par la montée en puissance du socialisme, y compris sa variante sociale-démocrate.
Né à Lemberg (aujourd'hui Lviv) en 1881, Ludwig von Mises s'est fait connaître dans les rangs de l'École autrichienne d'économie en menant la charge contre le socialisme. Développant un long article écrit en 1920, son livre Socialism : An Economic and Sociological Analysis, publié deux ans plus tard, a lancé ce que l'on a appelé le “débat sur le calcul économique en régime socialiste”, qui opposait les défenseurs du libre marché comme Mises lui-même, Hayek ou encore Max Weber, aux partisans de la “planification rationnelle socialiste” tels que Otto Neurath.
Mises soutenait que seul le marché peut rendre compte de la complexité et de l'hétérogénéité des désirs individuels, et donc optimiser leur satisfaction. Les relations marchandes, expliquait-il, sont capables de traduire les préférences subjectives en utilités comparables parce qu'elles seules reposent sur cet instrument magique qu'est le mécanisme des prix. Selon les économistes autrichiens en effet, les prix sont des signaux informant les membres d'une société de ce que les autres veulent et de ce qu'ils ont à offrir. Dans la mesure où ils ne sont pas faussés, ils permettent donc aux acteurs du marché d'élaborer leurs propres plans librement et efficacement.
En revanche, selon Mises, les planificateurs ne peuvent formuler que des hypothèses grossières sur les besoins des citoyens qu'ils gouvernent. Incapables de discerner les aspirations et les aptitudes spécifiques de chacun, leurs calculs sont voués à produire des résultats médiocres et à engendrer un mécontentement généralisé au sein de la population. La force de la rhétorique de Socialism réside dans son appel à la rationalité : quoi que l'on pense des intentions et des valeurs des socialistes, le livre affirme que leur projet est voué à l'échec puisque le mécanisme des prix n'y a aucune place. Selon les propres termes de Mises, le programme socialiste conduit à “l'abolition de l'économie rationnelle1”.
Si sa critique a ancré un défi au long cours pour la gauche, Mises s'est un peu laissé emporter par ce qu'il considérait comme sa victoire définitive dans le débat sur le calcul. Contrairement à Hayek, qui l’avait suivi dans son attaque contre la planification, il ne s'est pas contenté de défendre les thèses qui allaient devenir la doctrine néolibérale standard, comme la réaffectation du rôle de l'État ou la critique de la notion de justice sociale. D'une part, la confiance de Mises dans le pouvoir immanent des prix était telle qu'au lieu de se contenter d'appeler l'État à protéger les mécanismes du marché contre les revendications démocratiques, il s'est rallié sans réserve au souhait libertarien de se débarrasser complètement de l'État. D'autre part, loin de se contenter de mettre en garde contre les effets pervers des politiques publiques égalitaires, il proclame que l'égalité elle-même est une notion fallacieuse : “Tout le pouvoir humain serait insuffisant pour rendre les hommes réellement égaux”, écrit-il dans son livre Liberalism, publié en 1927. “Les hommes sont et resteront toujours inégaux”.
Mises a avant tout formulé son opposition de principe à l'égalité en invoquant la méritocratie : tous les individus n’ont pas la chance d’être dotés des mêmes capacités, et contraindre ceux qui en ont le plus porterait préjudice à tout le monde. Cependant, comme le montre Quinn Slobodian dans Hayek’s Bastards, il était ouvert à la possibilité que les inégalités soient innées - “on peut supposer que les races diffèrent en termes d'intelligence et de volonté” -, mais aussi enclin à croire que les gens préféreraient n’évoluer qu’au sein de leur propre groupe ethnique - “il y a peu d'hommes blancs qui ne frémiraient pas à l'idée de millions de Noirs ou de Jaunes vivant dans leur propre pays” - et certainement assez libertarien pour les laisser opter pour la ségrégation sur la base qu'ils jugeraient la plus appropriée. Aussi est-ce pour de bonnes raisons que les paléolibertariens aux penchants suprémacistes ont élu domicile à l'Institut Mises.
1Voir William Callison, The Politics of Rationality in Early Neoliberalism: Max Weber, Ludwig von Mises, and the Socialist Calculation Debate” in JHI (83.2)
Curtis Yarvin

Curtis Yarvin est informaticien, mais il est surtout un blogueur très populaire dans l'écosystème de l'extrême droite. Sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, il a publié sur son blog - intitulé Unqualified Reservations - de 2007 à 2014 et publie aujourd'hui un Substack appelé Gray Mirror, qu'il a lancé en 2020.
Protégé de Peter Thiel et de Marc Andreessen - qui ont financé son projet Urbit, un serveur personnel et un réseau peer-to-peer lancé en 2013 - Yarvin cherche à moderniser la tradition paléo-libertarienne de Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Lew Rockwell et Hans-Hermann Hoppe pour l’adapter aux goûts des milliardaires de la tech et des incels qui rêvent de leur ressembler. Il reprend donc à son compte les déclarations de Hoppe sur la faillite de la démocratie - son Manifeste formaliste de 2007 qualifie celle-ci de “système de gouvernement inefficace et destructeur” qui provoque irrévocablement guerre et violence sans apporter la liberté aux citoyens - et propose de la remplacer par le régime autocratique propre aux entreprises mutantes telles que X, Meta ou Amazon.
Tout aussi épris des entrepreneurs tout-puissants de la tech d’aujourd’hui que des monarques absolus des débuts de l'ère moderne, Yarvin ne se repaît pas seulement de fantasmes préadolescents sur les fusées et les rois. Ce que lui et son alter ego - le philosophe amateur Nick Land, tenant de “l’accélérationnisme effectif” - appellent “les Lumières sombres” ou la néoréaction consiste à faire l’éloge d'une société divisée en un PDG/monarque, des actionnaires/courtisans riches mais soumis, des consommateurs dociles parce que satisfaits, des travailleurs asservis et étroitement contrôlés, et enfin une sous-classe composée de personnes racialement inférieures qui, à défaut d’être expulsées ou éliminées, seraient détenues indéfiniment.
Pour que son projet devienne réalité, Curtis Yarvin estime qu’il faire rendre gorge à la “Cathédrale” - à savoir un conglomérat formé d'universités d'élite, de médias libéraux, d'agences de l'État profond, d’intellectuels woke et de militants syndicaux ou associatifs. Jusqu'à récemment, le légataire autoproclamé de la tradition paléo-libertarienne pensait que seul un coup d'État pourrait arracher le peuple américain à l'emprise néfaste des idéologues progressistes. Cependant, le retour au pouvoir de Donald Trump lui a donné l'espoir qu'une transition plus douce était possible pour passer de l'état actuel de corruption démocratique à une république actionnariale dirigée par un PDG-roi enfin compétent. Les licenciements massifs de fonctionnaires de l'État profond par le DOGE d'Elon Musk et la déportation de migrants non-blancs par la police des frontières (ICE) sont autant de signes de bon augure à cet égard. Tout aussi encourageant est le fait que Yarvin lui-même est désormais reconnu comme un penseur important, non seulement par Peter Thiel et Mark Andreessen, mais aussi par des membres de haut rang du camp MAGA, tels qu'Elon Musk, Steve Bannon et J.D. Vance.
Si l'influence des élucubrations de Curtis Yarvin sur les milliardaires et les politiciens d'extrême droite est évidemment alarmante, ce qui est véritablement déplorable, c'est la propension de certains membres de ce qu'il appelle la “Cathédrale” à le tenir pour un interlocuteur légitime. Ainsi, après avoir été interviewé par le New York Timesen janvier 2025, le blogueur a plus récemment été invité à débattre avec la politologue Danielle Allen à l'université de Harvard. Comme le disait naguère l'historien français Pierre Vidal-Naquet, il est aussi peu recommandable de discuter de démocratie avec des fascistes - même idiots, pourrait-on ajouter - que de partager des recettes de cuisine avec des cannibales.
Murray Rothbard

Murray Rothbard (1926-1995) fut et demeure une figure intellectuelle centrale du mouvement libertarien aux États-Unis. Fondé sur le droit inaliénable des individus à posséder des biens, à en disposer comme ils l'entendent et à se libérer de toute obligation à laquelle ils ne sont pas contractuellement liés - sauf celle de ne pas porter atteinte aux droits de propriété d'autrui -, son libertarianisme a été inébranlable tout au long de sa vie. Sa fidélité envers cette conception maximaliste de la liberté individuelle l’a rendu hostile à toute forme d'intervention de l'État, que ce soit au nom de la justice sociale, de l'efficacité économique ou même de la sécurité nationale. Où il a fait preuve de plus de flexibilité, en revanche, c’est dans les choix stratégiques qu'il a adoptés pour faire avancer sa cause.
Élevé à New York par des parents juifs émigrés, Rothbard commence par gager le progrès de ses idées sur une Old Right déjà en perte de vitesse. Étudiant en économie à l'université de Columbia, il va même jusqu’à soutenir la candidature du sénateur ségrégationniste Storm Thurmond lors de la course présidentielle de 1948. Après avoir découvert l'École autrichienne d'économie et fait de Ludwig Von Mises son mentor, il a bénéficié du patronage du très conservateur Volker Fund, a écrit occasionnellement pour la National Review, et a rejoint la Société du Mont-Pèlerin dans les années 1950.
Cependant, Rothbard se sent bientôt de plus en plus mal à l'aise avec la droite fusionniste de William Buckley. Malgré son anticommunisme farouche, le soutien des conservateurs à l'impérialisme américain tout au long de la Guerre froide, et en particulier pendant la guerre du Viêt Nam, va à l'encontre de son pacifisme libertarien. Défendre la nation contre des ennemis extérieurs, soutient-il, est somme toute la manière dont l'État justifie son pouvoir despotique. D'où le bref flirt de Rothbard avec la Nouvelle Gauche anti-guerre à la fin des années 1960. Ayant forgé le concept d’anarcho-capitalisme, il nourrit l'espoir que les anarchistes de tous bords pourront s'unir contre le Big Government et tente même de défendre cet argument dans le magazine de gauche radicale Ramparts.
Rapidement désenchanté par l'idée d'un front anarchiste unifié, Rothbard décide de rejoindre les cercles néolibéraux, avec lesquels il a plus d’affinités, ce qui lui permettra de cofonder le Cato Institute au début des années 1970, avec l'aide financière de Charles Koch. Mais là encore, il est rapidement déçu quand il voit que l'aile hayékienne de l'institut se détourne du libertarianisme et se donne pour vocation de devenir un groupe de réflexion pour l'administration Reagan et le Parti républicain.
À la recherche d'un nouveau foyer, Rothbard le trouve à Auburn, en Alabama, où il crée, avec Lew Rockwell, le Mises Institute en 1982. Rockwell est à la fois un libertarien convaincu comme Rothbard et un fervent partisan de la ségrégation raciale, non certes en tant que politique d’état mais sur la base du volontariat. Les communautés devraient en effet être libres de choisir avec qui elles veulent cohabiter, soutient Rockwell. Or, si elles étaient en mesure d’exercer cette liberté, nul doute qu’elles choisiraient de s'entourer des membres de leur propre race. Rothbard, qui avait retenu la suggestion de son mentor Mises selon laquelle, nonobstant le nazisme, la théorie de la race pouvait contenir une part de vérité, s'empresse d'adopter le point de vue de son nouvel ami. Une société libertarienne, affirme-t-il désormais, exige des personnes culturellement et même naturellement disposées à comprendre et à apprécier les valeurs libertariennes. En revanche, une société exempte de ségrégation, et qui s’emploie en outre à proclamer l'égalité des races et des sexes, se condamne à produire une “sous-classe parasitaire” et un État nounou de plus en plus totalitaire pour répondre aux besoins de celle-ci.
Néanmoins, ce que Rothbard et Rockwell appellent maintenant le paléo-libertarianisme a besoin d'alliés pour prospérer. C’est dans l'autre camp paléo qu’ils vont alors les chercher, à savoir dans la coterie paléo-conservatrice, créée en réaction à la montée en puissance des néoconservateurs au sein du parti républicain. Les deux groupes se rencontrent à Dallas en 1990 et forment rapidement un club - le John Randolph Club, nommé, comme le raconte Quinn Slobodian, “d'après un esclavagiste dont la phrase fétiche était : “J'aime la liberté, je déteste l'égalité””. Lors de la campagne présidentielle de 1992, la paléo-alliance soutient la candidature de Pat Buchanan, qui veut tout à la fois abroger les lois sur les droits civiques des années 1960, les programmes sociaux du New Deal et l'interventionnisme impérial des États-Unis. Buchanan ne réussit pas à obtenir l'investiture républicaine et, quelques années plus tard, Rothbard lui tourne à son tour le dos. À lui et à sa cohorte de paléo-conservateurs, dont le protectionnisme, selon lui, “se transformait en une foi totale dans la planification économique et l'État-nation”.
Une fois de plus marginalisé, Rothbard n'a pas vécu assez longtemps pour assister à la renaissance de son credo paléo-libertarien. Sa mémoire perdure cependant parmi ses admirateurs de la Silicon Valley, mais aussi grâce à Javier Milei, le Président argentin, qui a donné le nom de Rothbard à son chien cloné préféré.
Robert Lighthizer

Né en 1947, Robert Lighthizer est un avocat spécialisé dans le droit commercial international. Il a travaillé, alternativement, dans des cabinets d'avocats privés et en tant que fonctionnaire pour deux administrations républicaines. Nommé représentant adjoint au Commerce par Ronald Reagan lors de son premier mandat, il retrouve ce poste - sans la qualité d’adjoint - trois décennies plus tard, lorsque Donald Trump accède pour la première fois à la Maison Blanche.
Lighthizer est connu pour ses positions agressives en matière de commerce international, notamment en raison des accusations de pratiques commerciales déloyales qu’il a formulées contre le Japon dans les années 1980, puis contre la Chine dans les années 2010 - accusations qui ont pris la forme de poursuites engagées au nom d’entreprises étatsuniennes lorsqu’il travaillait dans le privé, et qui sont à l’origine de sa fortune. Néanmoins, Robert Lighthizer est plus qu’un simple protectionniste convaincu. Selon lui, l'objectif des droits de douane n'est pas d’atteindre une forme d'autarcie, mais, paradoxalement, de réussir à maintenir marchés ouverts et libre-échange dans des conditions qu'il juge équitables pour les entreprises et les travailleurs américains. Raison pour laquelle il fut invité par Donald Trump à rejoindre sa première administration en 2017.
Ce que le 45e président des États-Unis appréciait chez son représentant au Commerce d’alors, c’était que ses convictions reflétaient les siennes : les États-Unis sont exploités par d'autres pays, y compris ses plus proches alliés. En outre, il appréciait la conviction de Lighthizer que les tarifs douaniers,s'ils sont utilisés de manière judicieuse et intransigeante, peuvent servir de substitut aux impôts. Une solution gagnant-gagnant s'il en est, du point de vue de Donald Trump. À l’entame de son second mandat, le président a même suggéré de créer un Service des Recettes Extérieures (External Revenue Service, ERS) qui percevrait les revenus tarifaires et compenserait ce que son agence sœur, l'IRS (Internal Revenue Service), ne serait plus en mesure de fournir en raison des réductions d'impôts massives.
Fait remarquable, Robert Lighthizer n'occupe pas, pour l'instant, de poste au sein de l'administration actuelle, alors que les droits de douane et la promesse de relocaliser, et de relancer, les industries américaines grâce à eux ont pris davantage d’importance encore dans le programme de Trump 2.0. Mais malgré sa probable déception, l'ancien représentant américain au Commerce demeure un fervent défenseur de la politique commerciale de Donald Trump : “Je soutiens fermement les mesures prises aujourd'hui par le président”, a déclaré Lighthizer à propos du ‘jour de la Libération’.
“Les politiques commerciales inefficaces de notre pays ont eu des effets dévastateurs sur nos travailleurs. Associer un tarif douanier de 10 % appliqué à tous les pays avec des taux plus élevés pour ceux qui affichent des excédents plus importants est exactement ce dont nous avons besoin pour revitaliser nos industries manufacturières, restaurer des emplois bien rémunérés et relancer l'Âge d'or de l'Amérique1.”
1 https://www.americafirstpolicy...
Peter Brimelow

Peter Brimelow est né en Angleterre en 1947. Citoyen américain naturalisé, il aime se faire appeler le parrain, ou du moins l’oncle protecteur, de l’Alt-right - titre qu’il mérite. Il a en effet joué le rôle de connecteur entre plusieurs segments de l'extrême droite: influent auprès de certains membres de l'entourage de Donald Trump - comme Stephen Miller et Larry Kudlow -, il s’emploie aussi à relayer les thèses de Charles Murray et Richard Herrnstein sur le répartition inégale de l'intelligence entre les races et contribue à la légitimation des suprémacistes blancs et néo-nazis les plus virulents qui entourent Richard Spencer.
Comme le rappelle Quinn Slobodian, Brimelow a connu une autre carrière avant d’endosser le rôle d’unificateur de la famille ethno-nationaliste. Jusqu'au début des années 1990, il a travaillé en tant que journaliste financier pour des publications généralistes, comme le Financial Post, Fortune, Forbes, Market Watch et National Review. À l'époque, il est connu pour être un publiciste du néolibéralisme ordinaire, que ce soit par ses articles, son premier livre (The Wall Street Gurus : How You Can Profit from Investment Newsletters) ou bien ses interviews avec des sommités telles que Milton Friedman et Thomas Sowell.
Ce qui pousse Brimelow à embrasser la cause nativiste et à devenir un fervent défenseur de la fermeture des frontières, explique Quinn Slobodian, c'est son désaccord avec une autre mouvance du “collectif de pensée” néolibéral. À la fin de la Guerre froide, les pages éditoriales du Wall Street Journal et des universitaires comme l'économiste Julian Simon défendent ardemment l'ouverture des frontières, pour les capitaux, les biens, mais également les personnes. La libre circulation du capital humain, affirment-ils alors, est cruciale pour l'innovation, les investissements, la prospérité et, en fin de compte, les profits. Déterminé à contrer cet argument au nom de ses propres prémisses, Brimelow écrit d’abord un article dans le National Review intitulé “Time to Rethink Immigration ?”, avant d'en faire un livre - Alien Nation. Common Sense About America's Immigration Disaster. En s’appuyant sur les propos de Herrnstein et Murray, selon lesquels le QI est déterminé par l’appartenance éthnique, il en vient à affirmer que si les marchés doivent être libres, tous les individus ne sont pas nécessairement capables d’en être des acteurs rationnels et efficaces. D'où la nécessité d’empêcher l’accès aux pays à QI élevé à certains types de migrants.
Bien que la grossièreté des arguments de Brimelow ne soit guère une bonne publicité pour l'intelligence blanche qu'il cherche à préserver, la parution d'Alien Nationreprésente une étape importante dans le “nouveau fusionnisme” des courants libertariens, xénophobes et suprémacistes de la droite américaine. En 1999, Brimelow compense son exclusion des médias grand public en fondant VDARE, un site web qui devient rapidement une référence pour les auto-proclamés “réalistes en matière de race” et les défenseurs de la fermeture des frontières. En 2024, Brimelow est contraint de suspendre VDARE suite à une enquête ordonnée par le procureur général de l'État de New York, Letitia James, qui remet en cause son statut d'organisation caritative. Toutefois, l'esprit de VDARE perdure tant au sein du parti républicain, qu’au cœur de la Maison Blanche.
Stephen Miller

Stephen Miller est le Chef de Cabinet adjoint de la Maison-Blanche chargé de la Politique et conseiller à la Sécurité intérieure des États-Unis. Il était déjà membre de l'administration Trump tout au long du premier mandat du président, en tant que conseiller principal pour la Politique et Directeur de la rédaction des discours de la Maison-Blanche. À ce titre, il a rédigé les politiques d'immigration les plus extrêmes de Trump, notamment le décret de 2017 imposant une interdiction de voyager aux citoyens de sept pays à majorité musulmane - l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen - et la politique de séparation des familles, qui visait à dissuader les migrants en éloignant les enfants de leurs parents à la frontière.
Fervent défenseur de la suprématie blanche depuis ses années de lycée en Californie, Stephen Miller a commencé sa carrière politique en tant que collaborateur du sénateur républicain de l'Alabama - et futur ministre de la Justice - Jeff Sessions, avant de rejoindre l'équipe de campagne de Donald Trump et de jouer un rôle de premier plan à la Maison-Blanche. Entre les deux présidences de Trump, il a cofondé, en 2021, America First Legal, pour “lutter contre les actions du pouvoir exécutif qui ne respectent pas la loi et la gauche radicale” (non souligné dans le texte).
Selon Stephen Miller, America First Legal est “la réponse tant attendue à l'ACLU” (Union américaine pour les libertés civiles). En tant que telle, sa mission est “d'utiliser tous les outils juridiques disponibles” pour empêcher la “gauche radicale” “d'ouvrir les frontières de l'Amérique, de paralyser l'énergie américaine, d'essayer de prendre le contrôle des élections américaines et de violer les droits civils fondamentaux du peuple américain”.
La dernière contribution de Miller au régime Trump 2.0 concerne l'habeas corpus - le droit d'une personne à contester sa détention devant un tribunal. Selon le conseiller à la Sécurité intérieure, Donald Trump a le droit d'expulser des ressortissants étrangers vers le Salvador sans aucune forme de contrôle judiciaire, car la Constitution autorise le président à suspendre l'habeas corpus en période de rébellion et d'invasion.
Leon Louw

Né en 1948, Leon Louw est un entrepreneur politique sud-africain issu d'une famille de suprémacistes blancs. Durant ses études, il flirte brièvement avec le marxisme avant de se convertir au néolibéralisme et de cofonder, en 1975, la Free Market Association of Southern Africa - un think tank libertarien affilié au réseau Atlas financé par Charles Koch. Désireux de modifier le régime de l’apartheid sans compremettre les intérêts de la minorité blanche, il préconise un système de cantons ostensiblement semblable à celui de la Suisse, mais fondé en grande partie sur la séparation des “groupes sociaux, culturels et ethniques»”. Dans cette proposition, bien que le droit à la libre circulation se voit protégé par la Constitution pour le capital, les biens et les personnes de toutes races, on accorde malgré tout aux cantons “le droit de discriminer”, compromettant de fait les droits de citoyenneté. Par ailleurs, les partis politiques ne sont autorisés que dans les cantons, tandis qu’un gouvernement national, prétendument neutre, est chargé d’endiguer les risques de conflits entre eux et de faire respecter les libertés du marché.
Louw développe cette vision dans South Africa: The Solution1, un livre publié en 1986 qu'il coécrit avec sa femme Frances Kendall. L'objectif avoué de son projet, comme il l'explique dans une interview accordée au Time Magazine un an plus tard, est de “permettre au tigre – la majorité noire – de sortir de sa cage sans que les Blancs ne soient dévorés2”. Il s'est également efforcé de mettre en œuvre sa vision dans le bantoustan du Ciskei, jusqu'à la fin de l'apartheid, ce qui fait de lui un pionnier des “zones franches” libertariennes décrites par Quinn Slobodian dans Le Capitalisme de l’apocalypse.
Après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, Louw a continué à mettre en garde contre les dangers de ce qu'il appelle la « démocratie sans limite », un régime qui, selon lui, “a conduit au communisme au Chili, au national-socialisme (le nazisme) en Allemagne et au règne de l'État providence dans de nombreuses régions d'Europe”. Si le gouvernement de son pays s'est montré largement insensible à ses inquiétudes, il peut trouver un certain réconfort dans le fait que, sous l’administration Trump, les Afrikaners soient les seules personnes éligibles au statut de réfugié aux États-Unis.
1. Leon Louw et Frances Kendall, South Africa: The Solutions, Amagi Publications, 1986.
2. Quinn Slobodian, “The Ciskei experiment: a libertarian fantasy in apartheid South Africa”, The Guardian, 23 mars 2023.
Timelines
21 Juillet 2016

Cleveland, Ohio. Dernier jour de la convention républicaine. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, Palentir Technologies et Founders Fund, chantre du libertarianisme conservateur, monte sur scène pour afficher son soutien au candidat Donald Trump : “Je crée des entreprises et je soutiens des gens qui bâtissent de nouvelles choses, des réseaux sociaux aux vaisseaux spatiaux. Je ne suis pas un politicien. Mais Donald Trump non plus. C'est un bâtisseur. Et il est temps de rebâtir l'Amérique.”
14 Juillet 2024

Celui qui deviendra le “First Buddy” du Président quelques mois plus tard annonce officiellement sur X son soutien au candidat républicain. Elon Musk avait déjà déclaré vouloir changer de camp, en mai 2022, après les enquêtes fédérales menées sur la sécurité des autopilotes Tesla et le rachat de Twitter ; avant de réintégrer Trump au réseau social puis de multiplier les tweets reprenant les thèmes de prédilection de ce dernier.
19 Juillet 2024

L'épiphanie masculiniste qui s'est emparée de Mark Zuckerberg depuis ses velléités de combats MMA lui offre un nouveau regard sur le futur Président, avec qui il entretient pourtant des relations tendues depuis près d'une décennie. “Voir Donald Trump se relever après avoir reçu une balle au visage et brandir le poing sur fond de drapeau américain est l'une des choses les plus badass que j'aie vues de ma vie”, déclare-t-il à Bloomberg. Il rencontrera son nouveau modèle d'homme fort à Mar-a-Lago en décembre, avant d'annoncer le don d'1 million de dollars au fond d'investiture de Trump puis d'embrasser les préconisations du nouveau gouvernement en matière de vérification des faits, de diversité et de gestion des performances au sein de son entreprise Meta.
25 Octobre 2024
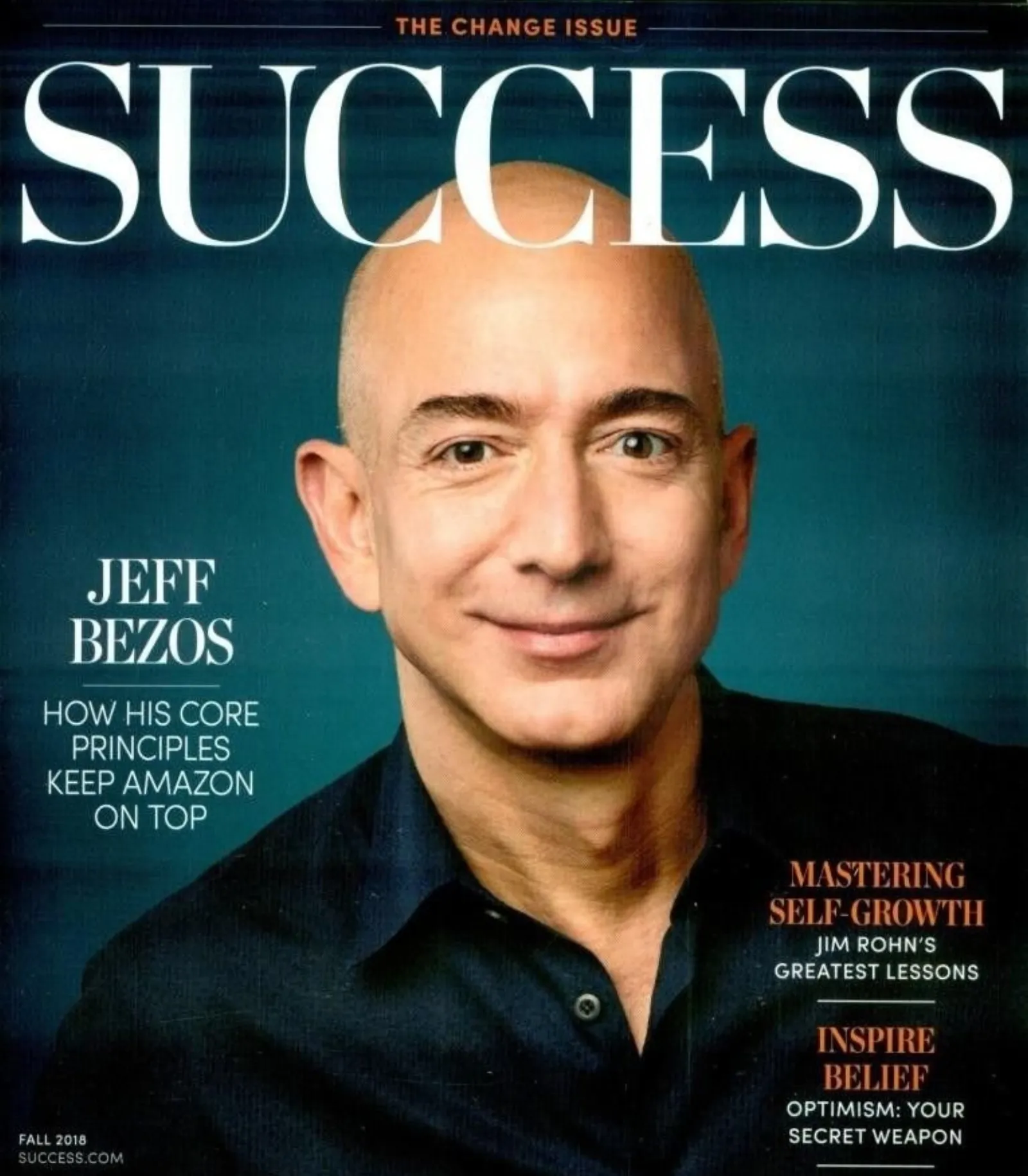
Pour la première fois en 40 ans, le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, annonce qu'il ne soutiendra aucun candidat à l'élection présidentielle. Quelques semaines plus tard, lors du NYT DealBook Summit, le PDG d'Amazon se déclare “très optimiste” quant à la présidence Trump, notamment parce que le Président élu, à qui il se dit prêt à apporter son aide, “semble avoir beaucoup d'énergie pour réduire la réglementation”. Il contribuera lui aussi, au nom de ses entreprises, notamment Blue Origin - qui dépend des commandes publiques - à hauteur d'1 million de dollars au fond d'investiture de Donald Trump.
06 Novembre 2024
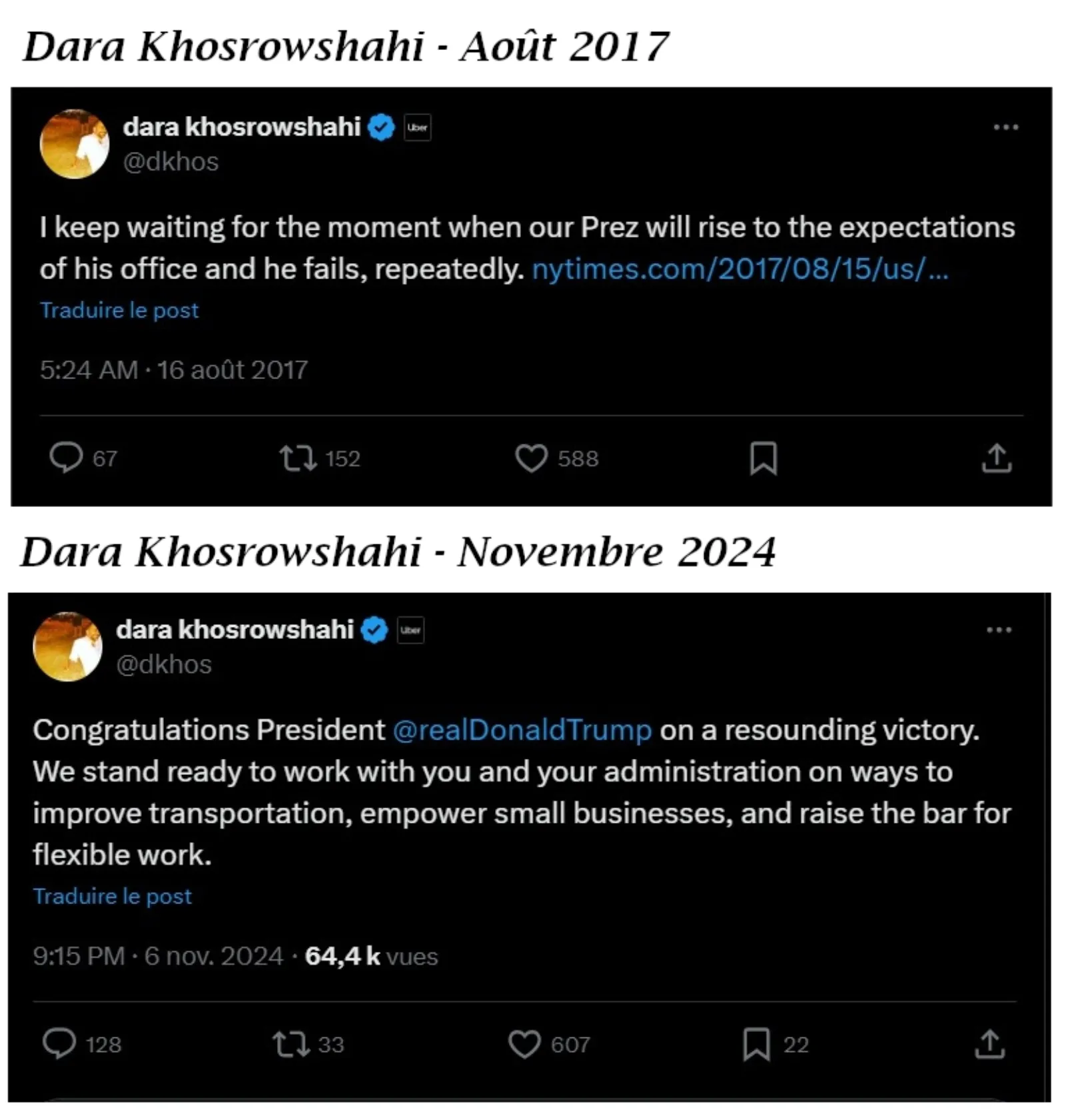
Les messages de chaleureuses félicitations adressés sur X au Président élu affluent depuis la Silicon Valley. Beaucoup manifestent leur impatience de collaborer avec la nouvelle administration, tel le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, qui, peu amène en 2017 à l'égard de l'action présidentielle, s'enthousiasme désormais pour la “victoire éclatante” de Donald Trump et la perspective “d'élever le niveau de la flexibilité au travail”. Il fera don de 2 millions de dollars au fonds d'investiture, l'un au nom d'Uber, l'autre à titre personnel. C'est également le cas de Tim Cook, PDG d'Apple, qui confie sa hâte de travailler avec le cabinet Trump pour faire “briller” les États-Unis. Lors de son passage à Mar-a-Lago le mois suivant, il abordera avec le Président la question de l'exemption des droits de douane. Nous ne savons pas si l'amende de 13 milliards de dollars qu'Apple risque de se voir infligée en Europe pour fraude fiscale a été évoquée lors de ce dîner.
21 Novembre 2024

Sundar Pichai, PDG de Google et de sa société mère Alphabet, appelle personnellement Donald Trump pour le féliciter pour “sa victoire décisive”. “Nous sommes à un âge d'or de l'innovation américaine et nous sommes déterminés à travailler avec [la nouvelle] administration pour aider à en faire profiter tout le monde”, déclare le chef d'entreprise. Il figurera au premier rang lors de l'investiture du 20 janvier qui acte le départ des membres du ministère de la Justice à l'origine de l'offensive antitrust contre Google qui pourrait contraindre le groupe à vendre sa mine d'or, Google Chrome.
13 Décembre 2024

En novembre 2016, se tenait à Mountain View une réunion à l'ambiance lourde. Le cofondateur de Google, Sergey Brin, déplorait le résultat de l'élection qui installait Donald Trump au pouvoir. Il qualifiait ce résultat de “triste”, “profondément offensant” et “contraire aux valeurs de Google”, tandis que la directrice financière, Ruth Porat, l'écoutait les larmes aux yeux. En janvier 2017, Sergey Brin participait, “indigné”, à une manifestation contre l'arrêté anti-immigration du gouvernement, se présentant lui-même comme “un immigré et réfugié”. Huit ans plus tard, Sergey Brin s'emploie, à Mar-a-Lago, à s'attirer les faveurs de l'administration qui s'apprête à reprendre les rênes du pouvoir, tandis que Ruth Porat se réjouit au Forum économique de Davos de “la formidable opportunité de travailler avec Trump 2.0”.
03 Janvier 2025
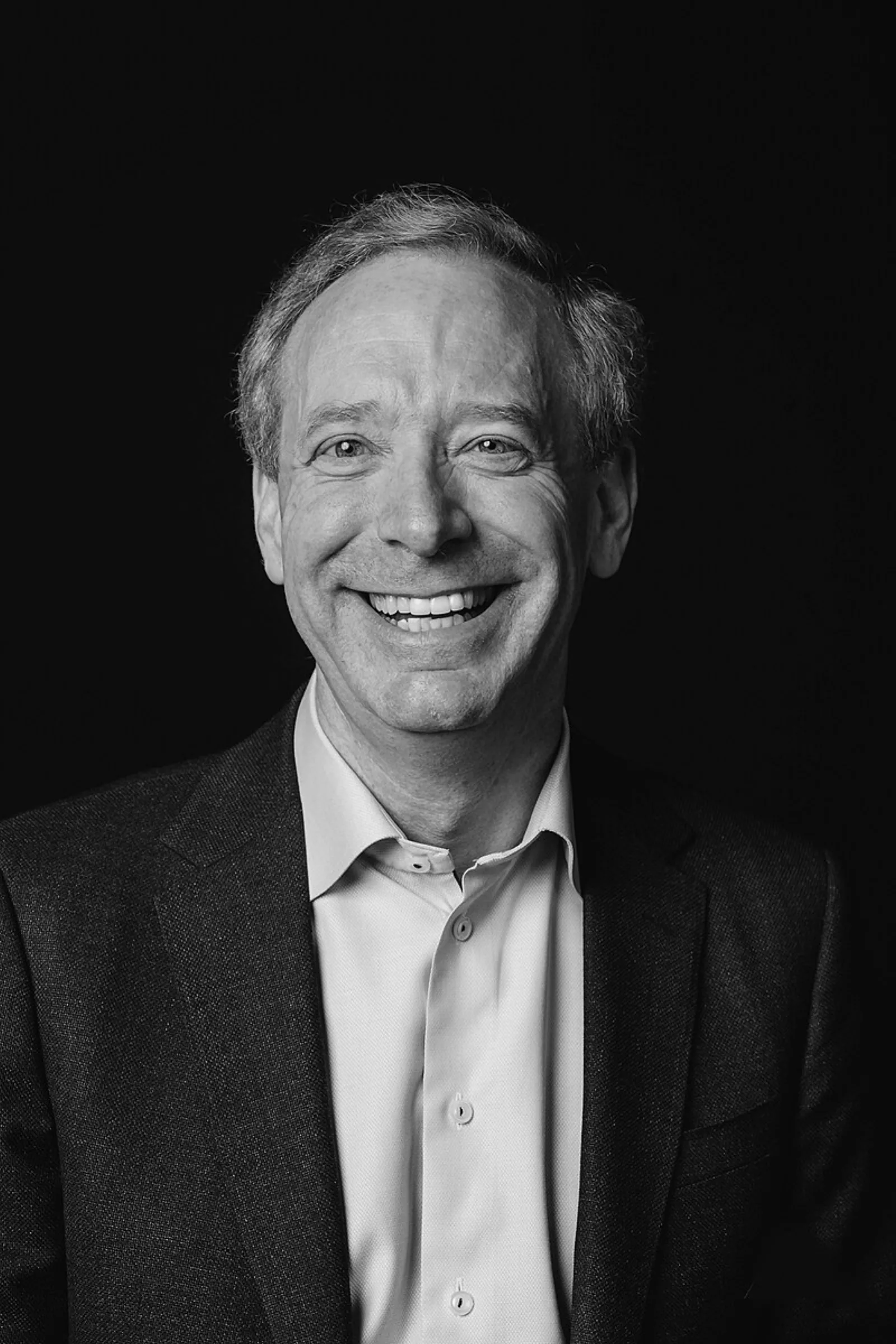
Dans un billet de blog, Brad Smith, PDG de Microsoft, affiche sa confiance en l'avenir économique de son pays sous la nouvelle présidence Trump et annonce que son entreprise compte investir 80 milliards de dollars pour le déploiement de l'IA. Tout en félicitant le locataire de la Maison Blanche pour les décisions prises lors de son premier mandat, il fait part d'une réflexion teintée d'espoir : “Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ralentir le secteur privé avec des régulations lourdes.”. Sans doute fait-il notamment référence aux objectifs environnementaux sur lesquels la nouvelle administration devrait se montrer peu pointilleuse, laissant Microsoft continuer à faire s'envoler ses émissions carbones - +29% en 2023 - au nom du développement économique et technologique.
19 Janvier 2025

Soutien des Démocrates depuis qu'il a glissé son premier bulletin Al Gore dans l'urne en 2000, Joe Gebbia, cofondateur d'Airbnb fait une déclaration enflammée à Donald Trump et Robert Kennedy Jr dans un très long post sur X. S'il déclarait en août 2018 que la politique trumpiste à la frontière mexicaine était “sans cœur, cruelle, immorale et contraires aux valeurs américaines”, le designer a désormais bien réfléchi : Donald Trump “n'est pas un fasciste déterminé à détruire la démocratie”. Le Président est un homme qui “se soucie profondément de la nation”, prompt à “ramener du bon sens” dans une Amérique dévoyée et ayant à cœur de sécuriser les frontières. Joe Gebbia a, en février 2025, intégré le DOGE d'Elon Musk.
10 Mars 2025
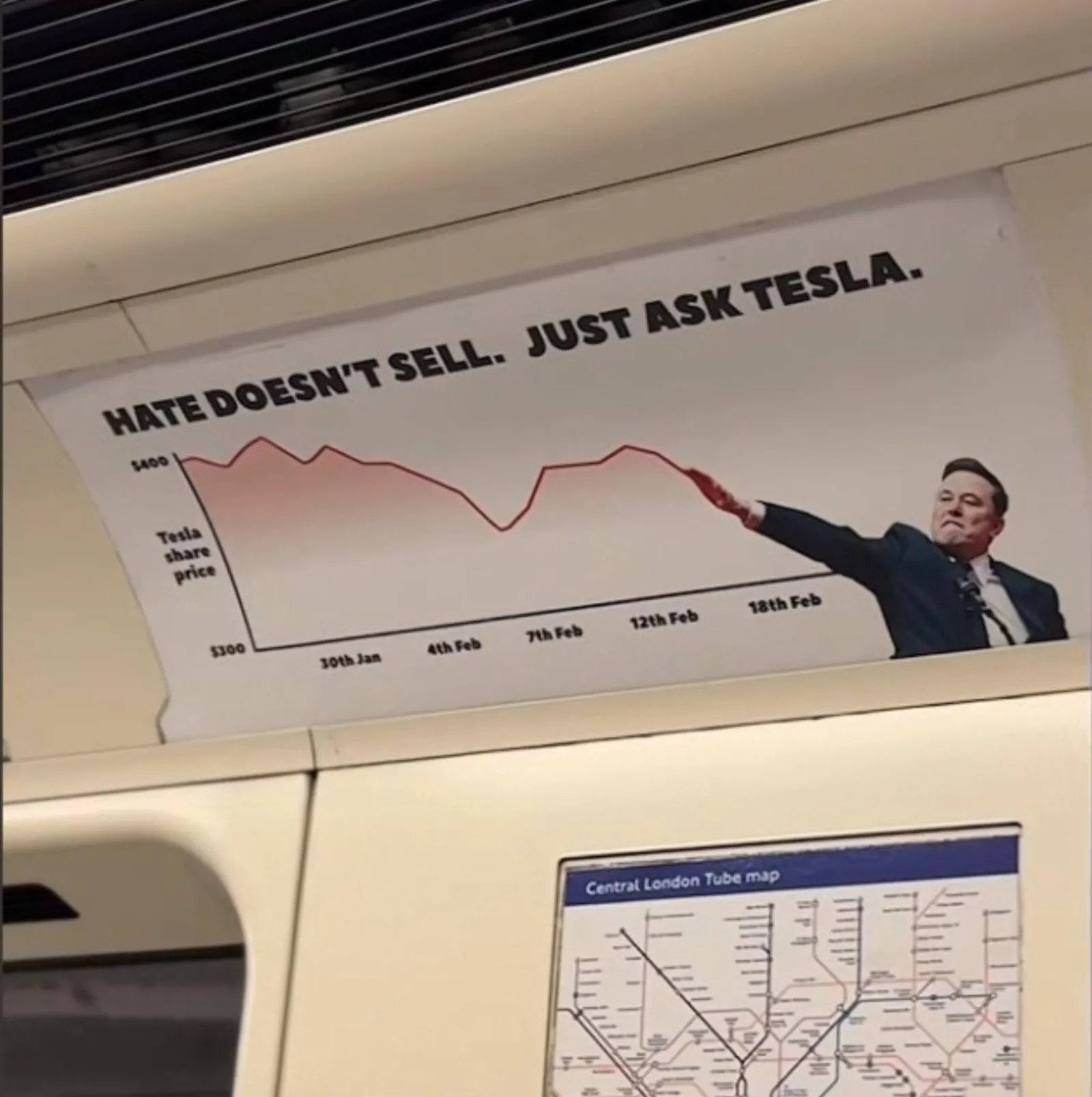
Le cumul des pertes en capitalisation boursière de Tesla, Amazon, Alphabet et Meta, depuis que leurs dirigeants ont orné les rangs de l'investiture de Donald Trump, atteint 1 828 milliards de dollars. Les fortunes personnelles d'Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin et Mark Zuckerberg ont fondu de 204 milliards de dollars entre le 20 janvier et le 10 mars. La loyauté n'a pas de prix.
1976
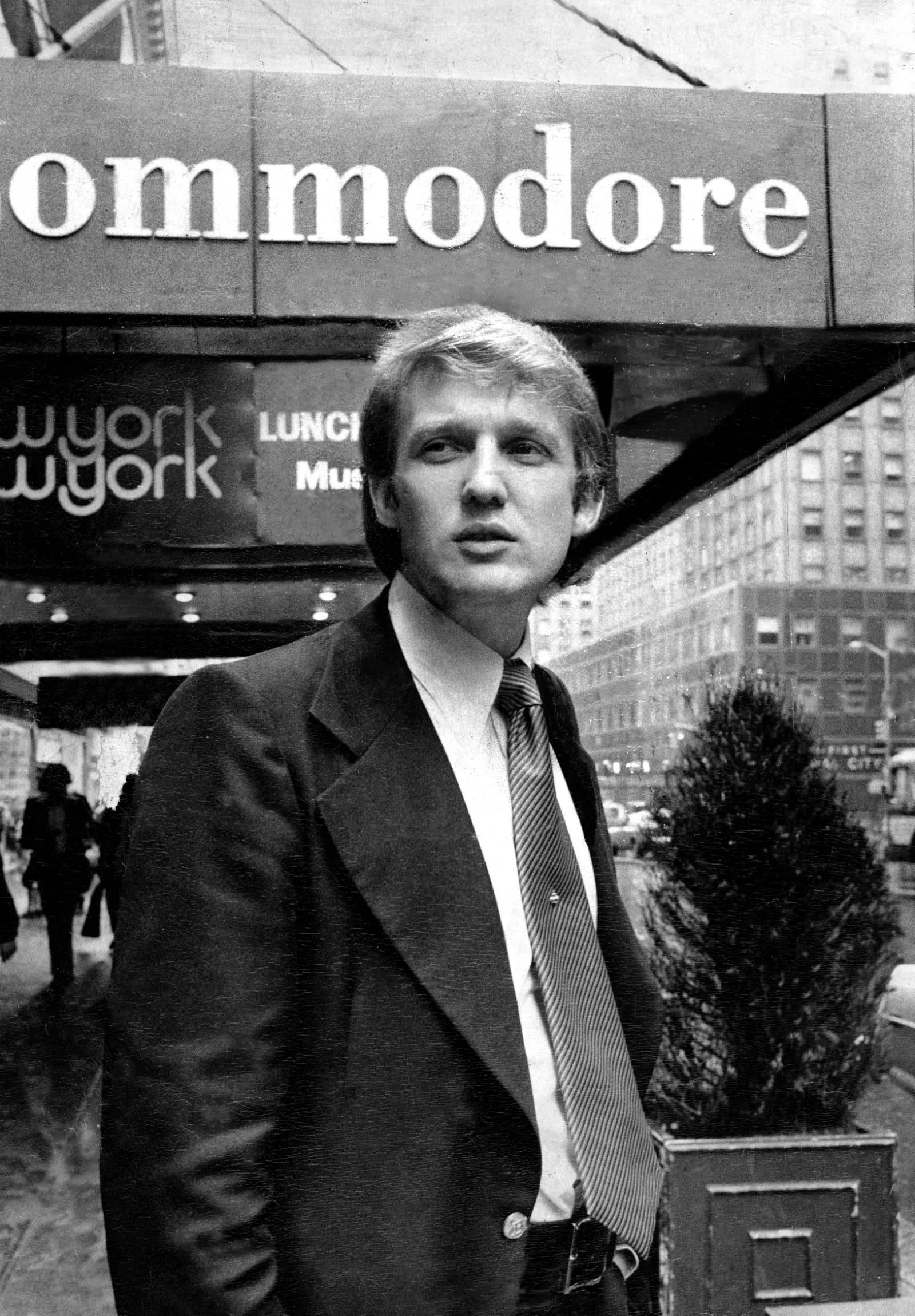
Il signe un accord avec la ville de New York qui lui permet d’acheter le Commodore Hotel, qu’il transformera en Grand Hyatt Hotel, en bénéficiant d’une importante réduction d’impôts sur 40 ans. Trump profite du carnet d’adresses que son père s’est constitué pendant plusieurs décennies au sein de la mairie par le biais de dons massifs au Parti démocrate, ainsi que de l’influence de la pensée des économistes de l’offre auprès des conseillers politiques municipaux. C’est la première fois qu’un tel arrangement fiscal est mis en place par la ville et cette durée de réduction d’impôts reste encore la plus longue de son histoire. En 2016, le journaliste du New York Times Charles Bagli a calculé que cette opération fiscale avait coûté 885 millions de dollars en manque à gagner à la ville de New York.
2004-2015

Trump anime l’émission télévisée The Apprentice, dans laquelle il incarne un dirigeant d’entreprise éliminant les participants dont le but est de devenir l’apprenti d’un homme d’affaires. L’émission, diffusée par le groupe NBC, entérinera la notoriété publique de Trump : lors de ses débuts en 2004, elle comptabilise en moyenne 21 millions de téléspectateurs hebdomadaires. Après 14 saisons, il est licencié par NBC en juin 2015 après des remarques racistes à l’encontre des immigrants mexicains proférées lors de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle.
2015-2023
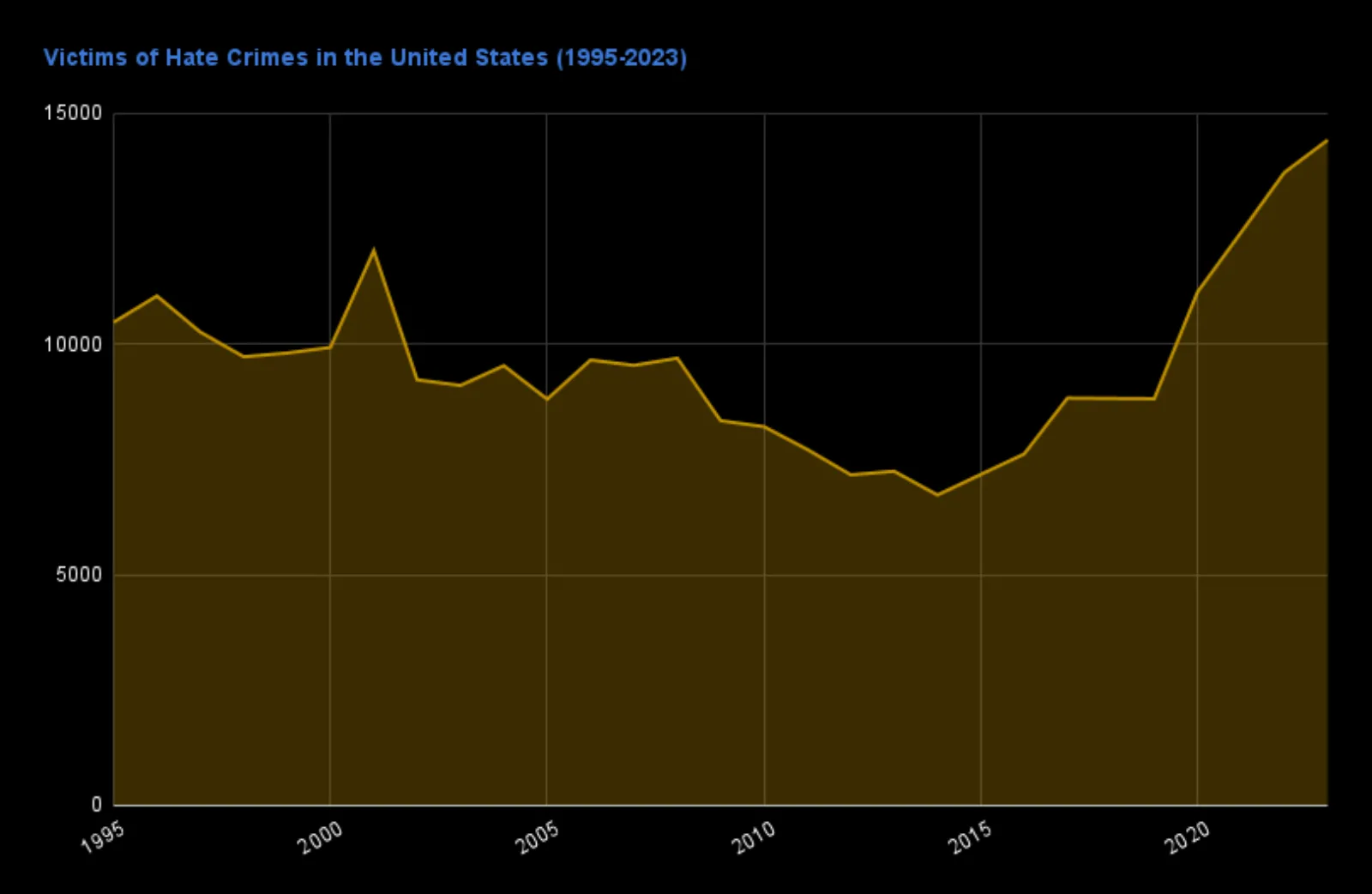
Il aura fallu 19 ans pour voir le nombre de victimes de crimes de haine aux États-Unis baisser de 36 %. En 2014, il connaît son plus bas niveau depuis les années 1990. Il aura fallu 9 ans pour le voir augmenter de 115 %.
Plusieurs chercheurs, dont Griffin Sims Edwards et Stephen Rushkin, ont documenté l’impact de la rhétorique haineuse de Donald Trump, et sa validation par son élection, sur l’envolée de ce terrorisme intérieur depuis 2015. Voici quelques exemples de ce qu’ils ont appelé “l’effet Trump”.
17 juin 2015

Dylann Roof, suprémaciste blanc et néonazi autoproclamé de 21 ans ouvre le feu sur la communauté noire de l’église Mother Emanuel de Charleston, en Caroline du Sud. Il avait assisté, pendant 1 heure, au cours d’étude biblique au sein de l’établissement religieux avant d’abattre 9 de ses participants. “J'ai failli ne pas le faire parce que tout le monde était tellement gentil avec moi”, dira-t-il à la police, mais l’homme est déterminé à déclencher une guerre raciale. Radicalisé en ligne après avoir passé des heures à lire les diatribes racistes du Council of Conservative Citizens, Roof, natif de Caroline du Sud, regrettait amèrement le bon vieux temps des États confédérés pour qui “l’esclavage et la subordination à la race supérieure sont [la] condition naturelle et normale [du nègre]”. Le lendemain de la tuerie, tous les drapeaux avaient été mis en berne, seul le drapeau confédéré, avec lequel Roof aimait tant se prendre en photo, continuait de flotter fièrement sur le Capitole de Columbia.
11 et 12 août 2017

À Charlottesville, en Virginie, des centaines de suprémacistes blancs, néoconfédérés, néofascistes, néonazis, membres de l’alt-right, du Ku Klux Klan et de milices d’extrême droite se rassemblent pour protester contre la décision de la ville de retirer d’un parc la statue du général confédéré Robert E. Lee. Le “Unite the Right rally”, qui a pour ambition d’unifier le mouvement nationaliste blanc américain, rencontre sur place la résistance de nombreux militants antifascistes. Le 12 août, le néonazi James Alex Fields Jr. fonce, au volant de sa voiture, sur un groupe de contre-manifestants blessant 35 personnes et tuant Heather Heyer, 32 ans. Loin de condamner le rassemblement et les motivations haineuses de ses initiateurs, Donald Trump instaure une équivalence entre les néofascistes et les antifascistes qui s’affrontent à Charlottesville déclarant qu’”il y a des gens très bien des deux côtés”.
3 août 2019

À El Paso, ville texane située à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Patrick Crusius commet l’une des tueries de masse les plus meurtrières commises sur le territoire américain depuis la Seconde guerre mondiale. Déclarant vouloir tuer le plus de Mexicains possible, il ouvre le feu dans un supermarché Walmart assassinant 23 personnes et en blessant tout autant. Avant de passer à l’acte, Crusius faisait preuve d’une certaine obsession pour le débat sur l’immigration. Louant sur les réseaux sociaux la politique frontalière dure de Donald Trump, tout dans le manifeste qu’il a rédigé pour dénoncer “l’invasion hispanique” fait écho à la rhétorique présidentielle sur l’immigration mexicaine. Trois mois plus tôt, lors d’un rassemblement en Floride, le chef de l’État demandait à ses partisans des idées pour “stopper ces gens”. L’un de ses supporters a crié “Tirez-leur dessus !”. Rire de la foule, sourire du président.
14 mai 2022
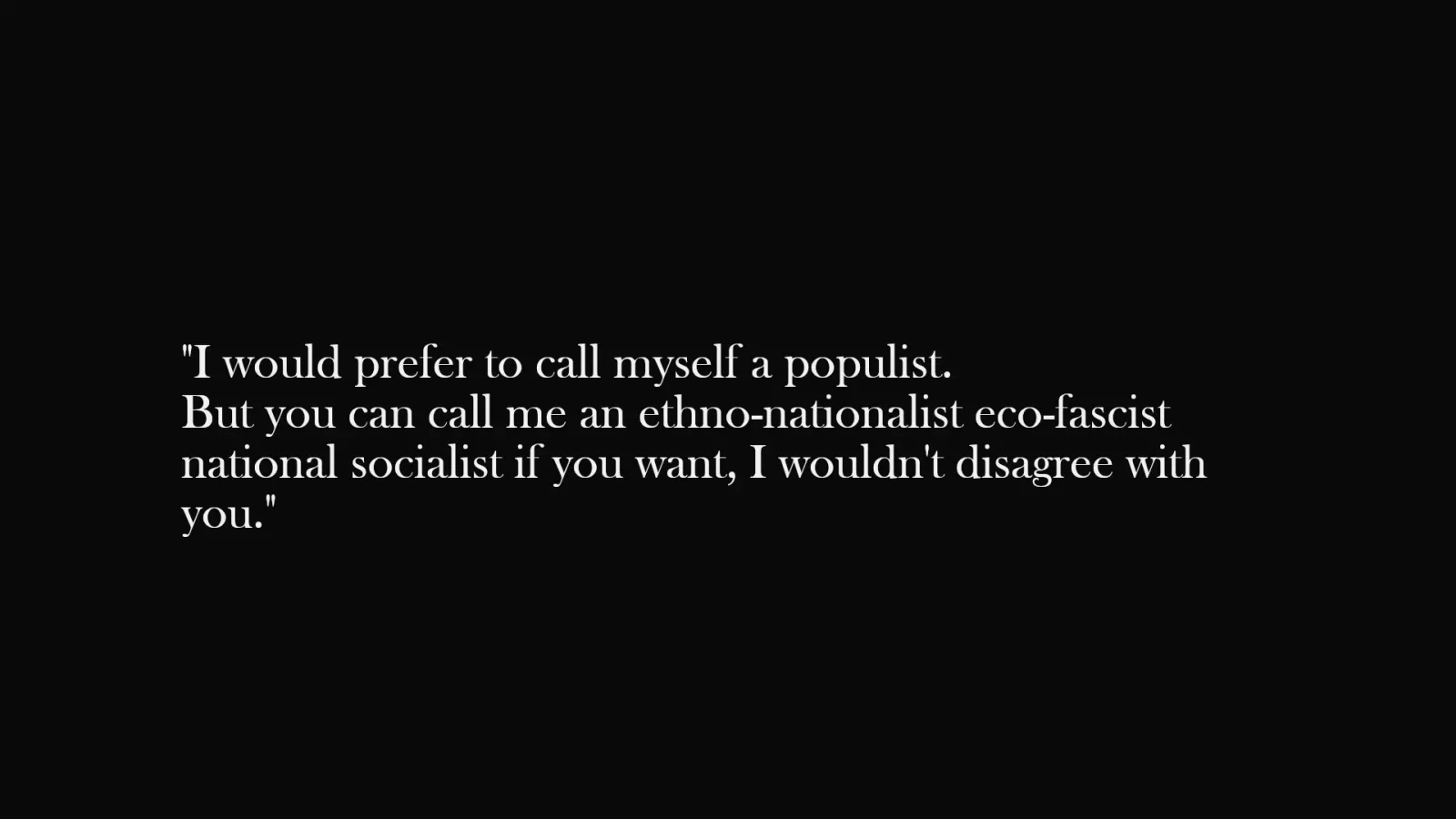
Payton Gendron, 18 ans, adepte de la théorie du “grand remplacement”, se décrivant comme ethno-nationaliste et suprémaciste blanc, tue 10 personnes, toutes noires, et en blesse 3 autres, dans une épicerie de Buffalo, dans l’État de New York. Il souhaite, par cet acte “terroriser toutes les personnes non-blanches et non-chrétiennes, et les pousser à quitter le pays”. Dans le manifeste qu’il a publié en ligne avant l’attaque, Gendron dit s’être d’abord identifié comme étant de gauche, avant d’avoir été convaincu par les positions idéologiques populistes, suprémacistes, antisémites et écofascistes du néonazi Andrew Anglin. Ce dernier a été l’un des premiers soutiens de Donald Trump en 2015, appelant ses lecteurs à le suivre, il écrivait : “votons pour la première fois de notre vie pour le seul homme qui représente vraiment nos intérêts”.
6 mai 2023
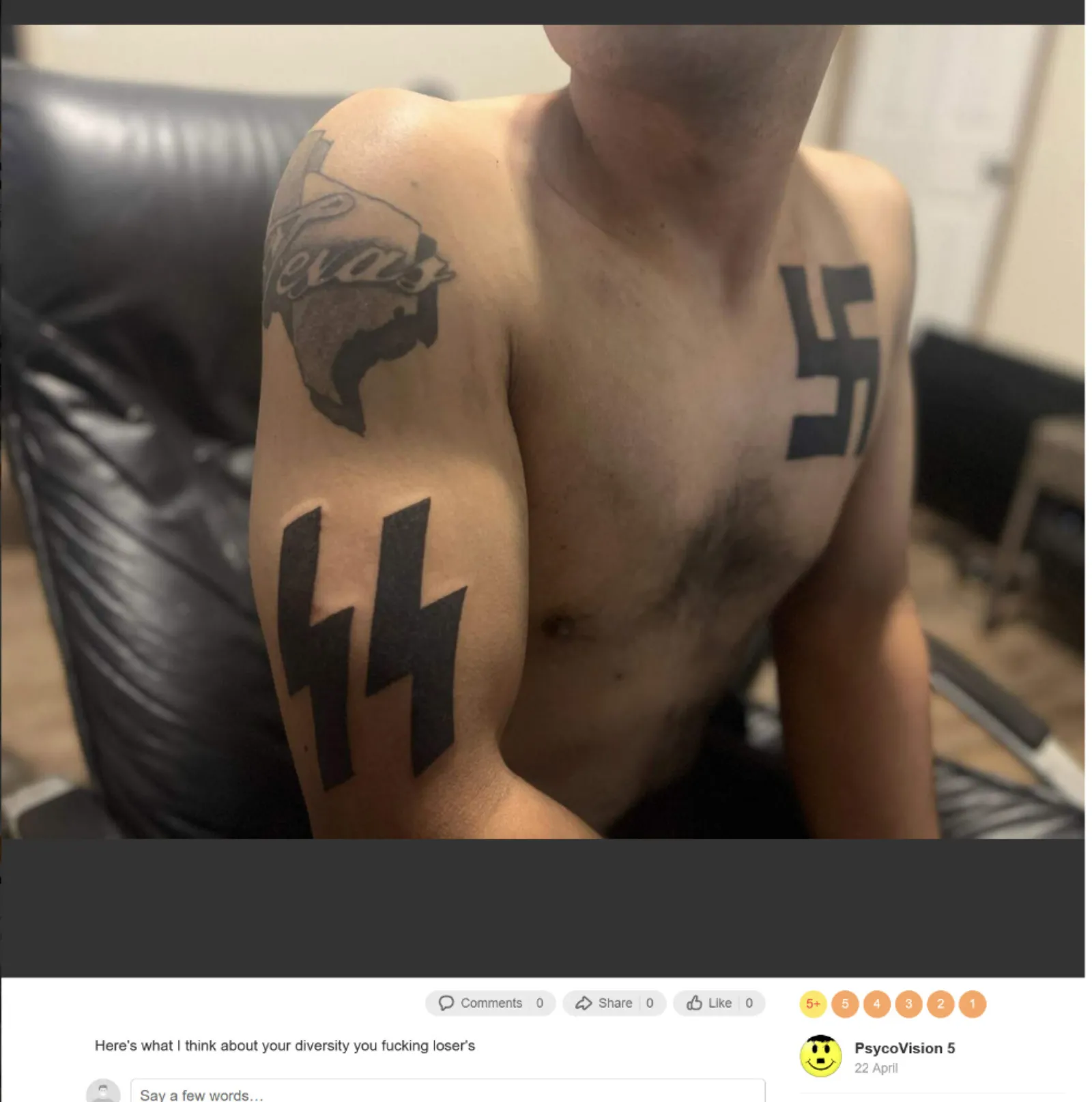
Mauricio Martinez Garcia, néonazi, suprémaciste blanc (non blanc) et incel, tue 8 personnes, dont un petit garçon d’origine asiatique de 3 ans, dans un centre commercial à Allen, au Texas. Lors de l’attaque, il portait un gilet tactique brodé d’un écusson “RWDS” (Right Wing Death Squad / Escadron de la Mort d’Extrême-droite). Sur son profil du réseau social russe Odnoklassniki, il postait des photos de ses tatouages fascistes, exprimait sa haine envers les Asiatiques, les Arabes, les Juifs et les femmes, et fantasmait sur des guerres raciales et l’effondrement de la société.
Décembre 1983 - juillet 1989
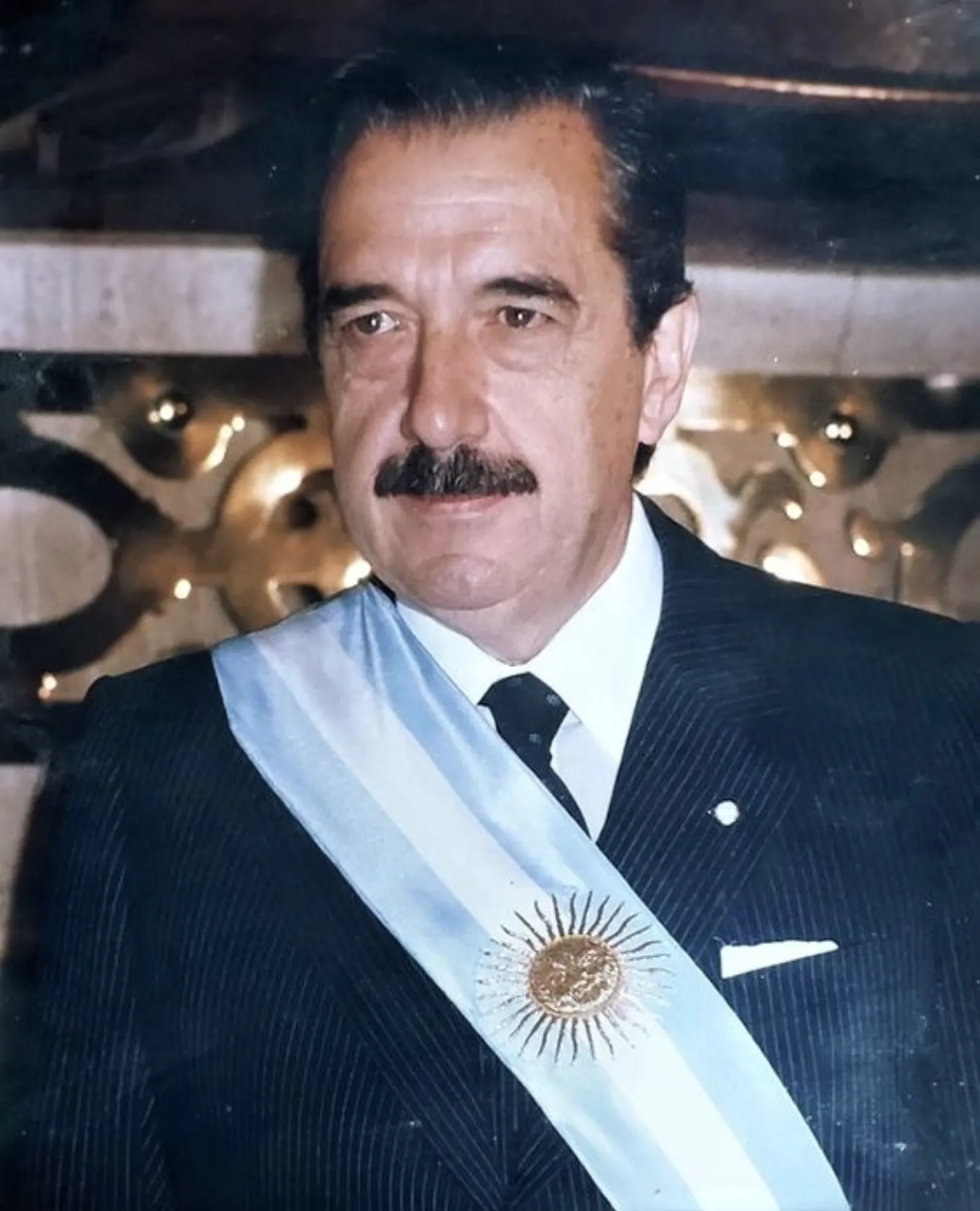
Raúl Alfonsín
Candidat de l'Union civique radicale sociale-démocrate (UCR) aux élections de 1983, la présidence de Raúl Alfonsín marque le retour de l'Argentine à la démocratie après des décennies de régime militaire entrecoupées de périodes de domination péroniste. Peu après son entrée en fonction, il met en place la première enquête officielle sur les crimes de la dictature, la CONADEP (Commission nationale sur les personnes disparues). En tant que chef de l'opposition, il signe ensuite le Pacte d'Olivos, un protocole d'accord pour une réforme constitutionnelle permettant à son successeur Carlos Menem d'être réélu en 1995.
Juillet 1989 - décembre 1999
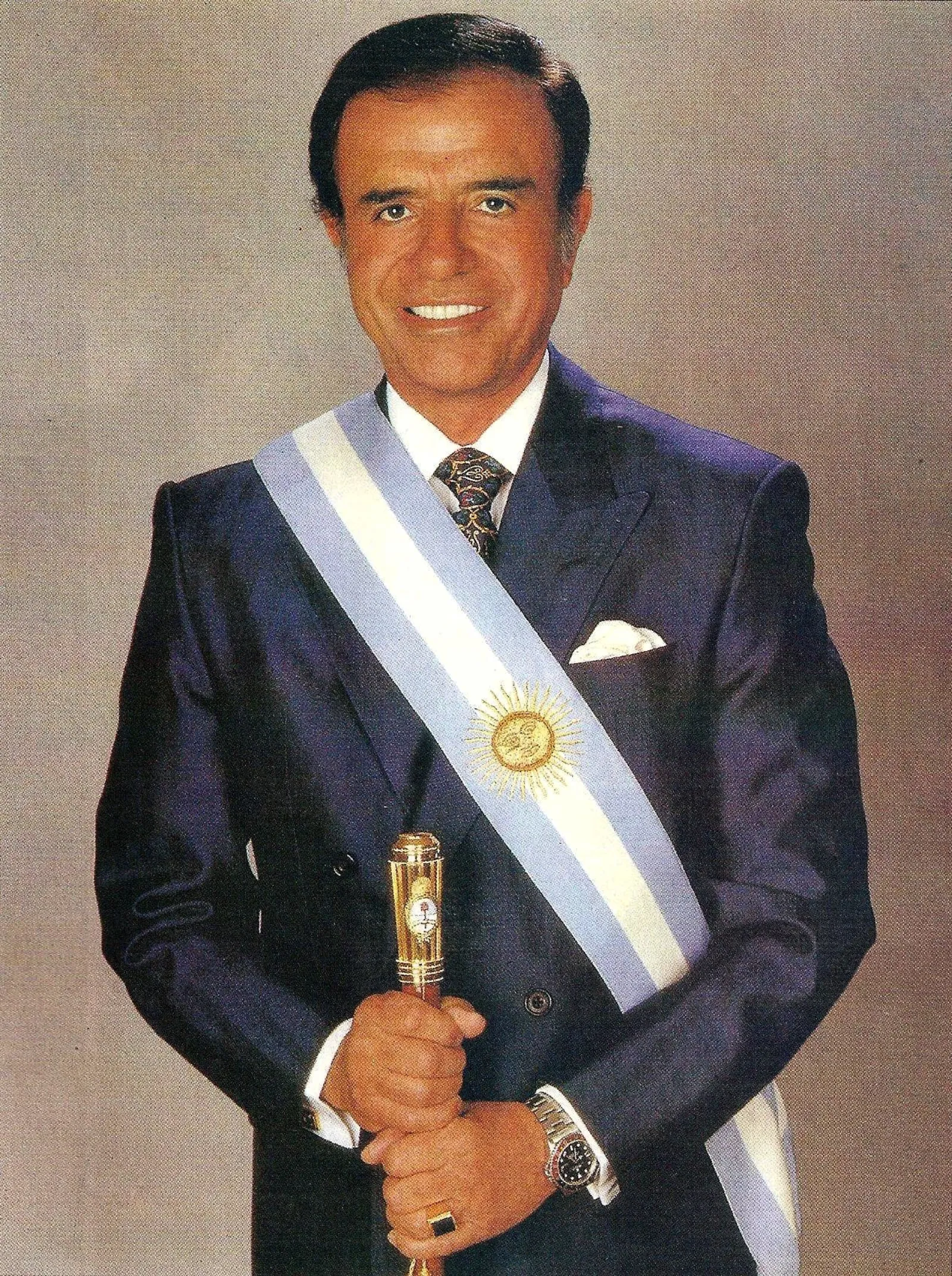
Carlos Menem
Le péroniste Carlos Menem arrive au pouvoir en 1989, dans un contexte d'hyperinflation et de désordres sociaux. Il se targue de promouvoir une nouvelle stabilité nationale et, à cet effet, met immédiatement en œuvre des réformes structurelles d’inspiration néolibérale, procédant notamment à des privatisations massives selon les préceptes du consensus de Washington. Menem rattache aussi le peso argentin au dollar américain. Il est réélu en 1995, mais ses politiques monétaires et commerciales plongent son pays dans la récession à la fin de ce second mandat. Il gracie également les commandants militaires et policiers de la période de la "sale guerre", responsables de l'assassinat de milliers de civils.
Décembre 1999- décembre 2001
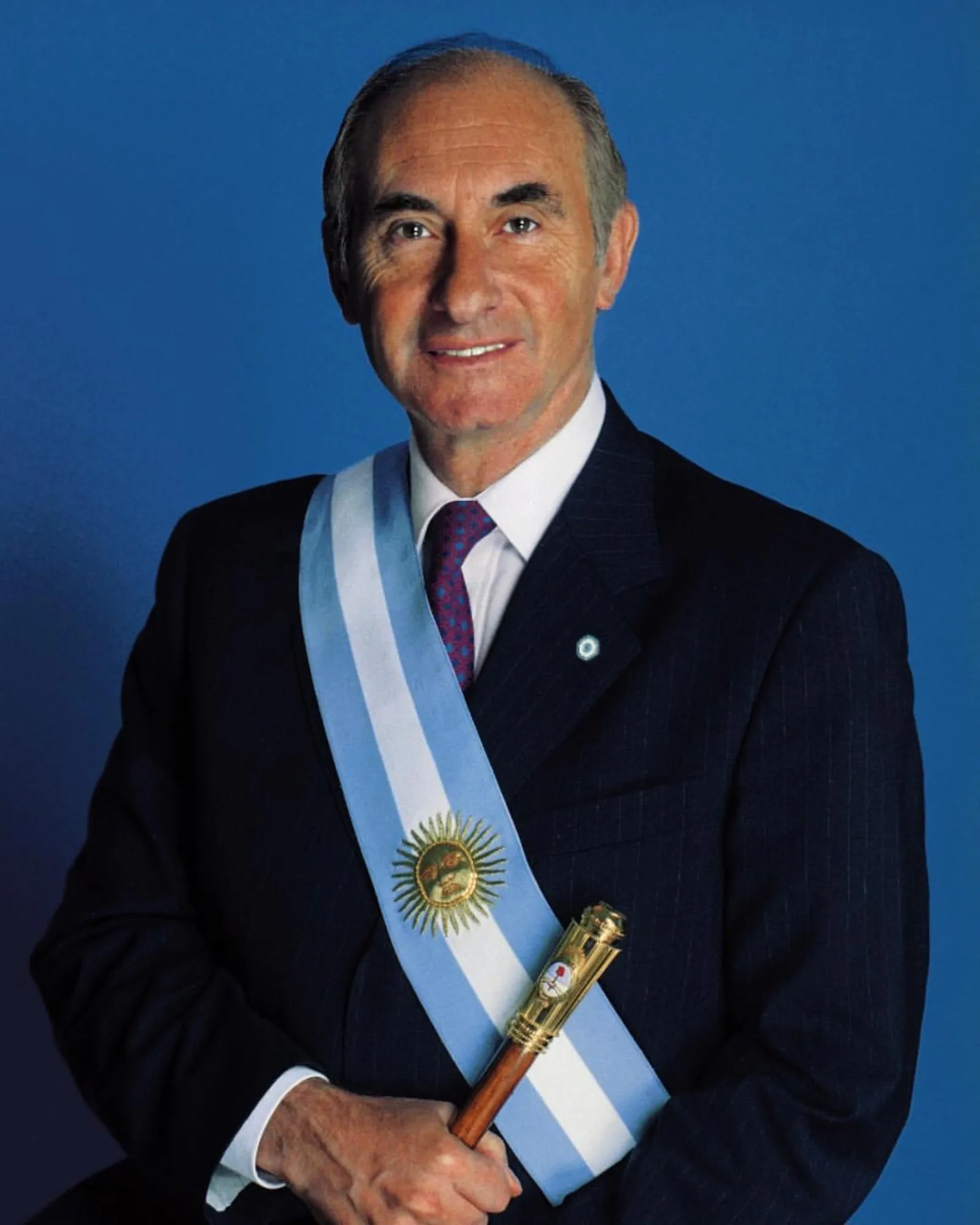
Fernando de la Rúa
L'éphémère successeur de Menem, le maire de Buenos Aires Fernando de la Rúa, n'a pas réussi à conjurer la crise économique où son prédécesseur a précipité l’Argentine. Il décrète l'état d'urgence en décembre 2001, imposant le « corralito », un gel des retraits d’espèces. Cette crise bancaire et monétaire produit aussitôt des manifestations populaires de grande ampleur. Bientôt le mouvement de révolte, initié notamment par les piqueteros, le contraint à démissionner. De la Rúa s'enfuit de la Casa Rosada présidentielle en hélicoptère.
Mai 2003 - décembre 2007

Néstor Kirchner
Après la “Grande Dépression”, sous les deux présidences intérimaires d'Adolfo Rodríguez Saá et d'Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner arrive au pouvoir en 2003, avec le projet de renforcer le soutien du parti justicialiste péroniste au sein de la classe ouvrière. Il parvient à réunir une large coalition autour d'un programme de croissance économique, de redistribution modérée, de justice en matière de droits de l'homme et de restauration des négociations collectives sectorielles. Son succès relatif dans certains de ces domaines a fait de lui une figure symbolique de la « marée rose » latino-américaine du début des années 2000, bien qu'il ne se soit jamais véritablement attaqué aux structures d’accumulation du capital.
Décembre 2007 - décembre 2015

Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner succède à son mari et s'efforce d’abord de poursuivre les politiques progressistes de ce dernier en procédant à des nationalisations, en subventionnant les prix de l'énergie, en contrôlant les devises et en introduisant un programme d'allocations familiales universelles. Au début de son second mandat, elle s'engage toutefois sur la voie de l'austérité budgétaire en adoptant une série de mesures controversées baptisées « sintonía fina » (réglage fin). À la fin de son mandat, Kirchner fait face à d'importantes manifestations dans un contexte de stagnation des salaires, d'inflation croissante et de scandales de corruption.
Décembre 2015 - décembre 2019

Mauricio Macri
Appelée la grieta [la fissure], l'intense polarisation entre les partisans et les opposants de Kirchner va favoriser l’élection de l'homme d'affaires millionnaire Mauricio Macri en 2015. Macri forme une coalition conservatrice-réformiste de centre-droit, Cambiemos, avec laquelle il inverse de nombreuses politiques de Kirchner : libéralisation, dérégulation et coupes drastiques dans les dépenses publiques sont à l’ordre du jour. Cependant, son programme prétendument méritocratique n'améliore ni le chômage ni l'inflation. Bientôt confronté à une grave crise monétaire, Macri contracte un emprunt de 57 milliards de dollars auprès du FMI, soit le prêt plus important de l'histoire de l'organisation. En 2023, il soutiendra ouvertement la candidature de Milei. De nombreux cadres du nouveau gouvernement libertaire d'extrême droite sont d’ailleurs issus de son parti conservateur traditionnel, la Proposition républicaine.
Décembre 2019 - décembre 2023

Alberto Fernández
Alberto Fernández est chef du cabinet des ministres sous les deux administrations Kirchner, jusqu'à sa démission en 2008. Il bat le président sortant Macri lors des élections de 2019. Entre-temps, Fernandez se réconcilie avec l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui était devenue trop impopulaire pour se présenter elle-même, mais qui lui apporte un soutien crucial et sert ensuite en tant que discrète vice-présidente. Le mandat de Fernández est marqué par la crise de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques, ainsi que par une dégradation continue du niveau de vie et une inflation galopante, ce qui conduit de nombreux électeurs désorientés, en particulier les jeunes, à voter pour Milei en 2023.
Recevez notre newsletter bi-mensuelle
Parce que résister à la droitisation du monde impose d'abord d'en prendre la mesure.